LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE
(extraits)
 La nuit du 4 août 1789
La nuit du 4 août 1789
Sommaire de l'ouvrage
HISTORICITÉ
I.
LA NUIT DU 4 AOÛT
I.1
Une historicité insaisissable
I.2
L’ère des révolutions
I.3
Définition : qu’est-ce que la Révolution?
II.
DU RYTHME ET DES LOGIQUES RÉVOLUTIONNAIRES
II.1
Révolutions en quête d’historicité
II.2
Le rythme des révolutions
II.2.1
La spontanéité révolutionnaire
II.2.2
Les corps révolutionnaires
II.2.3
Le gouvernement révolutionnaire
II.3
Des logiques révolutionnaires
III.
DE LA FORCE DES CHOSES AUX «DÉRAPAGES» DES RÉVOLUTIONS
III.1
La Révolution américaine
III.2
La Révolution française
III.2.1
La Révolution-bloc
III.2.2
Le «dérapage» de la Révolution
III.3
Finir la Révolution
III.4
Les révolutions avortées
IV.
LA DYSFONCTION COMME
SYMPTôME DE LA FAILLITE DE L’AUTO-DÉTERMINATION
IV.1
Caractères sociologiques de la dysfonction
IV.2
Caractères psychologiques de la dysfonction
IV.3
Faillite de l’auto-détermination comme
problématique de psychologie collective
IV.4
Qu’est-ce
que les Lumières?
V.
L’HOMME RÉVOLTÉ
V.1
La dialectique du maître et de l’esclave
V.2
La révolte critique
V.3
La révolte métaphysique
V.4
La révolte politique
V.4.1
Le despotisme éclairé
V.4.2
L’opinion publique
V.5
La conscience : une et multiple
VI.
RECHERCHE DU SENS DE L’UNITÉ DANS L’ESPACE
VI.1
Sentiment de la perte du sens de l’unité dans l’espace
VI.2
De l’empirisme vers l’activisme
VI.3
La restauration du sens de l’unité par l’idée de Nature
VI.4
La restauration du sens de l’unité par l’individualisme
VI.4.1
Le Propriétaire
VI.4.2
Le Citoyen
VI.5
La restauration du sens de l’unité par l’individualité
collective
VI.5.1
La Nation
VI.5.2
L’Empire
VII.
RECHERCHE DU SENS DE L’UNITÉ DANS LE TEMPS
VII.1
Sentiment de la perte du sens de l’unité dans le temps
VII.2
L’historiographie du XVIIIe siècle et l’émergence du concept de
civilisation
VII.3
La restauration du sens de l’unité par l’idée de progrès
a)
L’idée de progrès chez Voltaire
b)
L’idée de progrès chez Turgot
c)
L’idée de progrès chez Barnave
d)
L’idée de progrès chez Condorcet
VII.4
Les voies du progrès sont incommensurables
VII.4.1
Le nouveau Kairos
VII.4.2
L’interprétation whig
de
l’histoire
VII.4.3
Réformisme et progrès
VII.4.4
Révolution et progrès
VII.5
La restauration du sens de l’unité par la théodicée de
l’histoire
VII.5.1
Kant
VII.5.2
Herder
VII.5.3
Hegel
VIII.
FATALITÉ ET LIBERTÉ
VIII.1
Fondations du mythe
de la Révolution française
VIII.1.1
Mignet
VIII.1.2
Michelet
VIII.2
Impasse actuelle du mythe
de
la Révolution française
SIGNIFICATION
I.
LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE
I.1
La nuit où tous les nobles sont gris
I.2
La Révolution comme prolongement et dépassement du vertige baroque
I.3
Le flux schizophrénique
II.
LA POLITIQUE COMME TRAGÉDIE
II.1
Héritage révolutionnaire d’un sens baroque
II.2
Pré-conditions socio-affectives à la Révolution
II.3
Les Lumières : maturité ou platitude?
II.4
Le retour du tragique
II.5
De l’ordre du discours au discours de l’ordre
II.6
Paroles d’outre-tombe
III.
LE DYPTIQUE SCHIZOÏDE
III.1
La polarisation des imagos
III.2
Ambiguïtés de la critique
III.3
Lumières et illuminisme
III.4
La puissance du ressentiment
III.5
Le sens paradoxal de la Révolution française
III.6
Le bonheur et la philanthropie
IV.
LA THERMODYNAMIQUE RÉVOLUTIONNAIRE
IV.1
L’ennui de la douceur de vivre
IV.2
Loi de la thermodynamique révolutionnaire
IV.3
Loi psychologique des attentes et des résultats
IV.4
De l’audace, encore de l’audace… et du repos
IV.5
Répression morale, paranoïa et compulsion
V.
LE ROMAN FAMILIAL DE LA RÉVOLUTION
V.1
Famille et société en crise
V.2
Transgression en trois actes
V.2.1
Premier acte : le Parricide
V.2.2
Deuxième acte : le viol de la Mère
V.2.3
Troisième acte : la régression de la Fraternité
VI.
LA TRAGÉDIE DU PÈRE-ROI
VI.1
Défectuosités de la figure du Père et de la fonction du Roi
VI.2
L’imago du bon Père: scènes de Greuze
VI.3
L’imago du mauvais Père : le Roi-Cochon
VI.4
La mort du Roi annonce la mort de Dieu
VI.5
Le complexe de Brutus
VI.6
Le retour du Père
VII.
LE DRAME DE LA MÈRE-NATION
VII.1
Les ambiguïtés de la figure de la Mère et imprécise définition
de la Nation
VII.2
L’imago de la bonne Mère : scène de Delacroix
VII.3
L’imago de la mauvaise Mère : la Reine-Harpie
VII.4
Le retour de la Mère
VIII.
LE SPECTACLE DE L’ENFANT-PEUPLE
VIII.1
La rencontre de la figure de l’Enfant et de la fonction du Peuple
VIII.2
L’imago du bon Enfant-Peuple : la Fraternité révolutionnaire
VIII.3
L’imago du bon Enfant-Peuple : le Patriote et ses succédanés
VIII.4
L’imago du mauvais Enfant-Peuple : les indifférents, les fripons
et les contre-révolutionnaires
VIII.5
Jeunesse révolutionnaire
VIII.5.1
Les enfants et la Révolution
VIII.5.2
Les Bâtards
VIII.5.3
La Jeunesse dorée : imago du mauvais Enfant-Peuple
VIII.6
La Révolution culturelle
VIII.6.1
Piété religieuse et nouveaux symboles des Apôtres
VIII.6.2
Fêtes spontanées et confisquées
VIII.6.3
Le sang des Martyrs
VIII.7
Les Femmes et la Révolution
VIII.7.1
Les Femmes comme imago du mauvais Enfant-Peuple
VIII.7.2
Les ambivalences sexuelles de la Fraternité
VIII.7.3
Une expérience d’amour tragique
VIII.8
L’Enfant-Peuple entre la corruption et l’expiation
VIII.8.1
Corruption sociale et…
VIII.8.2
…fixation sur des pulsions partielles
VIII.8.3
À propos de l’élimination de la faction de Danton
VIII.9
La dislocation de la Fraternité
VIII.9.1
Reprise et extension de la violence révolutionnaire
VIII.9.2
La Fraternité en exil
IX.
LE CORPS RÉVOLUTIONNAIRE ET SES FANTASMES
IX.1
Le corps “révolutionnaire”
IX.2
Du corps abject de Jean-Paul Marat
IX.3
Les aberrations révolutionnaires
IX.3.1
Les monstres
IX.3.2
Le bestiaire révolutionnaire
IX.3.3
Anthropophagie réelle et cannibalisme fantasmé
a)
«La Révolution, comme Saturne, dévore ses enfants»
b)
Décapitation publique et angoisse de la castration
IX.3.4
La métaphore de la maladie : les fièvres
révolutionnaires
IX.3.5
Les aigris, les ratés et les fripons
IX.4
Le labyrinthe de la Terreur
X.
ARCHAISME ET FUTURISME
X.1
La problématique toynbeienne
X.2
L’archaïsme
X.2.1
Le traditionalisme aristocratique
X.2.2
Le néo-classicisme romain
X.2.3
L’engouement romantique pour le Moyen Âge chrétien
X.2.4
Le Noble Sauvage et les Barbares
X.3
La philosophie de l’histoire de Herder
X.4
Romantisme et Révolution française
X.4.1
Les Girondins
X.4.2
Saint-Just : la rose entre les dents?
X.4.3
La nostalgie révolutionnaire
X.5
Le futurisme
X.5.1
Transcendance du futurisme
X.5.2
Régénération et création de l’homme nouveau
MORALISATION
I.
ESSAIS SUR LA RÉVOLUTION
I.1
Abolitions et déplacements
I.2
Valeurs du mot révolution
I.3
L’idée dans l’air
a)
…chez Montesquieu
b)
…chez Rousseau
II.
IDÉOLOGIES ET PRINCIPES
II.1
L’idéologie des Lumières
II.2
La relativité des principes
II.3
Le bonheur…
II.4
…c’est la propriété
II.5
Au comble du bonheur, la spéculation
III.
LA VERTU COMME PRINCIPE DES RÉPUBLIQUES
III.1
La vertu comme modération
III.2
L’honnête homme et la méritocratie
III.3
Le cas Robespierre
III.4
L’honnête médiocrité et l’habile homme
III.5
La gloire nouvelle : l’utilité publique
IV.
LA RÉVOLUTION MORALE
IV.1
La morale activiste de l’histoire
IV.2
Le mythe libéral de l’éducation
a)
Condorcet et les Idéologues
V.
TENDANCES
V.1
Mobilité des tendances révolutionnaires
V.2
Les luttes de races
V.3
Les luttes de classes
VI.
LE SYSTEME IDÉOLOGIQUE
VI.1
Les deux aspirations
VI.2
La Liberté
VI.3
La Justice
VI.4
La Société comme Volonté générale
VI.5
Souveraineté populaire entre droit à l’insurrection et contrôle
de l’État
VI.6
Le Contrat social
VI.7
La Représentation
VI.8
La Constitution
VI.8.1
La Constitution des États-Unis d’Amérique
VI.8.2
L’Assemblée constituante et la Constitution de 1791
VI.8.3
La République et la Convention
VI.8.4
Le Directoire et la fin de la Révolution
VI.9
L’Égalité
VI.9.1
Les biens nationaux et les assignats
VI.9.2
Le travail
VI.9.3
Les décrets de Ventôse
VI.10
Le Cosmopolitisme
VI.11
Le Nationalisme
VII.
LES SUPPORTS IDÉOLOGIQUES
VII.1
Le despotisme éclairé
VII.2
Clubs et sociétés de pensée, la presse
VII.3
La Contre-Révolution
VIII.
LA PRAXIS
IDÉOLOGIQUE
VIII.1
La mystique du Sauveur
VIII.2
Fonction sociale de la religion et situation révolutionnaire
VIII.2.1
Utilisations opportunistes de la religion…
VIII.2.2
…et messianisme révolutionnaire mythique
VIII.2.3
À propos de l’élimination de la faction de Hébert
IX.
LE SAUVEUR À LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS
IX.1
Praxis
idéologique
entre archaïsme et futurisme
IX.2
L’utopie d’une révolution anti-utopique
IX.3
Droit naturel et Histoire
IX.4
Historicisme
IX.5
Leçons de l’histoire
IX.6
La loi de répétitions historiques
IX.7
La Révolution comme machine à explorer le Temps
IX.7.1
Une solution archaïste : la réforme Maupeou (1771)
IX.7.2
Une solution futuriste : la réforme Turgot (1775)
IX.7.3
Réaction et rébellion dans les colonies libérées d’Amérique
IX.7.4
La révolution nobiliaire et la solution des États généraux (1789)
IX.7.5
Une solution futuriste : la journée des Tuiles (7 juin 1788)
IX.7.6
Une solution archaïste : la constitution civile du clergé
IX.7.7
Une solution archaïste : la révolution paysanne selon Georges
Le- fèvre
IX.7.8
«Louis, Empereur!»
IX.7.9
Le plan Mirabeau
IX.7.10
Entre archaïsme et futurisme : la commune populaire
IX.7.11
Thermidor et la révolution réactionnaire
IX.7.12
La conjuration des Égaux et la réaction révolutionnaire
IX.7.13
Le Romantisme
X.
LE SAUVEUR AU GLAIVE
X.1
Du salut public à la dictature
X.2
Fonction de la violence révolutionnaire
X.2.1
La violence intérieure : la Terreur
X.2.2
La violence extérieure : la guerre révolutionnaire
XI.
L’UTOPIE IDÉOLOGIQUE DE L’ÉTAT UNIVERSEL D’OCCIDENT
XI.1
De la Révolution à l’État universel
XI.2
Confusions ultimes
XI.3
Contributions de l’ère révolutionnaire à l’État universel
occidental
a)
Les départements
b)
Capitale
c)
Langue et écriture officielles
d)
Lois
e)
Calendriers; Poids et mesures; Monnaie
f)
Administration publique
g)
Citoyenneté
X.II.
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE: BILAN ET SAUT QUALITATIF DE LA PSYCHOLOGIE
MORALE OCCIDENTALE
L’ERE
DES RÉVOLUTIONS DANS LA CONSCIENCE HISTORIQUE OCCIDENTALE:
LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE
I
Fiction démocratique
II
Idolâtrie d’une institution éphémère
ANNEXE
DES
RÉBELLIONS DU BAS-CANADA DE 1837-1838 COMME EXEMPLE DE RÉVOLUTIONS
AVORTÉES
HISTORICITÉ
I. Une
historicité insaisissable, symptôme d’une révolution avortée
II. Logiques
de la Rébellion
II.1
La logique des nécessités
II.2
La logique des contingences
II.3
Logique révolutionnaire de la Contre-Révolution
III. Dysfonctions
bas-canadiennes
IV. Perte
et restauration du sens de l’unité
SIGNIFICATION
I. La
problématique symbolique des rébellions bas-canadiennes
II. Le
conflit des imagos familiales
II.1
Père et Mère honoreras
II.2
Les Canadiens errants…
III. Angoisse
Play
IV. Archaïsme
et futurisme
MORALISATION
I. Le
Bas-Canada entre américanité et européanité
II. La
morale activiste contre les structures sociales
III. La
praxis
idéologique
entre réminiscences américaines et méfiances françaises
IV L’utopie
idéologique bas-canadienne
Bibliographie
de l’annexe
BIBLIOGRAPHIE
II.2
LE RYTHME DES RÉVOLUTIONS
Ce
passage de l’individualité privée à l’individualité
collective n’est pas seulement qu’un mode nouveau d’organisation
sociale qui évincerait les anciens groupes d’appartenance
vieillis. Ce n’est pas non plus cette dichotomie kantienne entre
espace privé et espace public. Il s’agit d’une mutation de la
représentation
sociale,
dont la crise, politique ici – comme elle avait été artistique ou
cosmologique auparavant -, fut le fer de lance : la révolution
nationale.
Ce n’est là qu’une de ces nombreuses lamelles en lesquelles la
Révolution française n’a cessé de se décomposer au cours de
l’évolution de l’historiographie : révolution bourgeoise chez
les historiens libéraux et marxistes; révolution aristocratique
chez Mathiez et Chaussinand-Nogaret; révolution paysanne chez
Georges Lefebvre; révolution culturelle chez Bianchi et Vovelle;
révolution féministe aussi pour Hunt; conflit de générations
enfin : cette multiplication des «voies» révolutionnaires
rassemblées sous le nom usuel de Révolution
française montre
surtout la complexité d’un événement donné pour acquis par le
mythe national républicain que la prolifération des problématiques
de l’historiographie actuelle a fait éclater. Des vertiges
baroques, «l’accélération
de l’histoire»
précipite l’historien lui-même au cœur de la tourmente
révolutionnaire.
Le
rythme en quatre étapes suggéré par Brinton ne tient pas compte de
ces multiples voies révolutionnaires, aussi se borne-t-il à
uniformiser l’ensemble des phases des régimes politiques nouveaux.
La création d’une nouvelle identité collective ne saute pas aux
yeux de celui qui, avant tout, cherche à départager le moderne de
l’ancien. Les étapes de la révolution ne peuvent maintenir de
correspondances selon les nouveaux types de révolution dégagés sur
le tronc commun national : anglais, américain, français ou
russe. Le nombre des phases ou étapes doit être réduit au minimum
pour bien suivre ce passage du geste individuel, la
spontanéité révolutionnaire, à
l’agrégat des individus en micro-sociétés, clubs, sociétés de
pensée, etc. c’est-à-dire la création des corps
révolutionnaires, courroies
de transmission, enfin l’établissement d’un gouvernement
révolutionnaire qui
canalise avant d’y mettre fin les mouvements agités par les
factions, corruption des groupes d’intérêts et anarchie des
sections populaires. La normalisation de la révolution n’ira pas,
comme dans le Mexique du XXe siècle, jusqu’à créer un Parti
Révolutionnaire Institutionnel (1945), mais le régime issu des
troubles s’imposera comme nouveau gouvernement légitime en
démontrant sa capacité à assurer et à maintenir l’ordre,
réduire les frictions, contenir les interventions étrangères tout
en relançant la prospérité économique. Ainsi l’établissement
du gouvernement fédéral américain en 1789 et du Directoire issu de
la dissolution de la convention thermidorienne en 1795, apparaissent
comme autant de réactions
dans
le rythme suggéré par Brinton. La fin d'une révolution apparaît
une réalité lorsque les révolutionnaires professionnels finissent
par stabiliser le régime nouveau d'une part en réprimant les forces
vives qui poussent encore de l'avant, d'autre part en reconstituant
une société différenciée selon des critères économiques
(producteurs, salariés, rentiers) ou politiques (citoyens,
propriétaires, locataires).
II.2.1 LA SPONTANÉITÉ
RÉVOLUTIONNAIRE
La
spontanéité des soulèvements - ce coup
de tonnerre dans un ciel serein -,
son imprévisibilité, son improvisation même, sa charge émotive de
fureur et d’enthousiasme énergique, galvanisant jusqu’à la
partie la plus paisible et la plus passive de la population, la
bourgeoisie, voilà ce qui marque l’imagination des contemporains
comme des historiens. L’imaginaire de la Révolution, c’est
d’abord cela : le soulèvement populaire déclenché furioso.
Les épisodes du massacre
de Boston (5
mars 1770) et de la plus célèbre Boston
Tea Party (16
décembre 1773), à l’origine de la Révolution américaine,
impressionnaient déjà les contemporains des deux continents. Dans
le premier cas, il ne s’agissait pourtant rien de plus qu'«un
malheureux concours de circonstances»
(les officiers britanniques tirèrent du fusil sur une foule qui leur
lançait des boules de neige; une sorte d’Intifada
avant
la lettre), alors que dans le second, il y alla déjà «d’une
manifestation de violence savamment organisée».1
L’effet ne s’en révélait pas moins accompli sur les
imaginations que maintiendra une historiographie patriotique, y
ajoutant des épisodes héroïques, telle la chevauchée de Paul
Revere et la bataille de Bunker Hill. La spontanéité
révolutionnaire portait
en elle la fraîcheur du geste collectif improvisé, non orientée,
qui tranche sur le cours ultérieur de la révolution, cours assumé
par les professionnels
de
la révolution. Nous la saisissons toujours comme l’aube, le matin
prometteur d’une journée ensoleillée, la naissance d’un monde
nouveau ou la renaissance d’un monde ancien transformé que
traduira la rhétorique de la régénération ou de l’homme
nouveau. Même les opposants à la révolution étaient obligés de
le constater : «Le
contre-révolutionnaire Mallet du Pan reconnaît que toute révolution
exige de l’enthousiasme et que la démocratie, née de la
révolution, “électrise le plus fortement et généralise le plus
vite les passions”. Personne ne le conteste en 1793. “S’il n’y
avait pas eu des hommes ardents, si le peuple lui-même n’avait pas
été violent, il n’y aurait pas eu de révolution”, affirme
Danton, qui ajoute : “Il faut de l’exaltation pour fonder les
Républiques”. Barnave n’est pas moins affirmatif. “La
République, dit-il, subsiste par les passions du cœur, et les
Français ne connaissent que les passions de la tête.” Il
explique, ou croit expliquer ainsi, pourquoi la Révolution française
finit par aboutir à la République, et que cette république ne peut
se maintenir».2
Étudiant
la prise de la Bastille, Jacques Godechot observe que «le
rassemblement révolutionnaire peut avoir une efficacité qu’il
était difficile aux spécialistes du maintien de l’ordre de
soupçonner. En cas de succès, les membres du rassemblement se
sentent solidaires, ils ont tendance à former entre eux des
associations permanentes pour maintenir les résultats qu’ils ont
obtenus. Ainsi, du rassemblement révolutionnaire occasionnel,
passe-t-on à la révolte organisée».3
Il décrit ainsi le processus révolutionnaire de base le plus
simple. La spontanéité doit être organisée, mais avant de se
demander par qui, il faut bien voir combien elle marque l’impression
de violence de tout mouvement révolutionnaire, presque autant que la
violence institutionnalisée (la Terreur). Elle étonne même les
parisiens, qui «passaient
pour une population douce, amollie,
bonne enfant.
Que ce peuple devint tout à coup une armée aguerrie, rien n’était
moins vraisemblable»,4
aime à s’étonner Michelet. Il évite pourtant de sombrer dans la
nécrose dans laquelle sombrera Taine et son école, pour qui ces
Parisiens en colère n'étaient qu’un ramassis d’ivrognes et de
brigands. Bien au contraire, et c’est là toute la force de
l’historiographie de Michelet, d’avoir su magnifier, selon le ton
romantique si cher à Victor Hugo, ce peuple en colère; d’avoir su
résister à l’impression première de violence déchaînée pour
conserver au peuple, au détriment même de ses meneurs, la part
déterminante de l’intrigue révolutionnaire. Dans la Préface
(1847) de son Histoire
de la Révolution, il
tient à le souligner formellement à l’esprit de ses lecteurs qui
ne s’en apercevrait pas : «Une
autre chose que cette histoire mettra en grande lumière et qui est
vraie de tout parti, c’est que le peuple valait généralement
beaucoup mieux que ses meneurs. Plus j’ai creusé, plus j’ai
trouvé que le meilleur était dessous, dans les profondeurs
obscures. J’ai vu aussi que ces parleurs brillants, puissants, qui
ont exprimé la pensée des masses, passent à tort pour le seuls
acteurs. Ils ont reçu l’impulsion bien plus qu’ils ne l’ont
donnée. L’acteur principal est le peuple. Pour le retrouver,
celui-ci, le replacer dans son rôle, j’ai dû ramener à leurs
proportions les ambitieuses marionnettes dont il a tiré les fils, et
dans lesquelles, jusqu’ici, on croyait voir, on cherchait le jeu
savant de l’histoire. Ce spectacle, je dois l’avouer, m’a
frappé moi-même d’étonnement. À mesure que je suis entré
profondément dans cette étude, j’ai vu que les chefs de parti,
les héros de l’histoire convenue, avait ni prévu, ni préparé,
qu’ils n’ont eu l’initiative d’aucune des grandes choses,
d’aucune spécialement de celles qui furent l’œuvre unanime du
peuple au début de la Révolution. Laissé à lui-même, dans ces
moments décisifs, par ses prétendus meneurs, il a trouvé ce qu’il
fallait faire et l’a accompli. Grandes et surprenantes choses!».5
Chaque fois pourtant que Michelet aurait pu se trouver en présence
de la spontanéité
populaire,
que ce soit lors des terribles journées de Juin 1848 ou de l’affreux
épisode de la Commune de Paris de 1871, à la fin de sa vie, il
avait toujours cette chance de se trouver à l’extérieur de la
capitale.
Taine,
lui, fut autrement traumatisé et sa peur transformée en névrose
obsessionnelle le porta à écrire d’horribles choses sur ce peuple
devenu soudain foules bestiales et démentes. Moins hystériques mais
non moins hargneux, ses héritiers menés par Jacques Bainville
(1879-1936), réduisent l’ampleur des soulèvements et des journées
révolutionnaires à «de
petites affaires de quartier, qu’avec un peu de méthode, d’adresse
et d’énergie, il était possible de mettre les émeutiers en
échec».6
Pour Pierre Gaxotte (1895-1982), il s’agit avant tout, tel le coup
d’État de Brumaire, «comme
toutes les entreprises humaines, qu’une suite de hasards,
d’incertitudes et de volontés contraires».7
Observations que leurs cousins furetiens confirment lorsque le choix
de la Bastille, dans le livre de Furet et Richet, apparaît comme un
objectif spontané et improvisé.8
Les
études de George Rudé sur les foules révolutionnaires ont fini par
mettre des noms sur ces émeutiers et, loin d’être ces ivrognes de
Taine ou cette richesse
de cœur dont
parle Michelet,
ils se sont avérés d’honnêtes pères de famille, plutôt issus
de la petite bourgeoisie, accompagnés de travailleurs et de paysans
formant la masse de la société. Dans Histoire
et conscience de classe, le
théoricien marxiste hongrois Georges Luckács, un authentique
professionnel de la révolution celui-ci, essaie de situer la place
de la spontanéité révolutionnaire dans une société industrielle
où la ligne de partage entre bourgeoisie et prolétariat est plus
nette qu’à la fin du XVIIIe siècle : «Situant
la spontanéité au niveau des “luttes et des misères élémentaires
des masses”, il la montre à l’œuvre dans la constitution des
prolétaires en classe, au travers d’une “lutte sociale
incessante, commençant par les actes spontanés et inconscients de
défense désespérée et immédiate”
[…] Lukács
débouche presque aussitôt sur le problème de l’organisation
révolutionnaire, trop souvent opposée, à tort, à la spontanéité
: le parti révolutionnaire “organise” moins la révolution qu’il
ne la révèle à elle-même; parfois “à la traîne” dans ses
mots d’ordre et ses plans d’action par rapport à la “spontanéité
agissante” des masses, il est, du moins, le lieu organisé de leur
“confiance” - “par le sentiment des masses que le parti est
l’objectivation de leur volonté la plus intime, quoique pas encore
entièrement claire pour elles-mêmes, la forme visible et organisée
de leur conscience de classe”».9
De cette théorie, le sociologue Decouflé identifie deux niveaux de
la spontanéité populaire : «A)
À un premier niveau d’immédiateté et de quotidienneté, la
spontanéité collective peut apparaître comme “l’effervescence
sociale” en actes, si souvent invoquée par les sociologues.
L’observateur dénué de présupposés partisans enregistre un
nombre considérable de mouvements révolutionnaires qui apparaissent
brusquement, sans préparation ou prélude particuliers, et, ce qui
est plus singulier encore sans leaders. B) À un second niveau, qui
ressortit tout à la fois au quotidien et à la durée
révolutionnaire, la spontanéité collective s’apprécie, en
effet, en termes de capacité à engendrer des formes spécifiques
d’organisation…».10
II.2.2 LES CORPS
RÉVOLUTIONNAIRES
Si
la spontanéité révolutionnaire est cet accident impromptu de
l’histoire que se plaisent à dénoncer Bainville ou à théoriser
Lukács, l’organisation, elle, est dans un rapport de nécessité
historique avec la continuité de la révolte en révolution. Elle en
marque la fin dans la mesure où l’organisation tue la spontanéité
et la prolonge à la fois; lorsqu’il s’agit de mettre de la
consistance idéologique à une flambée émotionnelle. Ici, les
interprétations divergent au point qu'elles ne cesseront de
s’éloigner les unes des autres. Commandée par son option
idéologique réactionnaire et monarchiste, pour Bainville, les corps
révolutionnaires ne font que poursuivre l’improvisation de
l’émeute. Ainsi, «l’extrême
confusion de cette période montre plutôt que les hommes de la
Révolution prenaient des décisions de circonstances».11
C’est là une position extrême que peu d’historiens oseront
retenir; elle parasite pourtant bien d’autres interprétations qui
tiennent l’organisation des corps révolutionnaires comme
essentielle à nourrir l’émeute d’idéologies politiques
justificatives ou de praxis
stratégiques
opportunistes. Pour Denis Lacorne, l’interprétation de la
Révolution américaine de Boorstin suivrait une logique historique
pas très différente de celle de Bainville : «Boorstin,
comme les historiens progressistes avec qui il est pourtant en
désaccord profond, accorde peu de poids aux idéologies. Il croit au
caractère profondément amoral et irréfléchi de l’entreprise de
rénovation politique des Fondateurs. Rien, d’après lui, n’a été
sciemment voulu par les Framers
dont le projet de constitution n’était que le fruit du hasard, le
produit de “la force des circonstances” ou encore le résultat
“d’opportunités heureuses”. tout est affaire d’opportunisme
dans la révolution américaine, à tel point que les “hommes de la
liberté” ne sont jamais en mesure de développer une philosophie
de la vie qui soit véritablement la leur, autonome, critique et
réflexive. L’Américain ne se pense pas, il se pense à travers
les plaisirs de la vie; il s’adapte aux circonstances et il attend
toujours que du jeu des passions qui règle sa vie quotidienne
surgisse comme par enchantement le bien public. En réaliste, il est
incapable de distinguer “ce qui est” de “ce qui doit être”.
Indifférent aux idées, incapable de définir une quelconque sagesse
politique, l’Américain peut tout exporter sauf un message
politique. C’est pourquoi l’Amérique n’a jamais su produire de
philosophes de la stature d’un Hobbes ou d’un Rousseau. Et
puisque tout se réduit à des questions constitutionnelles,
l’Amérique est le pays où “les avocats prennent la place des
philosophes”.
[…] [Il] voit
là la marque de l’inimitable génie du peuple américain : son
pragmatisme, une capacité exceptionnelle à adapter ses institutions
aux circonstances, à faire coller ses idées aux faits, à mouler
littéralement l’État sur les formes de la société civile. S’il
y a une sagesse américaine, elle consiste à “s’en remettre aux
faits de la vie”, à laisser évoluer les institutions “selon les
besoins de l’environnement” et surtout à éviter les idéologies,
c’est-à-dire, “les imbécillités, divagations et
[autres] délires
cosmiques”. Le génie des révolutionnaires américains, d’après
Boorstin, c’est leur médiocrité. En rabattant leur idéal
politique sur leurs intérêts privés, les Fondateurs réussissaient
à s’effacer de l’histoire, ils faisaient de l’histoire, leur
histoire, un procès sans sujets».12
De
l’opportunisme à la corruption, le pas est vite franchi, …et
voici la démocratie jacksonienne qui pointe à l’horizon, celle
que Tocqueville observe lors de son célèbre voyage. L’opportunisme
politique, c’est la suite normale d’une émeute qui se transforme
au gré des hasards et se voit rapidement provoqué
par des personnalités ou des organismes qui la récupèrent à des
fins particulières. C’est ensuite que la récupération se
transforme en pure corruption. L’organisation révolutionnaire vise
précisément à éviter ce détournement mais finit fatalement par y
succomber. L’émeute spontanée cesse d’être rébellion ou
vandalisme pour devenir opération politique concertée. Le processus
américain décrit par Boorstin nous montre comment les Framers
ont
évacué la démocratie directe pour passer directement à un
gouvernement civil conservateur. En France, les Constituants de 1789
se sont montrés plus idéalistes, moins opportunistes et aussi,
moins paresseux - c’est là le plus bel hommage qu’on puisse leur
rendre - et, de 1790 à 1791, ont discuté des formes du gouvernement
à la fois démocratique et conservateur mais sans l’écarter des
désirs de la foule manifestant au 14 Juillet : «Ces
luttes opposaient, sur le plan des principes, la théorie du
gouvernement représentatif et la doctrine de la démocratie directe.
Celle-ci fut en partie élaborée et diffusée par les dirigeants des
cordeliers, qui créèrent alors les points principaux de la future
idéologie de l’an II : souveraineté de la section, rappel des
députés, solidarité des sections, droit d’insurrection, droit de
référendum, responsabilité des représentants afin qu’ils
n’usurpent pas la souveraineté populaire, symbolisme de l’œil
de surveillance circonscrit dans le triangle maçonnique».13
Les
débats de la Constituante n’ont pu empêcher la spontanéité
révolutionnaire de se radicaliser par le soin des corps
intermédiaires qui entravèrent ainsi la consolidation d’un
gouvernement, ce que révèle l’échec déplorable de la
Législative en 1792. À vrai dire, la dynamique de l’histoire
était du côté de la démocratie directe, et cela dès les
lendemains du 14 juillet 1789. La convocation des États généraux
avait amené l’organisation de 60 districts électoraux créés par
le règlement royal du 13 avril 1789 et réorganisés par la loi
municipale du 21 mai-27 juin 1790 qui ramenait les districts au
nombre de 48. C’est cette subdivision de Paris en 60 bureaux de
vote qui, «à
l’origine, devaient se réunir une seule et unique fois, fut rendu
permanente
[…] :
À la veille du 10 août 1792, les sections arrachèrent à
l’Assemblée le droit de se réunir en permanence; et après le 10
août, non plus seulement ceux qui payaient un “cens” mais tous
les citoyens y furent admis»,14
jusqu’à ce que les 48 sections de Paris disparaissent le 19
Vendémiaire an IV. La constitution de la Commune insurrectionnelle
de Paris au soir du 9 août 1792 fut le corps révolutionnaire
intermédiaire le plus important entre les sections et les clubs (des
Jacobins, des Feuillants ou des Cordeliers) et le gouvernement
révolutionnaire (la Législative et la Convention). C’est sa mise
à mort, avec le 9 Thermidor an II, qui fait de la chute de
Robespierre le point ultime de l’action spontanée des masses ne
laissant dans sa queue que quelques mouvements déjà condamnés à
l'échec (l'émeute de Prairial, la conjuration des Égaux, la
conspiration des poignards).
Aux
organismes institués par les gouvernements s’ajoutent donc ces
nouveaux corps démocratiques autonomes, créés sur l’initiative
populaire «(devant
le “péril” contre-révolutionnaire, et, parfois, “au milieu de
scènes de violence”), dans leur organisation improvisée (qui
repose, pour l’essentiel, sur la présence en leur sein de
“sans-culottes éprouvés”), enfin dans leurs compétences
indifférenciées : “organisations de combat contre les modérés”,
ils sont aussi corps d’administration parallèle (surveillance des
étrangers, délivrance des cartes civiques” destinées à
dénombrer les vrais “patriotes”, arrestation “de toutes
personnes trouvées sans cocardes” tricolores, et aussitôt
soupçonnées de menées contre-révolutionnaires, etc.)».15
La spontanéité populaire passe alors dans l’activité de ces
sections et des clubs militants. «À
Paris, A. Soboul estime à 8 ou 9% en moyenne le taux des Parisiens
adultes qui fréquentent les sections entre 1792 et 1793. Un taux qui
s’abaisse rarement au-dessous des 5%, mais ne dépasse jamais 20%
[…] [D]ans
sa phase la plus active, la Révolution a été l’affaire d’un
sur dix des adultes urbains. Mais à bien y réfléchir; n’est-ce
point là un taux de politisation qui n’a rien de médiocre?».16
Les sections, qui servirent de trait-d’union entre la Commune
insurrectionnelle (1792) et le gouvernement révolutionnaire (le
Comité de salut public), s’imposèrent un encadrement qui devait
assurer l’efficacité de la Révolution. Robespierre fixait aux
sections patriotiques trois objectifs : discuter les lois à faire,
s’éclairer sur les lois qui sont faites, surveiller tous les
fonctionnaires publiques. C’était là sa façon d’encourager la
démocratie directe sans mettre le gouvernement à la merci des
caprices du peuple. Cette surveillance étroite et cette critique
politique des sectionnaires étaient tout ce qu’il y avait de plus
sérieux : «Disposant
de la force armée et nommant leurs officiers, s’administrant
elles-mêmes, élisant leurs magistrats et leurs comités, les
sections constituèrent alors à l’intérieur de la capitale autant
d’organismes autonomes. Par la correspondance en temps normal, en
période de crise par la fraternisation, les organisations
sectionnaires tendaient à l’unification du mouvement populaire
[…]. Porté
au pouvoir pour assurer la défense nationale et le salut de la
révolution bourgeoise, le comité de salut public ne pouvait
longtemps tolérer l’existence d’un mouvement populaire échappant
à son contrôle».17
Pour
les historiens contre-révolutionnaires, ces corps sont des parasites
du gouvernement, même révolutionnaire. Ils perpétuent cet
anarchisme chronique propre à l’insurrection populaire. Leurs
principales activités consistent à discourir, à envenimer les
débats, à énerver le gouvernement : «L’activité
révolutionnaire par excellence, rappelle
Furet,
tient dans la production de la parole maximaliste, par
l’intermédiaire d’assemblées unanimes mythiquement investies de
la volonté générale. À cet égard, toute l’histoire de la
Révolution est marquée par une dichotomie fondamentale. Les députés
font des lois au nom du peuple, qu’ils sont censés représenter;
mais les hommes des sections et des clubs,
figurent
le peuple, sentinelles vigilantes chargées de traquer et de dénoncer
tout écart entre l’action et les valeurs, et de réinstituer, à
chaque instant, le corps politique. La période qui va de mai-juin
1789 au 9 Thermidor 94 n’est pas caractérisée, du point de vue
intérieur, par le conflit entre la Révolution et la
Contre-Révolution, mais par la lutte entre les représentants des
Assemblées successives et les militants des clubs pour occuper cette
position symbolique dominante qu’est la volonté du peuple».18
Pour Furet et Richet, les beaux-frères,
les corps révolutionnaires entretiennent les illusions
qui
obligent les politiques gouvernementales à toujours se radicaliser
davantage et à converger vers le totalitarisme (la Terreur). Ils
travailleraient à créer un unanimisme politique et social à tout
prix (c'est ici qu'on pressent le jugement de Tocqueville sur le
despotisme
à
la manière américaine),
se sentant défaillant et menacés par les menées
contre-révolutionnaires et l’indifférence du grand nombre, car
«plus
on se sent minoritaire, plus on tient à l’affirmation du
“consensus”, et finalement il y a transfert de l’impossible
persuasion à la possible coercition».19
La critique et la surveillance des sections ne sont pas des fantasmes
des historiens de droite, là encore Mathiez le confirme à propos de
l’assaut des Tuileries : «l’insurrection
du 10 août, toute différente des précédentes, n’a pas été
seulement dirigée contre le trône. Elle a été un acte de défense
et de menace contre l’Assemblée elle-même qui vient d’absoudre
le général factieux Lafayette et qui a désavoué formellement les
pétitions pour la déchéance. Une situation nouvelle a été créée.
Un pouvoir révolutionnaire est apparu en face du pouvoir légal…».20
Mais quand le radicalisme s’en prend à la portion libérale et
grande bourgeoise de la Convention, c’est-à-dire lors du coup de
force des 31 Mai-2 Juin 1793, la menace de Mathiez se transforme en
profanation pure et simple de la représentation démocratique : «le
2 juin porte un coup très grave au parlementarisme. Malgré Danton
et la plupart des Montagnards, la Convention n’a pas subi seulement
l’“insurrection morale” dont parlait Robespierre, elle s’est
trouvée matériellement prisonnière; pour la première fois, la
force armée s’est tournée contre la représentation nationale, et
peu importe que cette force soit plébéienne avant d’être
prétorienne! Le mécanisme déclenché le 2 juin contient en lui,
comme l’a compris Michelet, “et Fructidor et Brumaire”. En ce
sens, ce ne fut pas seulement une défaite de la Gironde, mais une
défaite de la Révolution».21
Pour Furet, cette profanation de la représentation nationale est
pire que le renversement du Roi : «Scène
capitale, où se joue pour la première fois avec une netteté
d’épure le face à face de la représentation nationale et de la
démocratie directe, incarnée dans la force brute du petit peuple et
de ses canons. La représentation cède-t-elle à la force ou au
peuple constituant? Aux deux à la fois : si elle n’a pas d’autres
choix, dans l’instant, que de s’incliner devant l’artillerie
d’Hanriot, elle a aussi une légitimité trop récente et trop
fragile pour donner le poids nécessaire au sentiment d’obéissance
à la loi. Née le 10 août, qui a brisé la Constitution de 1791,
qu’a-t-elle de plus légitime que ce peuple qui l’a portée au
pouvoir?
[…] Ce
trait existait déjà dans la journée du 10 août, qui avait donné
congé à la fois au roi et à l’Assemblée législative. Mais il
était marqué que le renversement de la monarchie, terme véritable
de la victoire de la Révolution sur l’Ancien Régime. La prise des
Tuileries avait effacé la violence faite à l’Assemblée :
recommencement de ce que 1789 n’avait su faire jusqu’au bout,
elle pouvait se draper dans la légitimité de la Révolution et dans
son redoublement nécessaire. Mais moins d’un an après, le 2 juin
1793, il n’y a plus de roi à vaincre. C’est la Convention
elle-même, élue au suffrage universel, qui doit baisser son drapeau
devant les sections parisiennes et leurs canons. C’est la
représentation nationale qui est vaincue, elle qui est chargée de
faire la nouvelle Constitution de la République et qui vient de
commencer à en débattre. La Révolution n’a plus de fin dans la
loi…».22
Pour
un temps de son historiographie, c’est là que la Révolution
dérape.
Le
fait est loin d’être insignifiant. Mais bientôt, le gouvernement
révolutionnaire, amoindri ou contesté, ne s’en laissera plus
imposer. Les Enragés de Jacques Roux, de Varlet et de Leclerc, les
pétitionnaires de septembre 1793 s’en rendront vite compte avant
la fin de l’année, et surtout le club des Femmes Républicaines
révolutionnaires : «En
novembre 1793 les femmes ont été les premières victimes d’un
conflit où s’affrontaient deux conceptions irréductibles de la
vie politique : celles des Montagnards, ou des Jacobins, qui voulait
sauver à tout prix la légalité (fût celle de la Terreur), et
celle qui visait à la démocratie directe, appuyée sur les
organisations sectionnaires en particulier».23
Face à ces corps essentiellement populaires, on trouvait aussi des
corps révolutionnaires intermédiaires propres à la bourgeoisie :
les clubs et sociétés de pensée : «La
tradition révolutionnaire française pratique une catégorie
particulière de corps révolutionnaires, à la jointure des
“sociétés populaires” et des “comités insurrectionnels”:
les
clubs.
Ils se multiplient dès 1789, autour de sociétés pilotes :
Feuillants, Jacobins, Cordeliers. Ils réapparaissent en 1848 et en
1871. Le Club des Jacobins reste leur incarnation la plus fameuse. Né
en mai 1789, pendant la réunion des États généraux, d’un “Club
breton”, lui-même à l’origine simple mode commode de réunion
d’élus, il s’érige, dès novembre en institution permanente et
autonome par rapport à l’Assemblée constituante. Il établit
bientôt des liaisons régulières avec plusieurs “sociétés” de
province. Des motions sont élaborées et votées en son sein, puis
transmises à la Constituante qui les prend souvent pour fondement de
ses propres délibérations. Loin d’être un simple “groupe de
pression” comme le qualifierait une terminologie approximative, le
Club des Jacobins est à la fois le haut lieu de la vigilance
révolutionnaire, le réceptacle des discours sur la rigueur de la
révolution, le temple où les leaders reçoivent une consécration
indispensable à l’établissement de leur emprise sur le cours
profond de la révolution
[…]. Les
Jacobins sont aussi essentiellement, une assemblée parallèle de
“gérants” et une école de formation de futurs dirigeants. Ils
n’aspirent guère en revanche à constituer un corps proprement
populaire, et l’exaspération de la révolution mettra bien au jour
leur caractère fermé. Alors se constitueront, en 1793 surtout, des
clubs de recrutement beaucoup plus populaire, comme les Cordeliers,
que Jacques Roux, le “Curé rouge” qualifiera de “sentinelles
de la chose publique”, et qui inspireront certaines des mesures les
plus radicales de la terreur».24
Mais qu’importe l’issue du destin de ces corps révolutionnaires,
bourgeois ou populaires, ils marqueront pour toujours le processus
révolutionnaire dans l’imaginaire historique.
II.2.3 LE GOUVERNEMENT
RÉVOLUTIONNAIRE
Nous
voici à la troisième phase du rythme structurel des révolutions,
celle où la révolution triomphe en s’institutionnalisant : «Le
26 janvier 1794, écœuré de la Terreur, le Comité de Salut public
écrit à son “représentant en mission” dans le Calvados, dont
il craint les excès de zèle : “Il s’agit moins aujourd’hui de
révolutionner que de monter le gouvernement révolutionnaire.” La
formule est d’une force singulière, et caractérise assez bien le
destin de la révolution en voie d’institutionnalisation : devoir
se séparer d’elle-même, de la spontanéité populaire qui lui
donne sa légitimité et sa toute-puissance de souveraineté sauvage,
pour s’organiser en pouvoir apte à garantir survie et progression
du projet révolutionnaire. L’historien porte témoignage de
l’impuissance des processus d’institutionnalisation spontanée
(comités populaires… etc.) à éviter soit leur propre dissolution
dans une quotidienne anarchie (au sens propre du mot), soit leur
déviation, même si subsistent les appellations originaires, en
pouvoirs justiciables de l’analyse de sociologie politique la plus
classique : organes permanents dotés de l’appareil de la violence
organisée (contrainte) et l’exerçant tout à la fois contre leurs
mordants et contre leurs adversaires, dans le dessein conjoint de se
perpétuer eux-mêmes en tant que pouvoirs, jugés à leurs propres
yeux indispensables au triomphe de la révolution. De là que les
rigueurs du pouvoir révolutionnaire s’exercent sans répit ni
pitié contre les excroissances (spontanées ou provoquées) de la
révolution elle-même : nul groupe ni “faction du peuple” ne
peut se prétendre plus révolutionnaire que la révolution
officielle, et aucune révolte contre la révolution n’est
acceptable. La révolution est exclusive de la révolte à partir du
moment où elle se reconnaît elle-même comme révolution…».25
C’est
ici que l’urgence politique s’impose à la théorie des
révolutions. Un ordre doit s’imposer sur la spéculation et
l’expérimentation. Une hégémonie doit se réinstaurer :
«Therefore
the social consequences of a revolution are not necessarily shaped by
the conscious or unconscious desires of those who started it, but
more likely by the desires of those who come into control of it later
stages of its development».26
Dur
constat : toutes les attentes ne peuvent être comblées. Le
désenchantement de la Révolution y puise son amertume : «L’exercice
du pouvoir révolutionnaire a tôt fait de rompre le charme du rêve
de la révolution, celui d’un gouvernement à la fois rigoureux et
par où gouvernants et gouvernés ne se distingueraient plus,
confondus qu’ils seraient dans la totalisation du projet
révolutionnaire en actes».27
C’est le début de la défervescence, la phase thermidorienne selon
Brinton : «Tant
que les Assemblées s’appuient sur la force populaire, elles sont
actives et puissantes,
note Trahard;
lorsque, après le 9 Thermidor, un fossé se creuse entre le peuple
et la Convention déchue, la République entre en agonie et la
démocratie est menacée. La Révolution, qui a besoin du contact
étroit, permanent, avec le peuple, est à demi brisée».28
Pour Bainville, tout ce qui précédait cette chute de tension
n’avait été qu’une sombre manipulation machiavélique : tant
que «la
majorité avait besoin de la rue : elle laissa toujours des
possibilités à l’émeute».29
Pourtant,
nous sommes en plein cœur de la période épique de la Révolution,
l’an II. Jamais la Révolution n’ira plus loin sur la voie de
l’égalité sociale et de la démocratie directe. Jamais les
contradictions ne seront aussi plus aiguës, les factions
irréconciliables : «Le
problème était de savoir qui détiendrait le pouvoir. Les
sans-culottes - ou quelque soit le nom que nous choisissions de leur
donner - déclaraient exercer un pouvoir souverain au nom de la
“démocratie directe”. Les députés étaient de simples
mandataires, qui avaient des comptes à rendre en cette qualité.
Déclaration qu’ils étayèrent en exerçant effectivement le
pouvoir et en “légiférant” par le biais d’institutions qu’ils
avaient créées et qui n’étaient responsables ni devant le
gouvernement central ni devant les autorités qui en dépendaient».30
Ni les clubs, ni le gouvernement révolutionnaire ne survivront à
ces contradictions que Georges Lefebvre trace en une page condensée
: «Reste
à signaler l’aggravation, au cours de cette période, des
contradictions internes qui allaient contribuer si puissamment à
ruiner le gouvernement révolutionnaire. La majorité de la
Convention ne pardonna jamais aux Montagnards d’en avoir appelé
aux sans-culottes pour la contraindre, le 2 juin 1793, à exclure les
Girondins. Si elle consentait aux Comités une autorité sans cesse
croissante, aussi longtemps que la victoire demeurait incertaine, ce
n’était qu’à regret. Le pouvoir législatif ne voit jamais
l’exécutif amplifier ses attributions et son influence sans le
jalouser; à présent que les Comités disposaient de la “force
coactive”, ne maîtriseraient-ils pas l’assemblée par la
crainte, de telle sorte qu’ils se soustrairaient en fait à son
contrôle? L’exécution des Girondins laissa aux représentants une
seconde inquiétude : permettraient-ils qu’à l’avenir les
Comités fissent arrêter l’un d’eux pour exiger ensuite sa mise
en accusation sans que la Convention l’entendit et prit
connaissance du dossier? En brumaire, l’emprisonnement d’Osselin
avait provoqué une chaude escarmouche où le Comité de salut public
ne l’emporta pas sans peine. Ultérieurement, il ne rencontra plus
de résistance avouée : Delaunay, Chabot, Basire, un peu plus tard
Fabre d’Églantine, et finalement Danton et ses amis furent arrêtés
préventivement et décrétés d’accusation sans avoir été admis
à s’expliquer devant leurs collègues. Mais, dans une assemblée
ainsi décimée, la susceptibilité doctrinale céda la place au
souci de la sécurité personnelle…».31
De
l’été 1792 à l’été 1794, le sort de la Révolution (et des
révolutionnaires) se joua à travers de continuels affrontements que
tout livre racontant l’histoire de la Révolution énumère en
autant d’épisodes aux accents dramatiques, voire tragiques. Le
Gouvernement révolutionnaire a un but : canaliser tout mouvement
populaire spontané et tendant à l’anarchie vers l’encadrement
des lois et le respect des propriétés. Aux massacres improvisés
des prisons en septembre 1792, le gouvernement proposera la création
d’un tribunal révolutionnaire, le 10 mars 1793, et Danton de
proclamer : «Soyons
terribles pour empêcher le peuple de l’être!»
«Comme
toute autre pratique révolutionnaire, la terreur évolua, de 1789 à
1794, de la spontanéité populaire à l’institution, pour finir en
pratique gouvernementale et en violence d’État»,
note Soboul.32
D’où, la toute aussi célèbre réplique de Robespierre : «Si
le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le
ressort du gouvernement révolutionnaire est à la fois la terreur et
la vertu : “la vertu sans laquelle la terreur est funeste : la
terreur sans laquelle la vertu est impuissante…”».33
C’est-à-dire que «le
gouvernement révolutionnaire est un gouvernement de guerre : sa
théorie, selon Robespierre le 5 nivôse an II, est aussi neuve que
la révolution qui l’a amenée. Elle repose sur la distinction
entre constitution et révolution. “Le but du gouvernement
constitutionnel est de conserver la République; celui du
gouvernement révolutionnaire de la fonder…”
[…] Le
gouvernement révolutionnaire, plus actif dans sa marche, plus libre
dans ses mouvements que le gouvernement constitutionnel, en est-il
moins juste et moins légitime? “Non, répond Robespierre. Il est
appuyé sur la plus sainte de toutes les lois, le salut du peuple,
sur le plus irréfragable de tous les titres, la nécessité”».34
L’“utopie”
politique de Robespierre, si on peut dire, est d’en arriver à ce
qu’il conçoit comme un véritable gouvernement populaire issu de
la démocratie des corps intermédiaires, respectueux des lois et
règlements votés par les représentants de la démocratie élective;
une démocratie à partie double, l’une renforçant l’autre.
L’état de guerre justifie la praxis
du
gouvernement révolutionnaire jusqu’à la dictature, mais dictature
non pas d’un seul, despotique, mais de comités dont le personnel
est puisé à même la députation des représentants nationaux.
C’est ici que l’utopie se fait court-circuiter par le destin et
transforme l’enthousiasme révolutionnaire en tragédie. Le
dérapage
constaté
par Furet, le 2 Juin 1793, engagea la Convention à contenir son
pouvoir et à ne pas céder à la rue. «Durant
tout l’été 1793, la pression populaire se maintint. Poussée en
avant par leurs besoins et leurs haines, les masses parisiennes
imposèrent les grandes mesures de salut public, de la levée en
masse, le 23 août, au maximum général, le 29 septembre. Un
gouvernement révolutionnaire n’en parut que plus indispensable
pour discipliner la poussée populaire et maintenir l’équilibre
entre sans-culotterie et bourgeoisie montagnarde : sur cette double
base sociale s’édifia, de juillet à décembre 1793, la dictature
jacobine de salut public».35
Dès
le 5 septembre 1793, nous rappelle Furet, l’agitation parisienne
«veut
refaire le 2 juin».
Les sections armées encerclent à nouveau la convention pour exiger
la création d’une armée révolutionnaire de l’intérieur,
l’arrestation des suspects, l’épuration des Comités. La
Révolution est un théâtre où se rejoue sans cesse dans la rue
l’air du peuple souverain. C’est probablement la journée clef
dans la formation du gouvernement révolutionnaire : «la
Convention cède, mais garde le contrôle des événements. Elle met
la Terreur à l’ordre du jour le 5, élit le 6 Collot d’Herbois
et Billaud-Varenne au Comité de Salut public, crée le 9 l’armée
révolutionnaire, décrète le 11 le Maximum des grains et des
fourrages (et le Maximum général des prix et des salaires le 29),
réorganise le 14 le Tribunal révolutionnaire, vote le 17 la loi des
suspects et donne le 20 aux comités révolutionnaires locaux la
charge d’en dresser la liste. Mais en même temps, elle fait
arrêter les chefs des Enragés, Jacques Roux et Varlet : puisqu’elle
a endossé leur programme, elle leur a ôté ce qui faisait leur
force. Le “gouvernement révolutionnaire” naît ainsi d’une
institutionnalisation progressive mais rapide, par la Convention, des
principales exigences du mouvement sectionnaire».36
L’élimination des Enragés ne signifiait pas pour autant la fin de
la poussée populaire, bien que Robespierre en vint à juger
favorablement «la
nécessité d’associer étroitement les masses populaires au salut
de la République, par une politique sociale nouvelle»,37
il engagea la stratégie de récupération de l’automne 1793 et
reprise au printemps 1794 avec les fameux décret de Ventôse, ce qui
coupa l’herbe populaire sous le pied des hébertistes : «La
crise une fois dénouée et les dirigeants cordeliers éliminés, il
n’était plus question pour les Comités de donner satisfaction aux
revendications populaires : c’eût été aliéner au gouvernement
révolutionnaire cette fraction de la bourgeoisie pour qui les
marchés de guerre constituaient une source de profit, et ce au
moment même où les Comités révisaient dans un sens libéral leur
politique commerciale».38
De l’accident source de la spontanéité, nous voici prisonniers
maintenant d’un mécanisme irréversible qui oblige le gouvernement
à domestiquer
les
corps intermédiaires : «Le
décret du 14 frimaire
[4 décembre 1793] avait
consacré la mainmise du Comité de sûreté générale sur les
comités révolutionnaires : ceux-ci s’efforcèrent à leur tour de
se subordonner les assemblées de section. Afin de pourvoir aux
vacances, la pratique gouvernementale substitua en même temps à
l’élection par les assemblées, la nomination par le Conseil
général de la Commune. Ainsi disparaissait le droit des sections à
élire et à contrôler leurs commissaires et leurs représentants à
la commune. Les principes de la souveraineté populaire et des
pratiques de la démocratie directe étaient sacrifiés à la
centralisation et à l’efficacité gouvernementale».39
Le Comité de salut public retirait ainsi «aux
sections l’élection de leurs commissaires qui, maintenant salariés
et révocables par le gouvernement, se transformèrent de militants
en fonctionnaires dociles et conformistes, soucieux de conserver
l’avantage acquis. Il domestiqua les assemblées générales, il
contraignit les sociétés sectionnaires à se dissoudre. Évolution
inéluctable, inscrite dans la nécessité même de la lutte des
classes, et qui n’est pas spécifique de la révolution française
: de la spontanéité à l’institution, de l’institution à la
bureaucratie, bientôt à la sclérose. Mais, ce faisant, le
Gouvernement révolutionnaire à direction jacobine perdit la
confiance du mouvement populaire qui l’avait porté au pouvoir et
qui faisait sa force. Les cadres sectionnaires subsistèrent, mais
vidés de leur vigueur populaire; la centralisation jacobine
l’emporta sur l’autonomie sectionnaire. Mais, face à la réaction
impatiente, le jacobin pouvait-il se maintenir encore au pouvoir sans
l’appui des sans-culottes?».40
La contradiction eut donc une issue fatale, comme devait le démontrer
la chute des robespierristes qui marqua la fin de la Commune
insurrectionnelle comme la fin du groupe des hébertistes, en mars
1794, avait marqué la fin de la puissance sectionnaire : «Les
Comités n’avaient pas mesuré les conséquences politiques du
drame de germinal. Après les Enragés, le Père Duchesne et les
Cordeliers avaient été les véritables porte-parole de la
sans-culotterie : à voir condamner ces patriotes comme traîtres,
quel militant n’eût été désabusé et découragé? Déjà
hostiles à la dictature révolutionnaire du moment qu’ils ne
l’exerçaient pas eux-mêmes, les militants sectionnaires dès lors
s’en détournèrent. L’initiative populaire bannie, le
conformisme jacobin l’emporta. Mais la révolution se glaça, comme
le nota bientôt Saint-Just sur son carnet».41
Peu
d’historiens se sont penchés sur les mécanismes de cette tragédie
autant qu’Albert Soboul. Mathiez avait bien dégagé les jeux de
coulisses, le scandale de la Compagnie des Indes ou les magouilles
liées à la corruption ordinaire, mais avec les écrits de Soboul,
la tragédie sociale des contradictions esquissées plus haut par
Lefebvre, révèle toute sa dimension sociétale : «Si
le mouvement populaire avait été uni et s’était présenté comme
un bloc, il eût été difficile aux Comités de le freiner, puis de
le réduire: ils eussent dû s’incliner. Mais la masse des
sans-culottes demeurait souvent fort en arrière, sur le plan
politique, de ceux qui se voulaient ses chefs. Aventurés en
avant-garde, des hommes comme Jacques Roux, Leclerc ou Varlet,
beaucoup plus qu’Hébert si prudent, ne pouvaient que servir de
cible aux coups des autorités gouvernementales, soucieuses de ne pas
se laisser déborder et de maintenir le fragile équilibre social sur
lequel se fondait pièce à pièce le Gouvernement révolutionnaire.
Le Comité de salut public pour l’efficacité même de sa
politique, ne pouvait plus supporter ces mouvements
irréguliers,
entendons la poussée parfois désordonnée des masses. La logique
des événements l’amenait à maîtriser le mouvement populaire, ce
qui ne pouvait à la longue qu’entraîner la désaffection à
l’égard d’autorités peu respectueuses dela souveraineté telle
que l’entendaient les sans-culottes. Tragique contradiction, à
laquelle finira par succomber le Gouvernement révolutionnaire».42
Là
où Mahtiez faisait aboutir le drame à Thermidor, Soboul le remonte
quatre mois plus tôt, en mars; non pas que Hébert soit le héros
de
Soboul, comme Robespierre l’est pour Mathiez, mais plutôt qu’au
journaliste opportuniste, Soboul préfère un Ducroquet, humble
militant sectionnaire, commissaire attaché à l’approvisionnement
des quartiers de la capitale, puisque c’est à ce moment que la
partie révolutionnaire se joua… et se perdit : «c’est
dans les contradictions du mouvement révolutionnaire que
s’inscrivait la nécessité historique du 9 thermidor, comme dans
les contradictions de la sans-culotterie elle-même».43
L’élimination du personnel sectionnaire annonçait la chute du
gouvernement en passant par celle de la Commune insurrectionnelle
«tant
avait été poussée la domestication du personnel sectionnaire. La
pratique révolutionnaire, sur laquelle la Commune insurrectionnelle
fondait ses espoirs, était mise en échec par l’appareil
dictatorial qui se retournait finalement contre ceux-là mêmes qui
avaient tant contribué à le forger : le groupe robespierriste
appuyé sur les Jacobins».44
Il ne resta plus à Barère - et à Furet - à tirer la conclusion de
la suite des événements : «Dans
la proclamation de la Convention au peuple français lue par
l’inévitable Barère le 10 thermidor, et que célèbre la chute
des nouveaux “conspirateurs”, il y a une phrase qui n’a pas de
sens et qui pourtant dit tout : “Le 31 mai, le peuple fit sa
révolution; le 9 thermidor, la Convention nationale a fait la
sienne; la liberté a applaudi également à toutes les deux.” Que
s’était-il donc passé au 31 mai-2 juin? Un coup de force des
sections parisiennes armées contre la Convention, obligeant la
représentation nationale à s’amputer de vingt-neuf députés
girondins. Au contraire, et pour la première fois depuis juillet
1791, le 9 Thermidor est une victoire de l’Assemblée sur la rue
parisienne. Double victoire même, puisque les députés ont renversé
Robespierre, et qu’ils ont ensuite fait respecter leur décision
contre la Commune et ce qui reste de sans-culottes. La journée du
printemps 1793 et celle du 9 Thermidor 1794 ont en commun le recours
à la violence : dans les deux cas, un groupe de parlementaires est
arrêté, puis guillotiné. Pourtant, ils traduisent une rupture dans
l’histoire de la Révolution jusqu’au 31 mai-2 juin, la
Convention avait capitulé et qu’au 9 Thermidor elle a imposé sa
loi. C’est cette rupture que la proclamation de Barère cherche à
cacher, en étendant comme un voile la bénédiction commune de la
liberté aux deux événements de sens contraire».45
Sous un couvert analytique, on ne peut mieux distinguer les deux
tendances idéologiques de Furet et de Soboul, de la droite libérale
et de la gauche marxiste. Pour Furet, le dérapage
du
29 mai-2 juin consacre la logique des contingences menée par la
spontanéité révolutionnaire comme rupture de la continuité
normale (entendre : légale) de la Révolution;
pour Soboul, Thermidor est inscrit dans la logique de nécessité du
développement du gouvernement dans sa domestication
des
corps révolutionnaires intermédiaires. Pour Soboul, le coup du 29
mai-2 juin est en cohérence avec le mouvement populaire, tandis que
pour Furet, Thermidor appartient à la cohérence du gouvernement
révolutionnaire qui se cherche une voie de sortie dans la
stabilisation et la réaction.
Pourtant,
la Révolution n’en est pas arrivée encore à son ultime ressort.
La Convention thermidorienne va procéder à la répression populaire
sans pour autant apaiser les contradictions qui germent en son propre
sein et qu’elle léguera au régime suivant : «Sous
le Directoire, la République, n’ayant plus le soutien armé du
peuple de Paris, qu’on a réduit à l’impuissance, devra avoir
recours à un coup d’État (le 18 fructidor) pour triompher d’une
majorité de royalistes dans les deux Conseils, [coup
d’État qui] a
été fait avec l’aide de l’armée, et notamment de Bonaparte. On
glisse donc pas à pas vers le césarisme…».46
Et Furet de reprendre encore une fois : «Comme
le 2 juin 1793, le l8 fructidor an V (1797) est un coup d’État
antiparlementaire, une épuration de la représentation du peuple au
nom du salut public. Comme le 2 juin, l’opération s’accompagne -
sur le mode mineur - de la Terreur révolutionnaire. La différence
principale tient à ce que, dans le rôle de bras séculier de la
Révolution, les sans-culottes ont été remplacés par l’armée.
Barras et Reubell triomphent, mais en débiteurs des généraux».47
La notion de dérapage
finit
par devenir,
chez Furet, une explication de caractère aussi moniste que celle de
nécessité chez Soboul. Quoi qu’il en soit, avec le dernier coup
d’État, celui de Brumaire, le cycle est accompli, l’ordre
césarien instauré. Malgré l’aspect navrant de la faillite de la
spontanéité populaire dans sa contradiction avec le gouvernement
révolutionnaire, l’issue de la Révolution aboutit à un régime
nouveau au profit de la classe sociale manipulatrice
de la Révolution : la bourgeoisie. Gramsci, le théoricien marxiste
italien (1891-1937), reconnaît que les Jacobins ne «se
contentèrent pas de faire de la bourgeoisie une classe dominante
(élément de la force, fonction de commandement), ils firent plus,
ils créèrent l’État bourgeois, ils firent de la bourgeoisie la
classe nationale dirigeante, hégémonique; en d’autres termes, ils
donnèrent à l’État nouveau une base permanente; ils créèrent
l’unité compacte de la nation française moderne».48
Qu’importe si ce gouvernement se présentait finalement sous la
forme d’une dictature militaire ou d’une République démocratique
comme le souhaitait Robespierre, la bourgeoisie française
s’accommoderait de n’importe quel régime qui lui assurait le
contrôle de l’État. En quelques lignes, Decouflé résume ainsi
la problématique : «Le
pouvoir révolutionnaire pratique inéluctablement la
dictature du Salut public,
à la recherche de son dessein obstiné. On touche ici à un des
déchirements les plus vains et les plus profonds à la fois qui
soient susceptibles d’agiter les “gérants” d’une révolution
triomphante : vains, car l’histoire
[…] n’offre
point d’exemple d’une spontanéité se suffisant à elle-même,
et capable de nourrir longtemps une révolution quotidiennement
recréée. Profonds, tant il est évident qu’en confiant sa cause à
des gérants, dotés de l’appareil de la contrainte, une révolution
court le risque de se renier jusque dans son projet».49
Le
tragique consiste à reconnaître qu'en
entrant en révolution, on s'achemine toujours vers une impasse.
3
J. Godechot. op. cit. 1965, p. 22.
4
J. Michelet. op. cit. 1963, p. 427.
5
J. Michelet. Histoire
de la Révolution française, t. 1, Paris,
Robert Laffont, Col. Bouquins, 1979, pp. 37-38.
6
J. Bainville. op. cit. p. 326.
7
P. Gaxotte. op. cit. p. 497.
8
F. Furet et D. Richet. op. cit. p. 82.
9
A. Decouflé. op. cit. pp. 68-69.
10
A. Decouflé. ibid. p. 77.
11
J. Bainville. op. cit. p. 319.
12
D. Lacorne. L’invention
de la république, Paris, Hachette,
Col. Pluriel, # 8569, 1991, pp. 234-235.
13
J. Solé. op. cit. p. 125.
15
A. Decouflé. op. cit. pp. 78-79.
17
A. Soboul. op. cit. 1988, p. 244.
18
F. Furet. op. cit. 1978, p. 87.
19
F. Furet et D. Richet. op. cit. p. 207.
20
A. Mathiez op. cit. 1922-1924, p. 209.
21
F. Furet et D. Richet. op cit. p. 202.
22
F. Furet. op. cit. t. 1, pp. 220-221.
23
P.-M. Duhet. Les
femmes de la Révolution 1789-1794,
Paris, Julliard, Col. Archives, # 41, 1971, p. 163.
24
A. Decouflé. op. cit. p. 79.
25
A. Decouflé. op. cit. pp. 99-100.
26
J. F. Jameson. op. cit. p. 12.
27
A. Decouflé. op. cit. p. 102.
28
P. Trahard. op. cit. p. 58.
29
J. Bainville. op. cit. p. 294.
32
A. Soboul. op. cit. 1988, p. 305.
33
A. Soboul. ibid. p. 301.
34
A. Soboul. ibid. pp. 299 et 300.
35
A. Soboul. ibid. p. 260.
36
F. Furet. op. cit. t. 1, pp. 229-230.
37
A. Soboul. op. cit. 1988, p. 115.
39
A. Soboul. op. cit. 1973, p. 250.
40
A. Soboul. op. cit. 1988, p. 244.
41
A. Soboul. Ibid. p. 299.
42
A. Soboul. op. cit. 1973, p. 163.
43
A. Soboul. ibid. p. 487.
44
A. Soboul. ibid. p. 484.
45
F. Furet. op. cit. t. 1: pp. 269-270.
47
F. Furet. op. cit. p. 322.
48
Cité in J. Guilhaumou, in Dialectiques,
Histoire et société,
Paris, Université Paris X-Nanterre, # 10-11, s.d., p. 33.
49
A. Decouflé. op. cit. p. 100.
Jean-Paul Coupal.
La tourmente révolutionnaire, vol. 1.

La tourmente révolutionnaire, vol. 1.

(À gauche, soufflant le chaud, Jean-Paul Marat (1743-1793)
à droite, soufflant le froid, le poète André Chénier (1762-1794))
à droite, soufflant le froid, le poète André Chénier (1762-1794))
SIGNIFICATION
Jean-Paul Coupal.
IV.2
LOI DE LA THERMODYNAMIQUE RÉVOLUTIONNAIRE
Avec la
Révolution, nous passons du monde de la mécanique à celui de la
chimie. La métaphore a été retenue par les historiens, mais elle
est contemporaine des événements. L’un des périodiques du temps
ne se nommait-il pas Le
Thermomètre du jour,
qui donnait autant la température atmosphérique que politique? Et
l’historien Jean-Claude Bonnet, n’érige-t-il pas sa présentation
de Marat sur cette même métaphore calorifique? «L’Ami
du Peuple
est
une sorte de thermomètre fiévreux de la Révolution, où la
cyclothymie personnelle de l’auteur en ses éclipses et ses retours
indique les moments de crise ou d’assoupissement de l’opinion. Il
suffit que les ardeurs s’alanguissent pour que le journaliste boude
et disparaisse après avoir vitupéré les “badauds de Parisiens”,
confisquant ainsi sa précieuse personne».1
Métaphore facile mais qui prend un sens plus concret
si
l’on pense à la mélancolie consumant les nobles et les bourgeois
engoncés dans le désœuvrement où le mal
de vivre, la
Révolution s’achevant après un tour de 360° dans l’ennui de la
France des notables de l’Empire et de la Restauration. Mais, entre
les deux, une puissante flambée d’énergie. Un véritable bassin
d’émotions, de sentiments, d’idées et d’actions humaines. Le
sociologue Decouflé écrit : «Qu’un
corps social en mouvement porte en lui, en quelque sorte, ses
révolutions jusqu’au bout de son histoire paraît une proposition
acceptable au niveau d’une approximation préliminaire, et l’on
peut sans doute éclairer la distinction de Cl. Lévi-Strauss entre
sociétés “chaudes” et “froides” par l’élément, propre
aux secondes, de “non-révolutionnabilité” : elles ne sont guère
susceptibles de révolutions, parce qu’elles ne sont pas porteuses
de projet révolutionnaire. - Par opposition aux sociétés dites
“primitives”, “nos sociétés, déclare Lévi-Strauss
intériorisent, si l’on peut dire, l’histoire pour en faire le
moteur de leur développement”. G. Gurvitch s’exprimait de façon
analogue en opposant les sociétés “non prométhéennes et
prométhéennes” et caractérisait ces dernières, “pourvues
d’historicité”, par “une dialectique ouverte et consciente
entre tradition, réforme et révolution” (Déterminismes
sociaux et liberté humaine).
Ainsi projet révolutionnaire et conscience de sa propre historicité
vont-ils de pair : le projet révolutionnaire est souvenance et
reconquête d’une histoire».2
À
parcourir de très près la Révolution, de ses origines à ses
diverses fins possibles, il apparaît que le froid ne fut jamais si
froid ni le chaud jamais si chaud. La thermodynamique révolutionnaire
peut bien suivre les lois de la physique, mais elle était avant tout
liée aux lois humaines qui n’en avaient pas la constance. J.-J.
Chevalier dit de Mounier, qu’«il
a voulu souffler le froid après avoir soufflé le chaud».3
La phrase pourrait tout aussi bien s’appliquer à son héros,
Barnave, et de même à Mirabeau, à La Fayette, aux Girondins… et
même, peut-être, à Saint-Just, à la toute veille de Thermidor.
Seul Robespierre apparaît comme un constant souffleur de chaud sans
jamais se faire, comme Roux ou l’aile gauchisante de la Commune
exécutée avec Hébert, un incendiaire. Ce qui rend l’Ami
du Peuple si
«météorologique», c’est que Marat, précisément, était un
baromètre hypersensible aux variations atmosphériques qui
annonçaient l’approche d’une montée ou d’une baisse
calorifique : «Pour
conjurer la souffrance d’un mortel refroidissement de
l’enthousiasme et l’angoisse que la Révolution soit seulement
une crise passagère dont le ressort rapidement s’épuise et se
casse, il est nécessaire de toujours pousser les hauts cris et de
faire grand tapage».4
La thermodynamique révolutionnaire est liée à l’historicité, à
l'Imaginaire qui cherche le point de clôture de la Révolution.
Vouloir arrêter, terminer
la Révolution, c’est
vouloir passer du chaud au froid. La Révolution brûle, et elle
brûle cruellement. Elle était une veille météorologique appelée
à durer dix ans.
Les
courants forts de l’historiographie française ont su caractériser
en termes météorologiques d’orages
-
c’est-à-dire ses rencontres de courants d’air froid et d’air
chaud - les événements de la Révolution. 14 Juillet, 6 Octobre, 10
Août, 31 Mai-2 Juin, enfin 9 Thermidor et 18 Brumaire résonnent
comme des journées de haute instabilité atmosphérique. Tornades,
trombes, ouragans, cyclones, les phénomènes atmosphériques sont
nombreux à servir de métaphores météorologiques associant des
phénomènes naturels à une série d’événements humains. L’idée
n’a même plus besoin d’être nommée qu’elle hante toute
description serrée. Ainsi, la montée du courant chaud se reconnaît
dans cet extrait de Bainville : «Pour
se guider à travers ces événements enfin, il faut s’en tenir à
quelques idées simples et claires. Tout le monde sait que, jusqu’au
9 thermidor, les révolutionnaires les plus modérés, puis les moins
violents furent éliminés par les plus violents. Le mécanisme de
ces éliminations successives fut toujours le même. Il servit contre
les Constitutionnels, contre les Girondins, contre Danton. Le système
consistait à dominer la Commune de Paris, à s’en emparer, à
tenir les parties turbulentes de la capitale dans son exaltation
continuelle par l’action de la peur et des clubs et en jouant de
sentiments puissants comme la peur de la trahison et la peur de la
famine, par laquelle une grande ville s’émeut toujours, puis à
intimider par l’insurrection des assemblées remplies d’hommes
hésitants et faibles. La politique financière, la politique
religieuse, la politique étrangère des deux premières Assemblées,
la Constituante et la Législative, aidèrent singulièrement au
succès de cette démagogie qui triomphe sous la Convention».5
L’accélération était aussi perceptible pour nos
révolutionnaires, qui commencèrent très tôt à s’en inquiéter.
L’appel à la mobilisation et à la violence entraînait des actes
d’une ampleur toujours de plus en plus démesurée : «Dès
1790, Camille Desmoulins avait souligné ce risque et, fait
remarquable, il attirait déjà l’attention sur l’aspect
spectaculaire de l’exécution
[publique].
Marat venait d’énoncer le processus mécanique qui caractérisera,
bien plus tard, la Terreur : “Il y a six mois, cinq à six cents
têtes eurent suffi pour vous retirer de l’abîme. Aujourd’hui
que vous avez laisser stupidement vos ennemis implacables se mettre
en force, peut-être faudra-t-il en abattre cinq à six mille; mais
fallût-il en abattre vingt mille, il n’y a pas à hésiter un
instant.” Desmoulins réplique aussitôt : “Monsieur Marat
[ ] Vous
êtes le dramaturge des journalistes : les Danaïdes, les Barmécides
ne sont rien en comparaison de vos tragédies. Vous égorgez tous les
personnages de la pièce et jusqu’au souffleur; vous ignorez donc
que le tragique outré devient froid?” On pense ici à la fameuse
formule de Saint-Just selon laquelle “l’exercice de la Terreur a
blasé le crime, comme les liqueurs fortes blasent le palais”».6
On pourrait tout aussi bien penser à son apostrophe : «la
Révolution est glacée…»
Bien sûr, Bainville dresse un bilan alors que Desmoulins servait une
mise en garde. Mais cette phase ascendante de la Révolution, pour
les contemporains autant que pour les historiens (et surtout ceux de
la droite) restait un souffle chaud qui frôlait le torride. Si de
Bainville on passe à Soboul et de la phase ascendante à la phase
descendante de la Révolution, un changement de température se fait
aussitôt sentir : «La
dégénérescence du mouvement populaire était inscrite dans la
morale dialectique de l’histoire elle-même. Les grandes attaques
des Comités et le renforcement constant du Gouvernement
révolutionnaire, le drame de germinal et la désaffection qui
s’ensuivit ne peuvent expliquer à eux seuls l’affaiblissement du
mouvement populaire. Il devrait nécessairement s’apaiser : il
renforçait en se développant, puis en triomphant, les factures qui
finalement contribuèrent à sa ruine».7
Et quels sont ces facteurs pour l’historien marxiste? L’épuisement
physique des militants, la lassitude psychologique des tribuns,
l’effort de guerre quasi constant, la bureaucratisation des cadres
du gouvernement, bref tout ce qui, selon la loi de la
thermodynamique, ramène à un refroidissement de la participation
populaire, ce que Soboul, sur un modèle organiciste, assimile à la
dégénérescence.
Ces
poussées d’air frais (à tout le moins!) reviennent périodiquement
depuis les débuts de la Révolution, mais, après Thermidor an II,
ils se mettent à prendre de la vigueur, marquant l’automne de la
Révolution. Car il y a un rythme des saisons de la Révolution
française : de 1789 au 10 Août 1792, c’est le printemps, un très
long printemps de trois années; puis, jusqu’au 9 Thermidor an II,
pendant presque deux ans, c’est l’été de la Révolution; de là
jusqu’au 18 Brumaire an VIII, c’est ce long automne marqué
d’alternance de courants de moins en moins chauds (germinal et
prairial an III, la Conjuration de Babeuf…) et de plus en plus
froids (les coups d’État du Directoire, du Consulat…); enfin,
l’Empire correspond à peu près à l’hiver, sinon au début de
l’hiver révolutionnaire. La Restauration équivaut à une
véritable glaciation et la Monarchie de Juillet entraîne un léger
redoux; 1848 un été passager avant que le Second Empire ramène un
automne dont la Commune de Paris de 1871 agira comme un été de la
Saint-Martin. La cyclothymie des révolutionnaires se transposait
ainsi en cycle des saisons. Dès qu’arrivait un événement chargé
de sens et capable d’influer sur le cours atmosphérique de la
Révolution, chaud et froid réagissaient simultanément. S’agit-il
de la mutinerie des Suisses de Châteauvieux de la garnison de Nancy,
voilà les courants d’air qui s’élèvent (15 avril 1792). D’une
part André Chénier souffla le froid : toute mutinerie se doit
d’être réprimée et n’est rien de plus qu’une désobéissance
à l’ordre. Mais l’histrion Collot d’Herbois était là pour
souffler le chaud : «Rhéteurs
glacés, s’écrie-t-il, vous faites mine d’être moralistes et
sages : votre sagesse est celle des eunuques. […]
Mais,
au moins, André Chénier prosateur stérile, respecte le peuple
producteur et abondant. Au moment où ce bon peuple répare
d’incroyables cruautés, de fatales erreurs, au moment où il
épanche toute sa compassion, toute sa bienfaisance, tu te permets
d’appeler ces généreux mouvement, de
misérables orgies, de scandaleuses bacchanales.
Va, le peuple est plus sage que toi; il te méprise et te pardonne».8
Souffle
le chaud, souffle le froid. Chénier refroidit
l’événement;
Collot le réchauffe.
Associés
d’hier, les révolutionnaires se partageaient selon les montées et
les baisses de température pour se contrarier et ainsi nourrir la
turbulence révolutionnaire. Une véritable tempête émergeait du
flux schizophrénique.
Souffle
le chaud et l’historiographie froide - c’est-à-dire celle de la
droite - poursuit littérairement les affrontements devenus
classiques entre Mirabeau et Maury, Barnave et Cazalès, Montagnards
et Girondins ou même Hébert et Danton; à Soboul répond Furet…
Souffle le froid et l’historiographie chaude - c’est-à-dire
celle de la gauche – renverse l’affrontement entre Chénier et
Collot, entre Barnave et Brissot, entre Brissot et Robespierre, entre
le Directoire et Babeuf; à Taine réplique Jaurès… Déjà
Michelet se soulève contre les réactionnaires qui cherchent à
diminuer la force morale de la Convention : «Lâches!
osez me dire maintenant que les hommes qui moururent ainsi, dans
cette héroïque douceur, ont été des lâches, que la Convention a
eu peur».9
Un siècle après Michelet, défenseur de la thèse de la causalité
par la misère d’Ancien Régime, le marxiste Mathiez comme le
bainvillien Gaxotte répliquent a
contrario :
«Ce
n’est pas dans un pays épuisé, mais au contraire dans un pays
florissant, en plein essor, qu’éclatera la révolution. La misère
qui détermine parfois des émeutes, ne peut pas provoquer les grands
bouleversements sociaux. Ceux-ci naissent toujours du déséquilibre
des classes».10
On sait d'où vient cette thèse prise chez Tocqueville. Est-ce une
réconciliation de tendances ennemies contre une historiographie
rendue désuète par la recherche? Nenni. C’est l’alliance des
extrêmes contre la République établie qui, à travers Lavisse, a
officialisé
l’interprétation
de Michelet. La tourmente
révolutionnaire
se poursuit à coups de synthèses redoublées. N’est-ce pas
l’incohérence de toute action révolutionnaire que Gaxotte
vilipende lorsqu’il s’en prend aux mesures réformatrices de
Turgot : «Que
pouvaient penser les paysans qui avaient lu, à la porte de l’église,
les diatribes de Turgot contre la corvée, qui les avaient entendu
commenter au prône et à qui on annonçait, trois mois plus tard,
qu’en dépit de toutes les bonnes raisons, rien ne serait changé
et que la corvée continuerait à être perçue sous la même
forme?».11
Souffle le chaud révolutionnaire et l’historiographie froide,
réactionnaire, répond. La Convention n’était peut-être pas
faite de lâches, mais elle était violente : «Le
jour où les plus violents seraient maîtres de Paris et de sa
municipalité - de sa Commune, - ce jour-là, ils seraient les
maîtres du gouvernement. L’histoire, le mécanisme, la marche de
la Révolution jusqu’au 9 thermidor, tiennent dans ces quelques
mots».12
L’incendie de la Vendée glace encore Gaxotte : «La
commission Félix, qui oscillait entre Laval et Saumur, ne se donnait
même pas la peine de jouer la
comédie
d’un procès. Elle se bornait à recenser les détenus et à les
marquer comme un bétail. F signifiait “à fusiller”, G “à
guillotiner”. Sept cents victimes furent ainsi poussées au
supplice».13
Souffle
le froid et l’historiographie chaude˘se réchauffe. On l’a dit :
l’angoisse de sa fin accompagne la Révolution dès ses premiers
pas : «Toute
révolution est doublement compromise : faillite de l’espoir
qu’elle porte en elle et retournement en autorité
contre-révolutionnaire; excès immédiats, la pratique de la
violence créant une irrationalité destructrice aux dépens de la
rationalité rêvée. Le discours révolutionnaire est chargé de
nier ce drame, de combler cet abîme; il ne peut que se répéter,
et, se répétant, il se fige».14
Soboul a très bien identifié ce facteur de refroidissement;
l’épuisement de militantisme d’abord : «La
vie militante
[…],
ne pouvait qu’entraîner à la longue fatigue et usure. À ne
considérer que la révolution parisienne, la plupart des militants
sectionnaires étaient debout depuis le 14 juillet 1789; ils avaient
participé à toutes les insurrections, à tous les mouvements.
Depuis le 10 août 1792, leur activité s’était intensifiée.
L’excitation nerveuse des grandes journées fut relayée par
l’usure quotidienne de la vie militante. Cinq ans de luttes
révolutionnaires usèrent le personnel sectionnaire qui encadrait la
sans-culotterie parisienne. À cette lassitude physique qui amena à
diverses reprises les dirigeants de la révolution à se retirer de
la scène politique, ainsi Danton en frimaire et Robespierre en
messidor an II, les militants de base toujours sur la brèche ne
pouvaient échapper. Robespierre avait dit que, la guerre se
prolongeant, “le peuple se lasse”. La révolution populaire y
perdit de sa vigueur et de son mordant».15
À la lassitude des militants répond la dépression des chefs : «Au
moment où il allait toucher le but, le Gouvernement révolutionnaire
se disloque : sa chute était inscrite dans la marche dialectique de
l’histoire. Lassitude générale de la Terreur (“la nausée de
l’échafaud”), désaffection des masses populaires (“la
révolution est glacée”), opposition disparate des terroristes de
proie, des corrompus et des nouveaux Indulgents au cœur de la
Convention, rivalités des deux Comités de gouvernement, de salut
public et de sûreté générale, dissensions au sein même du Comité
de salut public, intransigeance de Robespierre se refusant à toute
concession : la crise se noua brusquement dans les premiers jours de
thermidor».16
Bien avant Robespierre, le cas du monarchien Mounier présentait tous
les symptômes du refroidissement
:
«Suivons,
fin juillet, début d’août [1789],
la courbe - descendante - de la vie politique de Mounier. Cet homme
de trente ans, soudain dégrisé, ayant perdu la ferveur, s’arrête,
fatigué, mécontent de lui et des autres, bientôt aigri, sur la
route de la Révolution. Route où galope de plus belle, cavalier
nerveux, fougueux, Barnave. Règle inflexible : quiconque, sur cette
route, cesse d’avancer, recule. En avant ou en arrière. Point de
place pour l’immobilité. La Révolution n’a pas le temps
d’attendre. Elle bouscule et meurtrit, jusqu’à ce qu’il marche
dans un sens ou dans l’autre, le voyageur las qui prétend faire
halte. Cette règle va jouer, dorénavant, pour Mounier».17
Elle va jouer, un an plus tard, pour les alliés du triumvirat
Barnave, Lameth, Duport : «“Il
ne s’agit plus d’acquérir la liberté mais de la conserver… et
si l’insurrection est nécessaire
quand
on veut renverser le despotisme, la paix ne l’est pas moins pour
maintenir un gouvernement libre”; c’est l’anarchie maintenant
qui ferait le jeu des ennemis de la Révolution; il faut absolument
respecter les biens et l’ordre constitutionnel. Voilà ce que
prêchent, dès octobre
[1790],
Barnave et Duport aux Jacobins de Paris et de province. Cela signifie
que ces Avancés,
à leur tour, songent à se
modérer».18
Elle apparaît inexorable au point que les révolutionnaires
tenteront souvent de souffler, en même temps mais non du même
endroit, le chaud et le froid : Mirabeau à la Cour et à
l’Assemblée, Danton à la Commune, puis à la Convention, après
la dénonciation de ses corruptions; même le Père
Duchesne, «tandis
qu’à la Commune, il s’employait à calmer les inquiétudes
populaires [,]
Hébert
contribuait dans son journal à ranimer l’extrémisme un moment
assoupi».19
Cette
dynamique orageuse entre les Patriotes et les Fripons, la vertu et la
corruption, la
Révolution et la Contre-Révolution, conduisit Saint-Just à
confirmer la mise en garde de Desmoulins : «La
Révolution est glacée, tous les principes sont affaiblis, il ne
reste que les bonnets rouges portés par l’intrigue. L’exercice
de la Terreur a blasé le crime comme les liqueurs fortes blasent le
palais».20
Et il ne faut pas trop se laisser impressionner par la fête
réactionnaire de Thermidor et les salons de Barras et d’Ouvrard :
«À
l’heure du peu vertueux Directoire, ses égéries, telles Madame
Tallien ou Mademoiselle Lange, se chargeront d’un érotisme plus
cérébral que charnel».21
Vivant dans le glacial révolutionnaire, il apparaît difficile de
passer, sans transition, à un érotisme torride nourri de
corruptions. Rappelant la finale d’une lettre du dramaturge
allemand Büchner à sa fiancée, Jean Duvignaud commente : «“…Mes
lèvres sont-elles si froides?” […]
une
certaine souffrance, une dépersonnalisation active; les héros
tragiques, eux aussi, se sentent saisis par une force inconnue, une
puissance qui les écrase, et les vide de leur substance dont le
principe réside dans l’élément concentrationnaire de l’existence
banale».22
On a
rarement vu une relation interactive aussi immédiate entre Histoire
et l’historiographie. Certes, l’historiographie se fait Histoire,
l’écrivant elle y participe. Mais le contexte révolutionnaire
anime une dynamique chimique qui se poursuit de l’action à
l’écriture par le billet de la mémoire et du militantisme.
Decouflé analyse subtilement ce point d’ancrage de
l’historiographie dans l’Histoire : «Ce
dont la révolution se souvient ne se distingue pas de ce à quoi
elle tend : sa mémoire n’est qu’une forme de sa création en
actes. Loin d’être, comme ceux du mythe, des êtres surnaturels
possesseurs et gardiens d’une tradition et d’un rite sacrés, ses
personnages sont des hommes placés dans la quotidienneté la plus
immédiate; et, si la révolution s’efforce, pour nourrir son
propre projet, de se donner à elle-même une tradition, celle-ci ne
repose pas sur un code de signes (livre ou chronique sainte), mais
sur ce que la sociologie peut caractériser comme une mémoire
collective vivante;
au-delà de ses res gestæ et même de ses martyrs, celle-ci opère
pour son compte dissolution de la structure temporelle de l’histoire
classique (qui ne reconnaît la révolution que comme une de ses
stratégies) et reconstruit une histoire plénière, se suffisant
entièrement à
elle-même
dès lors que non seulement elle ignore les servitudes de l’histoire
officielle, à commencer par les repères chronologiques, mais
surtout qu’elle est histoire du tout et non des parties, des hommes
en voie de repossession d’eux-mêmes et du monde par le double
effet de la maîtrise de leur propre passé et de la libre création
d’un quotidien désormais chargé de devenir».23
Le sens de l’histoire de la Révolution rattrape la crise de la
Réformation en relançant le temps de troubles qui annonce le déclin
de la civilisation. La Révolution sert de nœud entre la
repossession d’une historicité (totale et universelle dans
l’événement) malgré ses dysfonctions psychologiques et sociales
et l’élaboration d’une morale activiste (du devenir unitaire) de
l’Histoire. Le destin des acteurs historiques devient celui des
historiens et de ses lecteurs. C’est à une participation mystique
de l’Histoire que nous convie toute historiographie (de droite
comme de gauche) de la Révolution, seul le camp changeant selon
l’orientation idéologico-politique de l’historien.
Cette
participation mystique, on l’a reconnue chez Michelet, mais elle y
apparaît comme une expérience unique, réservée à une sensibilité
particulièrement affinée. Qui penserait reconnaître dans Les
Origines de la France contemporaine de
Taine une participation mystique à la Révolution? Pourtant, Jaurès,
Mathiez, Lefebvre, Soboul d’une part; Tocqueville, Taine, Gaxotte,
Furet de l’autre, pour être moins romantiques ou hypersensibles,
n’en font pas moins participer leurs lecteurs à cette mystique.
L’ont-ils hérité du pontife? Assurément pas. Ce qui rassemble
toutes ces sensibilités diverses, c’est qu’à un moment donné
de la vie, de leur vie respective, comme du grand courant de
l’histoire universelle depuis deux siècles, surgit le sentiment de
ce qu’on pourrait appeler, une situation
intolérable. Ce
que traduit la connaissance historique de la Révolution française -
et de toute révolution -, c’est cette situation
intolérable, préambule
au tragique de l’impuissance individuelle devant la condition
humaine révoltante. Un mot très fort des ouvriers de
Saint-Pétersbourg, aux lendemains du Dimanche
rouge de
janvier 1905, résume assez bien cette situation
intolérable :
«Ce
que nous demandons est peu de choses. Nous ne désirons que ce sans
quoi la vie n’est pas une vie, mais un bagne et une torture
infinie».24
Que d’occasions, privées ou collectives, nous heurtent au point de
crier : C’est
intolérable! Je n’en peux plus!
Souffrances bénignes toutefois face aux maux qu’endurent
l’humanité dans sa totalité, mais la conscience de soi ne peut
que réagir face à la condition générale de l’humanité. La
crise psychologique et morale endurée par les Occidentaux du second
XVIIIe siècle était pourtant déjà la nôtre, celle à laquelle
nous participons toujours et cette proximité, assumée par la
persistance de la mémoire, condense,
pour employer un terme psychanalytique, «l’état
d’âme»
de l’époque avec nos propres «états
d’âme».
R. Mauzi, dans son essai sur L’idée
de bonheur au XVIIIe siècle, écrit
ces mots justes : «Ces
différentes formes du malaise des âmes sont le signe d’une crise
profonde. Il se produit une dissociation entre l’existence et la
conscience. L’existence pure est mise à nu. Elle affleure par
larges plaques. Elle devient opaque, anarchique. La conscience ne
sait plus la prendre en charge, la couler dans une durée. Désarmée
devant elle, elle s’en détourne, la laissant émerger absurdement,
et va se fixer sur des phantasmes, qui manifestent, sans l’assouvir,
son désir de l’absolu. L’imagination, fonction régulatrice,
joue mal son rôle».25
La dérive psychologique rencontre ici la misère sociale qui lui
donne un contexte pour exprimer son mal de vivre.
Cette
rencontre est le carrefour giratoire entre la sympathie de
l’historiographie et la souffrance existentielle dans l’Histoire.
Quel historien ne rapporte pas l’étonnement du voyageur Arthur
Young lorsque, dans le courant de son voyage en France, près de
Metz, le 12 juillet 1789, «montant
à pied une longue côte, pour reposer ma jument, je fus rejoint par
une pauvre femme, qui se plaignait du temps et du triste pays
[…], que
son mari n’avait qu’un morceau de terre, une vache et un pauvre
petit cheval, et que cependant ils avaient à payer à un seigneur
une rente
[…qu’]elle
avait sept enfants et le lait de sa vache servait à faire la soupe».
Puis, vient le point de chute : «Cette
femme, vue de près, on lui aurait donné soixante ou soixante-dix
ans, tant sa taille était courbée et son visage ridé et durci par
le travail; mais elle me dit qu’elle n’en avait que vingt-huit».26
Duvignaud commente ainsi un texte de Büchner qu’il cite : «“Le
paysan chemine derrière la charrue et le riche marche derrière le
paysan et sa charrue et le fait avancer lui et son bœuf; il lui
prend le grain, lui laisse la paille. La vie du paysan est une longue
journée de travail…” L’homme qui sait ces choses ne peut pas
continuer à vivre comme auparavant. Il se sent dans le monde comme
il serait dans une Bastille».27
Et la condition urbaine ne cédait en rien à la condition paysanne :
«Je
doute qu’il puisse exister sur terre un enfer plus terrible que
d’être pauvre à Paris, que de se voir continuellement au centre
de tous les plaisirs sans jamais pouvoir en goûter aucun»,28
notait l’auteur anonyme des Letters
on the French Nation by a Sicilian Gentleman residing.
Situations
intolérables propices à développer des angoisses : la crainte des
jacqueries et des frondes était aussi forte chez les nobles des
campagnes que les émeutes urbaines pour les bourgeois des villes.
Aux émeutes, pillages et saccages des manufactures Hébert et
Réveillon en avril 1789 succéda la Grande Peur de l’été
suivant. Nous sommes en plein contexte de la Nuit du 4 Août. Soirée
de délires délirant d’inquiétudes qui n’est plus seulement
celles de l’ennui : «Le
ressort de l’âme est l’inquiétude.
C’est son instabilité fondamentale qui est la source de son
activité, de ses exigences, de ses métamorphoses. Telle est la
vraie signification de l’“intérêt”, principe de la morale
naturelle. On défigure volontiers cette morale par un nom affreux :
l’utilitarisme. Mais l’intérêt exprime bien autre chose que la
recherche positive, voire cynique, de l’utile. Il désigne un
principe plus profond, plus secrètement rivé à l’être : il est
le palliatif naturel de l’angoisse originelle, l’instinct de
conservation, si l’on veut. C’est cette tendance indifférente,
source de toutes les autres que Rousseau nommera
amour
de soi,
pour l’opposer à l’amour-propre.
Il convient donc de donner au mot “intérêt” une valeur
existentielle
et
non
morale.
L’intérêt marque le point d’insertion de l’homme dans le
monde, la soudure entre la conscience et l’existence. Lorsque
celle-ci est défectueuse, on est exposé à l’ennui ou à
l’inquiétude, qui sont les deux formes morbides de la présence au
monde. L’intérêt corrige spontanément cette double hérésie
vitale, d’où procèdent toutes les maladies de l’âme.
Systématisé par la “philosophie”, ou simplement la sagesse,
c’est lui qui sera la clé de voûte du bonheur».29
Il importe peu finalement que la misère dont parle Michelet et que
Mathiez et Gaxotte, unanimement, réfutent, soit matérielle ou
morale, car elle est à la fois matérielle (pour la paysanne
rencontrée par Arthur Young) et morale (pour l’auteur anonyme de
la lettre du gentilhomme sicilien). Chacun ressent l’incomplétude
du bonheur à se heurter aux limites de ses possibilités. Le
tragique et le bonheur entrent alors dans un étrange rapport
dialectique dont le pivot axial est la philanthropie, l’utilité à
son prochain. Même André Vachet, auteur très critique, souligne
que «l’inquiétude
n’est qu’une forme du désir du bien; c’est la tension de
l’esprit devant un bien possible dont on est privé. Son dynamisme
se résout ultimement dans la recherche du bien dont le jugement réel
détermine la convenance».30
Six ans plus tard, c’est encore contre l’inquiétude et au nom de
la philanthropie sociale que Gracchus Babeuf allait organiser et
rater sa Conjuration des Égaux : «Le
babouvisme est une philosophie de la misère; c’est pour que les
pauvres gens mangent chaque jour à leur faim que Babeuf a pris plume
et a voulu lancer un appel aux armes, À lire les philosophes, à
lire l’histoire de la Révolution, on voit que l’inquiétude la
plus générale, aux champs, dans les villes, est bien alors celle
que posent les problèmes de subsistances; et que c’est à chercher
une solution, enfin définitive, à ce problème aigu, le problème
de la disette, que tant de soins ont été si âprement donnés, soit
au point de vue économique, soit au point de vue pénal, par ceux
qui écrivent et par ceux qui gouvernent. C’est sous la forme d’un
“ospice” que Babeuf et ses amis ont entrevu le régime futur :
c’est lorsque les hommes auront pu s’abriter dans un tel refuge
qu’enfin le bonheur, but de la société, sera connu par les
malheureux humains».31
Cette
source d’inquiétude n’est pas étrangère à un certain
sentiment de culpabilité ambiguë. Elle provient, en effet, du
constat de ce qu’a d’intolérable la situation, mais aussi de
l’effet de retardement du choc qui y mettrait fin. Un suspens
non
dénué de masochisme, envahit tout le crépuscule de l’Ancien
Régime : quand viendra la nuit? Tombera-t-elle doucement, comme un
suaire, à l’image du lent déclin de l’Empire romain tel que
décrit par Gibbon? Ou n’éclatera-t-elle pas, dans une apocalypse
terrifiante, comme lors de la chute de Byzance aux mains des Turcs?
Les spéculations moroses ou les digressions voluptueuses de son
destin passionnaient cette noblesse écervelée avant d’être
étêtée. Jusqu’à quand la situation
intolérable pourrait-elle
être tolérée? C’est ce que Soboul appelle la loi
de Tocqueville :
«c’est
une vérité qu’on a pu dire qu’en détruisant une partie des
institutions du Moyen Âge, on avait rendu cent fois plus odieux ce
qu’on en laissait».32
Évidemment, chaque classe de la société vit sa
loi
de Tocqueville. Lors
de l’inauguration des États généraux en mai 1789, «l’évêque
de Nancy, qui prononce le sermon, présente au roi “les hommages du
clergé, les respects de la noblesse et les très humbles
supplications du tiers état”»,33
c’est-à-dire que chaque groupe avait à se plaindre, avec un degré
de résignation tout différent - ce qui suscita la sourde grogne des
membres du Tiers -, de ces résidus désuets du Moyen-Âge. Le clergé
rendait hommages car il n’avait rien à changer à sa situation
actuelle; la noblesse maintenait son respect, mais ses exigences
étaient tenaces; seul le Tiers, ayant une longue liste de
suppliques, prenait à son compte les récriminations du bas-clergé
et la dissidence de quelques nobles déclassés. Pour la bourgeoisie
du Tiers, «sa
croissance
même
lui faisait sentir plus vivement les infirmités légales auxquelles
elle restait condamnée. Barnave devint révolutionnaire le jour où
un noble expulsa sa mère de la loge qu’elle occupait au Théâtre
de Grenoble. Madame Roland se plaint qu’ayant été retenue avec sa
mère à dîner au château de Fontenay, on les servit à l’office.
Blessures de l’amour-propre, combien avez-vous fait d’ennemis à
l’ancien régime?»34
demande Mathiez. Babeuf éprouva une situation tout aussi intolérable
: «Un
feudiste
était
considéré alors comme un personnage de peu d’importance, et il
fut invité à manger à l’office, de même que son prédécesseur,
avec le personnel domestique du comte [son
employeur]. Ce
fut jugé par Babeuf inadmissible. D'autant plus qu'il n'a pu
s'entendre avec les personnes dont il se voyait obligé de partager
les repas. Peut-être une discussion quelque peu vive avait éclaté
à un moment donné. Toujours est-il que Babeuf, se jugeant offensé,
s'adressa à M. de Casteja en lui déclarant qu'il ne voulait plus
s'asseoir à la table des gens de l'office du comte. Celui-ci prit
les choses de haut : “Si manger avec les gens de mon office,
monsieur, ne vous convient pas, lui écrit-il, et que vous ne
trouviez pas à vous nourrir ailleurs dans le village, il ne faut
penser à aucun arrangement entre vous et moi”. Et sans plus de
ménagements, il signifie à Babeuf que, dans ces conditions, il ne
se donne pas la peine de revenir».35
Le tout jeune Saint-Just, qu’un larcin avait fait interner à la
prison de Picpus, était partagé entre deux sentiments aussi
violents l’un que l’autre : «une
rage froide, une révolte profonde contre cette société qui a
hiérarchiquement mis au point son incarcération (depuis sa mère
qui l’a réclamée jusqu’au roi qui a signé la lettre de cachet,
en passant par le ministre et les exempts de police), et autrement
lancinant, le regret du monde rougeoyant de la volupté, dont le
souffle lui brûle encore le sang. Pas l’ombre d’un remords,
durant son interrogatoire ou ses premières lettres, à l’égard de
sa mère atterrée par le joli coup qu’il lui a fait! Il l’aimait
pourtant; mais le passionné qui s’est livré sans frein au charme
du plaisir, il est trop envahi par le souvenir et l’impatience pour
donner sa part à un sentiment plus ancien».36
L’Intelligentsia
française
procédait également du même mécontentement. Tout le ressentiment
qui animait un dilettante comme Chamfort appartient à cette même
limite sociale : «Chamfort
n’agit pas ici par égalitarisme, mais par dépit devant la
trahison de sa hiérarchie idéale. “Lorsque Montaigne a dit, à
propos de la grandeur : ‘Puisque nous ne pouvons y atteindre,
vengeons-nous-en à en médire’, il a dit une chose plaisante,
souvent vraie, mais scandaleuse, et qui donne des armes aux sots que
la fortune a favorisés. Souvent c’est par politesse qu’on hait
l’inégalité des conditions; mais un vrai sage et un honnête
homme pourraient la haïr comme la barrière qui sépare des âmes
faites pour se rapprocher… Celui-là, au lieu de répéter le mot
de Montaigne, peut dire: ‘Je hais la grandeur qui m’a fait fuir
ce que j’aimais ou ce que j’aurais aimé’.”».37
Mais que
valent les frustrations de quelques individus face au marasme où se
trouvent plongées des catégories sociales tout entières? La couche
paysanne la plus pauvre et la plus nombreuse, dont faisait partie
cette humble paysanne rencontrée par Arthur Young, est celle à
laquelle pense Tocqueville lorsqu’il énonce sa
loi
: «Figurez-vous,
écrit Tocqueville à propos du paysan français du XVIIIe siècle,
la condition, les
besoins,
le caractère, les passions de cet homme et calculez, si vous le
pouvez, les trésors de haine et l’envie qui se sont amassés dans
son cœur».38
Young lui-même put en prendre la mesure quand sa paysanne lui confia
son espérance dans les États généraux réunis à Versailles : «On
dit qu’à présent quelque chose va être fait par de grands
personnages pour nous pauvres gens, mais elle ne savait pas qui, ni
comment; mais que Dieu nous envoie quelque chose de meilleur, car les
tailles et les droits nous écrasent».39
Plus d’une semaine plus tard, «le
lundi 27 juillet, le secrétaire de la ville et communauté de Nantes
note sur le registre des délibérations : “Il a été dit que
jamais le recours à Dieu n’a été plus nécessaire et plus
pressant que dans ce moment où il n’y a rien à espérer de la
récolte des grains, si les pluyes dont nous sommes affligés depuis
si longtemps continuent».40
Quel bourgeois, qui a participé à la rédaction d’un cahier de
doléances au printemps précédent, pourrait le nier? La frustration
de la classe bourgeoise puise à même les déboires de la
paysannerie les justifications à son action politique. Au cœur de
cette situation
intolérable, l’abbé
Sieyès demande l’abolition des privilèges : «“Concevra-t-on
qu’on ait pu consentir à vouloir ainsi humilier vingt-sept
millions huit cent mille individus pour en honorer ridiculement deux
cent mille?” [Les
privilégiés] “rempliront
la Cour, ils assiégeront les ministres, ils accapareront toutes les
places, toutes les pensions, tous les bénéfices… Toutes les
portes doivent être ouvertes à leurs sollicitations
[…].
Les privilégiés engloutissent et les capitaux et les personnes,
tout est voué sans retour à la stérilité privilégiée…”
C’est
[le Tiers État] encore
qui, pour les dix-neuf vingtièmes, remplit toutes les fonctions
publiques “avec cette différence qu’il est chargé de tout ce
qu’il y a de vraiment pénible…” Ainsi le Tiers État est-il
toute l’utilité sociale».41
C’est bien là une sympathie toute apparente qui ne peut obstruer
les convoitises spécifiquement bourgeoises pour l’accès au
pouvoir politique. Paysans et salariés retourneront bientôt à leur
condition ingrate, redevenue soudainement toute
naturelle. Mathiez
reconnaît le fardeau supplémentaire que la Révolution ajouta sur
les épaules du petit peuple : «Paysans
accablés par les réquisitions et les charrois, ouvriers exténués
par une sous-alimentation chronique et acharnés à la conquête d’un
salaire que la loi leur refusait, commerçants à demi ruinés par
les taxes, rentiers spoliés par l’assignat, sous le calme apparent
fermentait un mécontentement profond. Seuls profitaient du régime
le troupeau élargi des agents de la nouvelle bureaucratie et les
fabricants de guerre».42
…Et le thermidorien Dubois-Crancé put évoquer «avec
sympathie le rôle prépondérant du peuple, dont les brusques
colères lui paraissent justifiées par une trop longue patience de
ses maux».43
N’abusons
pas d’ironie. Soulignons seulement ce poids, ce fardeau qui pèse
sur la conscience historique, qui voit combien la Révolution a
ajouté à la situation
intolérable qu’elle
était sensée résorbée. Nous sommes fort avertis des
inconséquences par l’interprétation whig
de
l’histoire pour savoir reconnaître combien les promesses
généreuses de la Révolution étaient supportées par une
conscience diffuse des acteurs autant que par les souffrances des
petites gens. La pesanteur objective de toutes situations
intolérables
diverge d’un milieu à l’autre. L’insulte faite à la mère de
Barnave, à celle faite à Madame Roland, ou même à la vanité de
Babeuf, pesait bien peu en face du lourd fardeau de la malheureuse
paysanne croisée par Arthur Young ou aux sans-emplois qui gîtaient
dans les garnis de Paris, annonçant le prolétariat massif qui
allait commencer à déborder sous le règne de Louis-Philippe un
demi-siècle plus tard. Mille occasions se s'offraient où chacun
pouvait vivre cette dissociation
entre l’existence et la conscience
qu’on la retrouve clairement exprimée chez un certain Foignet,
incarcéré à la fin janvier 1794 à la prison des Anglaises : «Nos
occupations étaient de boire, manger, fumer, monter, descendre et
dormir… Un temps précieux que l’on aurait employé à servir la
patrie a été perdu à des parties de jeu ou de débauches.
Plusieurs jeunes gens, du nombre desquels je me trouvais, désœuvrés
depuis le matin jusqu’au soir, s’étourdissaient sur leurs
malheurs ou se livraient à des passe-temps qui ne leur laissaient le
lendemain que des regrets».44
De la loi
de Tocqueville, où
la situation
intolérable
est mise en relation avec la patience des masses sous le couvert de
l’inquiétude et du suspens
existentiel,
nous arrivons bientôt à la loi psychologique des attentes et des
résultats, traduction psychologique de l’interprétation whig
de
l’histoire.
Notes
1
J.-C. Bonnet (éd.) op. cit. p. 25.
2
A. Decouflé. op. cit. p. 51 et n. 1.
3
J.-J. Chevallier. op. cit. p. 120.
4
J.-C. Bonnet (éd.) op. cit. p. 28.
5
J. Bainville. op. cit. p. 290.
6
D. Arasse. op. cit. pp. 137-138.
7
A. Soboul. op. cit. 1968, p. 241.
8
Cité in G. Walter. op. cit. 1947, pp. 230-231.
9
Cité in J.-R. Suratteau. op. cit. p. 56.
10
A. Mathiez. op. cit. 1922-1924, p. 11.
11
P. Gaxotte. op. cit. p. 93.
12
J. Bainville. op. cit. p. 287.
13
P. Gaxotte. op. cit. p. 331.
14
A. Rey. op. cit. p. 360.
15
A. Soboul. op. cit. 1988, pp. 256-257.
16
A. Soboul. Ibid. p. 367.
17
J.-J. Chevallier. op. cit. p. 87.
18
J.-J. Chevallier. Ibid. p. 173.
19
A. Soboul. op. cit. 1986, p. 195.
20
Cité in L. Saurel. op. cit. p. 22.
21
M. Ferreira. op. cit. p. 25.
22
J. Duvignaud. op. cit. pp. 37 et 38.
23
A. Decouflé. op. cit. pp. 56-57.
24
Cité in A. Decouflé. Ibid. p. 29.
25
R. Mauzi. op. cit. p. 27.
26
Cité in J.-P. Bertaud. op. cit. p. 44.
27
J. Duvignaud. op. cit. p. 56.
28
Cité in J. Kaplow. op. cit. p. 59.
29
A. Mauzi. op. cit. p. 19.
30
A. Vachet. op. cit. p. 115.
31
M. Leroy. op. cit. t. 2, p. 89.
32
Cité in A. Soboul. op. cit. 1970, p. 65.
33
F. Furet et D. Richet. op. cit. p. 74.
34
A. Mathiez. op. cit. 1922-1924, pp. 11-12.
35
G. Walter. op. cit. 1937, pp. 26-27.
36
B. d'Astorg. op. cit. pp. 17-18.
37
C. Arnaud. op. cit. pp. 58-59.
38
Cité in A. Soboul. op. cit. 1981, pp. 357-358.
39
Cité in J.-P. Bertaud. op. cit. 1971, p. 44.
40
J.-P. Hirsch. op. cit. p. 124.
41
Cité in J.-D. Bredin. op. cit. pp. 104-105, 106 et 111-112.
42
A. Mathiez. op. cit. 1922-1924, p. 527.
43
P. Trahard. op. cit. p. 58, n. 1.
44
Cité in O. Blanc. op. cit. 1984, p. 52.
Jean-Paul Coupal.
La tourmente révolutionnaire, vol. 2,
La tourmente révolutionnaire, vol. 2,
Deux modèles de sauveurs au glaive
(À gauche, George Washington (1732-1799),
à droite le jeune officier Napoléon Bonaparte (1769-1821))
(À gauche, George Washington (1732-1799),
à droite le jeune officier Napoléon Bonaparte (1769-1821))
MORALISATION
VIII.1
LA MYSTIQUE DU SAUVEUR
L’un des constats les
plus tragiques de l’Ère
des Révolutions est
sans doute la grande contradiction entre la vivacité du système
idéologique, malgré la relativité des principes et les grandes
frictions autour de l’ordre des priorités, et la praxis
qui tend
à ignorer ou à sous-estimer les moyens par lesquels obtenir la
réalisation de ce vaste système. Contradiction entre d’une part,
une palette riche d’aspirations créatrices et dynamiques,
anticipant un quelconque programme social et, d’autre part, une
ignorance manifeste des stratégies et des tactiques qui force
souvent les révolutionnaires à progresser à tâtons dans la voie
de la réalisation de leur programme. La contradiction est d’autant
plus tragique qu’une doctrine activiste préside à la conscience
morale des révolutionnaires, engageant à n’importe quel prix leur
action en vue de profiter d’un temps favorable et incontournable,
un kairos
où doit
advenir un homme nouveau, une société régénérée. L’impact du
sens sur la morale de l’histoire devient ici déterminant : la
transgression et la culpabilité n’iront pas sans maculer la pureté
des idéaux ni détraquer la valeur des aspirations. Archaïsme et
futurisme vont faire la loi idéologique. Indicateurs d’un
essoufflement de la minorité
créatrice
d’une civilisation, lorsqu’ils n’envahissent pas tout le
contenu des aspirations, archaïsme et futurisme semblent toutefois
enrayer le processus stratégique. S’inscrivant dans la
sotériologie chrétienne, la laïcisant pour amortir le choc moral
des profanations politiques, ils vont imposer à l’esprit de la
minorité bourgeoise des modèles d’action historiques - et c’est
le début de l’historicisme -, modèles répétés ou anticipés
qui deviendront les seules solutions envisageables par la volonté
révolutionnaire de supplanter la tradition en crise. La Révolution
confirme donc les indices de faillite de l’auto-détermination déjà
identifiés sous l’âge baroque : «La
minorité créatrice, d’où naissent les individus créateurs, à
la phase de croissance, a cessé d’être active et s’est
contentée simplement d’être “dominante”. Mais la sécession
du prolétariat*, qui est la caractéristique essentielle de
désagrégation, s’est opérée sous la direction de personnalités
exceptionnelles** pour lesquelles il n’y avait plus d’activité
possible hormis l’opposition au “pouvoir établi”. C’est
ainsi que le passage de la croissance à la désagrégation ne
s’accompagne d’aucune extinction de la flamme créatrice. Les
personnalités continuent à surgir et à prendre la tête, en vertu
de leur pouvoir créateur, mais elles se trouvent alors contraintes à
exécuter leur œuvre d’un nouveau
locus
standi.
Dans
une civilisation en croissance, le créateur est appelé à jouer le
rôle de conquérant qui relève le défi et y apporte une réponse
victorieuse. Dans une civilisation qui se désagrège, il joue le
rôle de sauveur venant au secours d’une société qui n’a pas
réagi, la provocation ayant abattu une minorité qui a cessé d’être
créatrice».1
L’Ère
des Révolutions eut
recours à différents types de ces sauveurs que Toynbee classifie
essentiellement en sauveur
à la Machine à explorer le Temps -
selon le titre de la célèbre nouvelle d’H. G. Wells - et sauveur
au glaive :
on pourrait sans doute élargir la typologie dans le cas de la
civilisation occidentale - les Romantiques et les idéalistes
développeront même une idéologie «qui
veut que l’artiste soit proche du peuple ou de la nation, mais
éloigné du pouvoir»2
-, mais il apparaît évident, compte tenu des catégories
d’archaïsme et de futurisme déjà relevées au niveau du sens de
l’histoire, que dans la catégorie des sauveurs à la Machine à
explorer le Temps, correspondait, au niveau de la morale de
l’histoire, «le
sauveur archaïque [essayant]
de
reconstituer un passé imaginaire. Le sauveur futuriste [tentant]
un bond dans l’avenir de ses rêves».3
La dérive de la désagrégation de la civilisation occidentale
depuis le XVIIIe siècle - celle qui s’articulait sur la
dysfonction sociale et la schize
psychologique
-, passaient alternativement d’une solution archaïque à une
solution futuriste, quand ce n'était pas un syncrétisme des deux :
un Empire intergalactique qui pratique des tournois féodaux est un
exemple de ce type de divagation
de l’imaginaire. En
ce qui concerne les sauveurs au glaive, on les verra tenter de
rétablir, chacun selon sa situation, l’unité d’un univers qui
échappa malgré tout à toutes les solutions proposées par les
sauveurs à la Machine à explorer le Temps, voilà pourquoi les
sauveurs aux glaives suivirent et ne précédèrent jamais les
premiers; ils apparaissent comme le recours ultime contre la
désagrégation : «Les
sauveurs classiques furent des capitaines et des princes qui
luttèrent et réussirent à fonder ou à rétablir des États
universels. Étant donné que le passage d’un temps de troubles à
un État universel est susceptible d’amener un apaisement réel et
immédiat, ces fondateurs glorieux furent adorés comme des
divinités*; mais les États universels n’en sont pas moins
éphémères. Si, par un tour de force, ils se prolongent au-delà du
laps de temps habituel, ils doivent payer la rançon de cette
longévité exceptionnelle. Ce sera en dégénérant en anomalies
sociales, aussi pernicieuses à leur manière que les temps de
troubles qui les ont précédées ou les interrègnes qui suivront
leur dissolution».4
Quoi qu’il en soit, le fait de se précipiter dans la mystique
du sauveur
afin de résoudre rapidement un état d’urgence généralisé entre
des aspirations lourdes d’intérêts et des contraintes limitatives
sérieuses de moyens, indique combien la minorité
créatrice
nouvelle semblait réussir là où échouait la vieille minorité
dominante.
Mais tout cela n’est qu’un leurre. En fait, il ressort de l’étude
du cas occidental, que la relève créatrice réussit davantage dans
le domaine de la spéculation et de la fantaisie alors que ses
solutions concrètes révèlent un manque d’imagination pratique et
un esprit obsessionnel compulsif. Bientôt abandonnée à des rites à
caractères religieux mais vides de toute spiritualité, à de vains
rêves d’empires édifiés ou restaurés, elle n’eut à proposer
que des mesures moralisatrices doublées de violences sauvages et
incontrôlées justifiées par des énoncés d’allure scientifique;
enfin, en dernier recours, à des inventions administratives
fétichistes et irréalistes associées à de vulgaires trucs
de magie qualifiés de progrès
technique.
Quoi qu’il en soit, la
mystique du sauveur contemporain s’inscrit dans le prolongement de
la sotériologie chrétienne qu’elle laïcise et réduit à des
paramètres politiques dans le contexte révolutionnaire. Car il
s’agit avant tout de sauver
la Révolution, par
n’importe quel moyen, par n’importe quel agent. On peut toujours,
si l’on est d’allégeance rousseauiste, reporter sur le peuple,
et de préférence le petit peuple, le bon sauveur des spéculations
bourgeoises. Les marxistes, quant à eux, le reporteront sur le
prolétariat ouvrier des centres urbains. Georges Lefebvre l’attribua
à la paysannerie; Albert Soboul au petit peuple sans-culotte
parisien : «Plus
que jamais, dans cette lutte, fut nécessaire l’énergie du peuple
sans-culotte : ce recours auquel la Gironde, par égoïsme de classe,
s’était refusée, une autre fraction de la bourgeoisie y
consentit, qui allait s’attacher, par l’organisation du
Gouvernement révolutionnaire et de la dictature jacobine, à
encadrer et à discipliner l’ordre populaire. De là devait venir
le salut de la République».5
Michelet, historien de la bourgeoisie libérale, ne faisait pas ces
savantes distinctions et déclarait unanimement le
Peuple sauveur
de la Révolution. Les révolutionnaires, encore plus libéraux que
nationalistes, voyaient dans les individus particuliers, c’est-à-dire
eux-mêmes, les seuls détenteurs possibles de toute solution apte à
sauver la Révolution : ainsi Mirabeau : «la
révolution, pour ce révolutionnaire passionné et lucide, était le
moyen d’établir une constitution équilibrée, non pas de
substituer la dictature d’une assemblée au despotisme d’un
monarque».6
De fait, «Mirabeau,
toujours prudent, s’inquiétait de l’exaltation de l’assemblée.
Il voyait les esprits échauffés; il craignait les décisions
irréversibles dont la monarchie ne se relèverait peut-être pas. Il
redoutait tout autant une riposte irréfléchie de la royauté qui,
mettant fin à la législature balbutiante, déchaînerait la
violence, la guerre civile, des calamités dont il n’osait préciser
les horreurs. Le salut était dans la voie moyenne, acceptable pour
le régime et pour la nation.
[…]
Mirabeau offrait donc ses services; non pour se vendre, mais par sa
conviction profonde qu’aucune révolution ne pouvait s’imposer
sans lui».7
Il n’y avait donc pas seulement de la fatuité dans ce personnage
qui osait affirmer de lui-même, dans un écrit du 22 octobre 1790 :
«Je suis
l’homme du rétablissement de l’ordre, et non d’un
rétablissement de l’ordre ancien».8
La grande prétention de Mirabeau, sa popularité (surfaite) et ses
ambitions personnelles lui créèrent bien des jalousies. En face de
lui, son alter
ego en
quelque sorte, La Fayette, «le
“héros des deux mondes”, par sa générosité chevaleresque,
séduisait la bourgeoisie, éblouie d’avoir un pareil chef. Grand
seigneur, magnifique et libéral, il en imposait au peuple… Il
rêvait d’être le Washington de la France, de rallier le roi à la
Révolution et l’Assemblée à l’idée d’un exécutif
énergique. Plein d’un optimisme naïf et, d’ailleurs, sûr de
son génie, il s’avança sur la corde raide, tandis que son ami
Jefferson tremblait pour lui et que Gouverneur Morris, sarcastique,
prédisait sa chute».9
Contrairement à l’homme à scandales qu’était Mirabeau, La
Fayette apparut davantage, selon le mot de Soboul, «symbole
plutôt que chef»,10
ce qui lui monta rapidement à la tête, quoiqu’«il
n’en demeure pas moins qu’il était homme d’honneur, de
courage, n’hésitant jamais à sacrifier ses intérêts à ses
principes».11
La Fayette ne fut jamais en passe de devenir ce sauveur
au glaive, comme
le fût son mentor, Washington, pour les États-Unis. Ou l’homme
qui le craignit toujours un peu, Napoléon Bonaparte. Son destin,
celui d’être broyé par la radicalisation de la Révolution,
appartient à celui des modestes tragédies selon la formule de
Ferreira : «Tel
le démiurge, la Révolution animatrice de destinées, créatrice de
légendes, est aussi apte à les briser; c’est toujours Elle qui,
sur son immense théâtre, tient le premier rôle, implacable à
l’encontre de ceux qui ne seraient pas à la hauteur de la pièce
qu’elle veut leur faire jouer».12
Malgré leur rivalité féroce, Mirabeau et La Fayette se proposaient
comme les modèles de patriotes capables de sauver de la tourmente la
Nation, le Roi et la Révolution… pourvu qu’ils obtinrent un
poste de Ministre (l’attente déçue de Mirabeau) ou devienne maire
de palais (tel
que le suppose Mathiez de La Fayette) de la monarchie
constitutionnelle. Ils s’offraient tous deux à une attente
certaine qui avait déjà été celle des Américains en 1776. Eux
aussi avaient connu l’ivresse de la révolte suivie de l’angoisse
de l’anarchie. Ils avaient fait, les premiers, l’expérience
qu’il est plus facile de chauffer les agitations que d’organiser
et conduire la Révolution : «Avec
Sam Adams et d’autres, le Congrès disposait de patriotes qui
pouvaient entraîner la foule mais il avait un besoin impérieux d’un
homme qui pût la discipliner et la diriger, qui pût à la fois
représenter l’image d’un commandant en chef à la façon
européenne et se conformer à cette image, tout en restant un
véritable Américain».13
Encore plus hantés par la corruption, l’espionnage et l’agiotage,
les révolutionnaires français tenteront plutôt d’écarter la
solution de l’homme providentiel pour n’être que les instruments
modestes d’un gouvernement collégial propre à une véritable
régénération patriotique. Ainsi, pour Saint-Just, «“il
faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l’être par la
justice.” Ce dernier trait traduit un pessimisme et un refus de
s’incliner devant l’avilissement des mœurs. Il entend rester
debout, affronter le destin face à face et “ne dormir que dans le
tombeau”. Elle reviendra souvent - comme une obsession - dans ses
prochains discours cette expression de la volonté de veiller jusqu’à
la mort. Comme si, sentant proche la fatalité de celle-ci, il eût
voulu ne pas perdre une heure de sa vie, ne pas mourir sans avoir, en
conscience, tout tenté».14
Moins qu’un commandeur à la Cincinnatus, le sauveur au glaive fut
ici un purificateur. Sa figure se complexifia au point que la
conscience historique ne sait plus où trop le situer moralement. Les
intarissables débats autour de la personne de Robespierre qui, de
Laponneraye à Guillemin en passant par Jaurès et, bien sûr,
Mathiez, font de l’Incorruptible un mystique
en politique,
ou de Michelet à Furet en passant par les inénarrables Taine et
Gaxotte dénonçant le cuistre, l’homme pâle et sa politique
mystique : «Ils
peuvent condamner Robespierre, vitupère
Gallo,
cette condamnation est la preuve qu’ils reconnaissent, qu’ils
distinguent - le
Christ
n’a-t-il pas été crucifié? - par le châtiment exemplaire qui
est souffrance et joie indicibles, mais la résurrection est
certaine. Maximilien croit à la postérité».15
Comparer Robespierre au Christ, c’est déjà aller très loin,
aussi loin que d’en faire un monstre vaniteux assoiffé de sang.
Les Américains, sans doute, heureusement pour eux d’ailleurs, ne
connurent pas de telles figures exaltées. Bien au contraire, ils
cherchèrent toujours dans la peau de leurs sauveurs une figure
modérée mais tout aussi déterminée et mobilisée par une morale
activiste. Non seulement lorsque l’urgence de la guerre ouverte
avec l’Angleterre exigea un commandement militaire efficace, mais
encore plus, lorsque la Confédération des États-Unis s’achemina
vers la crise politique et qu’il fallut définir l’image d’un
exécutif national idéal, fort mais à l’abri de toute tentation
dictatoriale. Ainsi, au Congrès de Philadelphie de 1787, «James
Wilson, délégué de la Pennsylvanie, prit la parole pour expliquer
pourquoi il était partisan de la remise du pouvoir exécutif entre
les mains d’une seule personne. Les qualités essentielles de
l’exécutif, selon lui, étaient l’énergie, la diligence et le
sens des responsabilités. Une seule personne serait plus énergique
et diligente qu’un directoire».16
Et cette personne était déjà toute trouvée : c’était George
Washington. L’ex-général recyclé en premier fonctionnaire de
l’État offrait la garantie du modèle, de Cincinnatus, qui
deviendra vite l’idealtypus
de la
Constitution américaine, car c’est bien à partir de l’image
qu’on se fît de cet individu que l’on créa la fonction
présidentielle et qui commandera les figures rassurantes de
Jefferson, de Madison, de Lincoln et de F. D. Roosevelt au cours des
grandes crises internationales de l’histoire américaine.
Car on s’entend plus
facilement autour des figures que l’on revêt du manteau du sauveur
au glaive. C’était
déjà le despote éclairé aux yeux de Voltaire, et quand ce n'était
pas le despote lui-même, c’était son chef d’armée : ainsi
Kaunitz en Autriche, Potemkine puis Souvorof en Russie, etc. La
gloire nouvelle - celle de l’utilité publique – jumelait
l’ancienne noblesse féodale aux vertus bourgeoises selon
l’Idealtypus
tracé
par les philosophes : «La
philosophie du XVIIIe siècle finit par concevoir un homme
“surdéterminé”. Tant que l’idéal demeure surnaturel, l’homme
trouve sa liberté dans la distance qui l’en sépare : on n’est
jamais tenu d’être tout à fait fidèle à un absolu lointain.
Mais si l’absolu se loge dans la nature même, comment lui
résister? Sans doute l’homme peut-il alors aisément accéder à
la perfection, puisqu’il la porte en lui-même. Il n’en doit pas
moins choisir entre la tyrannie immanente de la nature et le désastre
de ceux qui, voulant y échapper, tombent dans la catégorie des
“monstres”, qu’on ne peut plus sauver. Cela explique pourquoi
ce siècle, qui a tant revendiqué la liberté, n’a su élaborer
qu’une morale autoritaire, en proposant de l’homme une image plus
générale encore que le type forgé par les classiques. La nature,
telle que ceux-ci la concevaient, ne visait qu’à représenter
l’homme tel qu’il est. Elle signifie désormais ce qu’il doit
être. La morale a pour but de façonner l’individu de telle sorte
qu’en ne croyant suivre que son “caractère”, il se dirige
immanquablement vers le bonheur que la nature et la philosophie lui
ont préparé».17
Comment faire en sorte que la gloire nouvelle ne transforme pas un
tel homme moral en nouveau despote? «Mais
voici enfin, Marat le suppose, un chef qui se révèle, et qui prend
en main la direction du mouvement. Voici ce que lui recommande alors
l’auteur des
Chaînes
de l’Esclavage.
D’une façon générale, il doit se montrer extrêmement prudent et
habile. “S’il a tout à craindre de sa sévérité, il n’a pas
moins à craindre de ses mauvais succès.” Énergie, clairvoyance,
rapidité de décision et faculté de s’adapter aux exigences de la
situation révolutionnaire sont les principales qualités requises.
“Le moindre tempérament ruine une entreprise audacieuse”».18
Marat appelait davantage à ce sauveur idéal autant qu’il se
savait incapable de l’incarner. Toute révolution moderne se
présente, telle une accoucheuse d’hommes nouveaux, vectrice d’une
société future et le sauveur qui en émerge peut finalement être
moins un individu qu’un idealtypus
semblable à celui tracé par Marat et qui correspond étrangement à
la figure historique de Washington. Bref, l’homme du nouveau
Contrat social,
efficace
et généreux : «ce
fondateur
[de régime politique] -
le grand législateur de la tradition humaniste - ne peut être,
comme l’écrit Rousseau dans le
Contrat
social
qu’un
“homme extraordinaire”, puisqu’il s’arroge le droit, sans
autorité formelle, d’inventer de “nouvelles règles de la
société”. Il est donc au départ un imposteur, le temps
d’élaborer les textes qui constitueront la loi fondamentale du
nouveau régime. Il est vrai que ces textes, une fois rédigés,
seront soumis fort démocratiquement au consentement du peuple.
L’imposture n’est donc que provisoire».19
La personnalité du sauveur étant transitoire, par le contrat qu’il
paraphe, le premier, de sa signature, il entendait fonder dans la Loi
l’œuvre enfantée par la victoire des armes. L’imposture réelle
de l’affaire ne consisterait-elle pas davantage à masquer le règne
de la force
par la fiction
du droit?
C’est cette ambiguïté inconfortable mais inavouable, qui laissera
toujours un arrière-goût amer dans la bouche des révolutionnaires,
que mettaient en évidence les cicatrices des révolutions inachevées
dans la conscience historique occidentale. Le salut de l’enfant se
paya de l’interruption volontaire
de
grossesse de la mère, et les aspirations idéalistes se trouvèrent
embrochées autour de l’épée de leur sauveur historique. Comme le
reconnaît Robert Palmer, «le
problème dans toute l’Amérique et en Europe fut, pendant un
demi-siècle, de “former” le gouvernement nouveau en même temps
que la société nouvelle. Le problème fut de trouver un pouvoir
constituant. Napoléon offrit ses services à l’Europe. Les
Américains recoururent au processus de la convention constituante -
qui, révolutionnaire à l’origine, devint bientôt une institution
de droit public aux États-Unis».20
L’épée de Washington trucida le mouvement révolutionnaire avec
moins de douleur que le sabre de l’Empereur car elle était
enroulée dans une Constitution équilibrée
et somme
toute bienveillante; l’épée de Napoléon, affûtée sur le
tranchant de la guillotine, fit un carnage d’abord dans les acquis
de la Révolution avant de saigner à blanc l’Europe toute entière.
Voilà pourquoi, à bien des égards, les noms de Washington et de
Bonaparte sont restés représentatifs de l’idealtype
du
sauveur au glaive.
Si le personnage de
Napoléon fascine plus encore que celui, figure autrement austère,
de Washington, c'est que la réputation du Père
Fondateur est
moins entachée que celle de l’Empereur, dont la dictature
absolutiste et l’arrogance personnelle hypothèquent la vertu
salvatrice. La légende de Washington possède sa richesse de vertus
morales et d’attitudes édifiantes. Une génération après la mort
du sauveur,
le
révérend Mason Weems fournissait une Vie
de George Washington «accompagnée
de curieuses anecdotes tant honorables pour lui-même qu’exemplaires
pour ses jeunes compatriotes»,21
et parmi lesquelles nous retrouvons le fameux récit du cerisier
abattu (en fait, une plate réplique de l’épisode du poirier dans
les Confessions
de saint
Augustin). Ces récits exemplaires étaient tirés tout au long de sa
carrière, tandis que la morale exemplaire de Bonaparte s’arrêtait
au fameux combat de boules de neige à l’école militaire de
Brienne, le reste devenant une suite d’anecdotes pour
adultes seulement. Si
la légende de Washington put se diffuser aussi unanimement parmi les
Américains, c’est que le personnage avait lui-même une estime de
soi suffisamment grande pour se concevoir comme le sauveur
providentiel de la Révolution et de son pays : «Il
était fondé à croire que la résistance américaine pourrait
s’effondrer s’il n’était plus là pour tenir les choses en
main. Mais plus longtemps il restait au gouvernail, plus il se
confondait irrévocablement avec la nation et en devenait le symbole.
Pour parler sans détours, le général Washington disparaissait en
tant qu’individu et faisait place à un phénomène de légende,
celui d’un
Saint
George
américain.
Il était la victime de ce processus, mais il est permis de penser
que, jusqu’à un certain point, il le provoqua lui-même, non pas
simplement en remportant une victoire aussi éclatante, en témoignant
de tant de sévérité dans l’accomplissement de sa tâche d’homme
d’État, en se montrant aussi désintéressé, mais aussi en
abandonnant délibérément et ouvertement son identité privée pour
mieux s’identifier à sa fonction publique».22
Ne reconnaît-on pas là le processus décrit dans les Testaments
politiques
du despote éclairé Frédéric II?
D’autre
part, Washington apparut bien sous les traits d’un Saint-Georges,
par exemple dans le célèbre tableau de La
traversée de la Delaware.
Aussi, «à
la tête des armées de la jeune République, il fallait un homme
pratique et un homme de volonté, plutôt qu’un grand stratège :
c’est ce qu’il a été».23
En conséquence, «les
héros locaux, les autres grands personnages de la révolution ont
été oubliés : l’arbre de Washington les dissimule»,24
ce qui est moins évident pour les généraux d’Empire. Dans un cas
comme dans l’autre, selon les paradigmes littéraires et narratifs
hérités de la sotériologie chrétienne, Washington et Bonaparte
héritèrent de la position du Christ lors de la célébration de la
Cène, les autres généraux figurant plutôt comme des
co-partageants. Mais ces Christs nouveaux, des Christs guerriers,
nous apparaissent plus Romains que chrétiens et davantage que Jésus,
en Cincinnatus, celui que nous convie l’idealtypus
de
Washington, ce héros romain appelé à la défense de la République
et qui se désista lui-même de ses pouvoirs et fonctions pour
retourner à sa charrue une fois le danger écarté. Modestie et
humilité étaient à Washington ce que l’héroïsme pompier et les
phrases grandiloquentes furent à Bonaparte (à Arcole, aux
Pyramides, au Grand-Saint-Bernard, à Austerlitz, etc.). C’est
lorsqu’il revient au moment où l’anarchie menaçait la
Confédération des États-Unis - «Treize
souverainetés, avait écrit Washington, agissant les unes contre les
autres, et s’opposant toutes à la direction fédérale, conduiront
rapidement l’ensemble à la ruine.” Un sens politique aussi
direct et rigoureux est inattendu chez un général commandant en
chef de l’armée»,25
de commenter Mrs
Bowen -, qu’il apparut le sauveur
providentiel
de la Nation. Ce n’était plus seulement le sage romain, l’humble
agriculteur remisant son épée au fourreau, qui parut à l’horizon
mythologique de ses compatriotes; mais la sagesse paternelle qu’il
incarnait - l’imago du bon Père-Roi -, le patricien bienveillant
doublé du républicain sincère (il avait déjà refusé le titre de
Roi que lui avaient proposé ses officiers), enfin le Princeps
des Pères
Fondateurs d’une Nation appelée à devenir d’abord un grand
Empire américain avant de finir État universel de la civilisation
occidentale. Certes, Washington, plus que Bonaparte, incarna un rêve
philosophique, paradoxalement plus rousseauiste - l’imposture
temporaire - que pragmatiste. La société américaine appelée à
naître du nouveau Contrat Social devait être toute différente de
celles qui avaient évolué dans l’Ancien Monde. Voilà pourquoi
«George
Washington est à la fois le chantre du culte national et son
“demi-dieu”, ou son “nouveau Christ”, ou bien encore son
“Moïse”, son “Néhémie”, son “Aaron”. Il est le
“sauveur de l’Amérique”, le général victorieux, mais
modeste, et le “protecteur des citoyens”, le premier magistrat
garant de la pérennité des institutions. Il est aussi l’“élu
de Dieu”, un Visible
Saint
en quelque sorte, dont l’enfance exemplaire a révélé qu’il
était touché par le doigt de la Providence».26
Woodrow Wilson, qui sera lui-même Président des États-Unis au
moment critique de la Grande Guerre de 1914, rétroprojette cette
moralisation des vertus de Washington loin en arrière : «Ce
fut une leçon des choses, et qui marqua le caractère de la
Révolution, de voir Washington traverser à cheval les colonies pour
rejoindre l’armée des “Insurgents”. Pas un homme, pas une
femme, pas un enfant même qui risquât de ne la point comprendre.
Son attitude majestueuse attirait tous les regards; ses façons
étaient celles d’un prince; ce visage franc et ouvert, une
conscience pure l’éclairait*; cette aisance cordiale dans le salut
disait l’homme qui se sent le frère de ses amis. Il y avait en
Washington quelque chose qui faisait battre le cœur d’une foule et
lui inspirait le respect, quelque chose qui mettait dans le
jaillissement des vivats comme une rumeur d’adoration. Les enfants
tenaient à le voir, et les hommes se sentaient transportés après
son passage! Il était salutaire qu’un tel homme parcourût sous
les regards du peuple la longue route allant de Philadelphie à
Cambridge, où il allait prendre le commandement de l’armée
populaire. Un tel spectacle à coup sûr exalta les sentiments de
ceux qui en furent témoins».27
Pour Wilson, Washington incarne l’esprit de l’Amérique un peu
comme pour Hegel Napoléon incarnait, au moment précis où il le
croisa (de fort loin), le Weltgeist.
Alden
écrit de même : «À
certains égards, après Yorktown, les conditions n’étaient pas
défavorables en Amérique à une reprise du pouvoir comparable au
coup d’État de Bonaparte en 1799. Washington eût-il voulu
s’emparer de l’autorité suprême que tous les patriotes ne s’y
seraient point opposés. Il eût probablement trouvé quelque appui
parmi eux qui souffraient le plus de l’inflation et du désordre
économique et parmi les conservateurs, alarmés tant par la
faiblesse des gouvernements des États que par les tendances
nouvelles vers la démocratie sociale et politique. Il aurait reçu
le soutien d’une partie des continentaux, dont il était devenu
l’idole. Peut-être même aurait-il été aidé par quelques
Tories. De plus, les gouvernements des États étaient relativement
faibles et le gouvernement national, de par les Articles de la
Confédération, apparemment réduit à
l’impuissance».28
À la rétroprojection wilsonienne, Alden ajoute la fantaisie de
l’uchronie d’un Washington bonapartisé,
tout cela pour mettre à la fois en comparaison et en contraste les
rôles historiques des deux sauveurs
au glaive. Héros
plus terne que l’Empereur, Washington demeure cependant, dans
l’esprit des Américains aussi bien que dans celui des Européens,
l’incarnation d’un véritable sauveur des intérêts de la
bourgeoisie : «Le
contraste entre Washington et Napoléon était saisissant, et Byron,
qui parlait de Washington comme du “Cincinnatus de l’Ouest”,
fut parmi beaucoup d’autres, un de ceux qui insistèrent sur ce
point.
[…] Washington
lui-même parlait fréquemment du destin et s’en remettait à lui.
Mais il ne le faisait pas à la manière de Napoléon. Il n’eût
jamais comme lui le sentiment qu’il était l’Homme du Destin,
mais seulement la certitude que ce qui devait arriver arriverait. […]
Il ne
s’est pas imposé à l’histoire; c’est l’histoire qui s’est
imposée à lui : et il le savait. Il a fait ce qu’il a pu».29
Mais le sauveur
au glaive,
substitut patriotique au despote éclairé, était au fond une figure
tardive, surtout dans le cas de la Révolution française. En 1789,
lorsque les États généraux furent convoqués, personne ne pensa à
un quelconque sauveur
au glaive. La
Fayette, le héros
des deux Mondes, n’était
rien de plus, comme l’a vu Soboul, qu’un symbole.
Saint-Just
et Bonaparte étaient encore loin. Il n’y avait pas davantage de
nouveau Contrat social à l’horizon, à peine une réforme
constitutionnelle. Personne ne pensait à un sauveur, car le sauveur
habitait déjà la personne du Roi : «depuis
le sacre des rois, le gouvernement n’est pas totalement une
élection, il est un
mysterium
exercé
par le roi grand prêtre et par ses fonctionnaires irrécusables. Ils
survivent à la personne du monarque, assurant la continuité de
l’État. Sa dignité est perpétuelle, alors que la personne qui
l’incarne en est seulement l’instrument».30
Mais le Roi a maintenant son magicien, un financier, le banquier
Necker. Aussi, imperceptiblement, la mystique du sauveur tendit-elle
à quitter la personne royale pour investir celle du magicien. Furet
et Richet ont raison d’insister sur le fait que le 24 août 1788,
Louis XVI «fait
appel à Necker comme à un sauveur».31
En ayant son sauveur attitré, le Roi évitait à la Nation une
attente en un sauveur étranger. D’autre part, on sait comment le
second renvoi de Necker, le 12 juillet 1789, sonna l’ouverture du
premier affrontement violent de la Révolution qui devait conduire à
l’assaut de la Bastille, mais aussi au lynchage des intendants du
Roi, Foulon et Berthier, le 22 juillet. Entre temps, si Necker avait
cessé d’être le sauveur du Roi, il l’était devenu de la
Nation. Le 16 juillet - deux jours après la prise de la Bastille et
six jours avant les lynchages, Necker avait été rappelé par
l’Assemblée : «Lally-Tollendal
emporta l’assentiment général en déclarant : “Messieurs, nous
l’avons vu, nous l’avons entendu dans les rues, dans les
carrefours, sur les quais, ou les places, il n’y avait qu’un cri,
le rappel de M. Necker. Tout ce peuple immense nous priait de
demander M. Necker au roi. Les prières d’un peuple sont des
ordres. Il faut donc que nous demandions le rappel de M. Necker».32
Le mot de Furet et de Richet est alors repris par Bredin : «Voici
le banquier genevois revenu comme un sauveur».33
La
bourgeoisie du Tiers avait trouvé son sauveur en la personne du
banquier genevois. Pourtant, jusqu’à quel point pouvons-nous
considérer les banquiers de l’époque comme d'authentiques
personnalités providentielles? Quoi qu’il en soit, le premier
sauveur reconnu par la Révolution elle-même fut donc bien l’un
d’entre eux, et cela tant par le Roi que par l’Assemblée.
Banquier étranger (suisse), protestant (donc inapte au Ministère),
libéral (mais interventionniste), toute l’ambiguïté (baroque?)
du personnage conduisait la France à la servitude financière et à
la ferveur populaire. Véritable magicien parce qu’il préférait
les emprunts financiers aux ponctions fiscales, l’adulation portée
à Necker en fit bien un héros populaire. Les Mirabeau et les La
Fayette ne vinrent qu’après la disgrâce de Necker… auprès de
l’Assemblée (18 septembre 1790). Le sauveur
à la petite caisse
est un type non retenu par Toynbee, pourtant l'idealtypus
dépassait les personnes de Turgot et de Necker. Le renvoi de Turgot,
rappelons-le, avait sonné le glas du despotisme éclairé en France;
celui de Necker sonna tout simplement celui de la monarchie
constitutionnelle. On vit bien un troisième financier, Clavière,
joint à la politique de la Gironde, être renvoyé par le roi en
juillet 1792, et le renvoi de Clavière sonna cette fois le glas et
de la monarchie… et du monarque. Des financiers de la spéculation
et de l’agiotage tels les frères Frey, Proli, l’abbé d’Espagnac
et autres firent perdre la tête à Hébert et aux principaux
dirigeants cordeliers tandis que la duplicité d’un Perrégaux
n’est pas étrangère à la chute de Robespierre. Il est
significatif que la fille du banquier Cabarrus, devenue la femme du
conventionnel Tallien, fut considérée comme l’intercesseur pour
la grâce de nombreuses vies : «On
voyait partout Mme
Tallien. Ci-devant marquise de Fontenay, Thérésa Cabarrus avait
enfin épousé son sauveur. Elle fut à son tour la protectrice des
anciens Feuillants ou Girondins, qui la saluèrent comme “Notre-Dame
de Thermidor”, ou “Notre-Dame du Bon Secours”. Le vieux Charles
de Lacretelle se souvenait encore de celle qui lui semblait, en 1794,
“l’humanité incarnée sous les formes les plus ravissantes”».34
On aurait tort de ne voir là que ruse de la raison ou ironie de
l’histoire, car tous ces noms qui, avec celui d’Ouvrard, allaient
symboliser la corruption du pouvoir par la finance, définissaient ce
qu’allait être le monde de demain. L’héroïsme des Volontaires
de l’an II, la tragédie des orateurs et des journalistes de la
Convention, la grandeur de Napoléon et l’extension maxima de son
Empire pesèrent de peu de poids devant la réalité du pouvoir
social et idéologique de ce nouveau monde de la finance qui naquît
de la Révolution. La reconnaissance de sauveurs dans ces personnages
équivoques qui, de Necker à Ouvrard et aux deux
cents familles à
l’origine de la Banque de France constituée par une loi du
Consulat - les fameuses dynasties
bourgeoises de
Beau de Loménie -, révèle la véritable morale de l’histoire
contenue dans la mystique de la période de désagrégation de la
civilisation occidentale. Pour Jean-Marie Domenach, «le
capitalisme, après avoir détruit l’ordre traditionnel, s’est
montré incapable de le remplacer, préparant ainsi le terrain à
l’avènement des brutes. Lorsqu’un système fondé sur le profit
entre en crise, il ne trouve plus de ressource dans les valeurs et
les élites qu’il a anéanties ou corrompues. Spontanément
surgissent alors des “sauveurs” qui proclament l’état de
détresse, la supériorité de la force sur le droit, l’inégalité
fondamentale des individus et des groupes. Non seulement ils
entraînent une grande partie du peuple, mais ils obtiennent avec une
étonnante facilité l’adhésion ou la complicité des autorités
établies».35
Domenach pense ici aux régimes fascistes, mais on ne saurait mieux
exposer les intérêts financiers derrière la mystique du sauveur
au glaive
dans le contexte des crises révolutionnaires de l’Occident
contemporain. Ce rapport de l’argent et de la force qui émergea de
la tourmente révolutionnaire devait conduire à la dictature de
Bonaparte avant celles de Mussolini et de Hitler ou d'autres petits
tyrans tristement dérisoires de l’Europe du XXe siècle. Les
Américains ont-ils donc raison de considérer que leur révolution,
suivie de sa période constitutionnelle troublée, était
essentiellement tournée vers la prise en main de
l’auto-détermination au niveau national, alors que la Révolution
française conserve, même de nos jours, toutes les apparences de ce
qu’on appellerait un État
en
gestion de
crise, et
qu’il s’agissait là d’une crise structurelle profonde qui
était celle de l’Europe entière? - En tout cas, elle est devenue,
depuis, celle de toute la civilisation occidentale.
1
A.-J. Toynbee. op. cit. pp. 582-583. * Prolétariat est à entendre
ici au sens de Tiers-État. ** Ces personnalités exceptionnelles
seraient moins le groupe des
révolutionnaires que l'élite constituée
de la frange innovatrice de la noblesse d'Ancien Régime et la
haute-bourgeoisie entrepreneurial.
Compte tenu de ces deux nuances, le schéma théorique général de
Toynbee s'applique particulièrement bien au contexte de la
Révolution française où une minorité créatrice
s'apprête à prendre la
succession d'une minorité dominante
ayant perdu le contrôle du développement de la civilisation.
2
E. Buch. op. cit. p. 11.
3
A. J. Toynbee. op. cit. p. 583.
4
A. J. Toynbee. Ibid. p. 584. * Les cas de George Washington et de
Napoléon Bonaparte sont exemplaires de cette fascination
puisque placés à l'issu des deux révolutions atlantiques.
5
A. Soboul. op. cit. 1982, p. 42.
6
G. Chaussinand-Nogaret. op. cit. 1982, p. 197.
7
G. Chaussinand-Nogaret. Ibid. p. 165.
8
Cité in G. Chaussinand-Nogaret. Ibid. p. 278.
9
G. Lefebvre, cité in J.-B. Duroselle. op. cit. p. 42.
10
A. Soboul, préface à G. Lefebvre. op. cit. 1966, p. 12.
11
J. Lessay, corrigeant l'opinion de Rivarol. op. cit. p. 146.
12
M. Ferreira. op. cit. p. 38.
13
M. Cunliffe. op. cit. p. 91.
14
A. Ollivier. op. cit. pp. 291-292.
15
M. Gallo. op. cit. 1968, p. 167.
16
C. D. Bowen. op. cit. p. 97.
17
R. Mauzi. op. cit. pp. 257-258.
18
G. Walter. op. cit. 1933, p. 37.
19
D. Lacorne. op. cit. p. 252.
20
A. Kaspi. op. cit. 1973, p. 73.
21
Cité in M. Cunliffe. op. cit. p. 33.
22
M. Cunliffe. Ibid. pp. 227-228.
23
C. Cestre, préface à W. Wilson. op. cit. p. 9.
24
A. Kaspi. op. cit. 1976, p. 199.
25
C. D. Bowen. op. cit. p. 64.
26
É. Marienstras. op. cit. pp. 398-399.
27
W. Wilson. op. cit. p. 120. * Wilson voit Washington des fenêtres
de son Université de Princeton un peu comme Hegel avait entrevu
Napoléon à travers la brèche ouverte par un boulet de canon, dans
le mur de sa bibliothèque, après la bataille de Iéna.
28
J. R. Alden. op. cit. pp. 388-389.
29
M. Cunliffe. op. cit. pp. 24 et 32.
30
M. Ferro. op. cit. p. 541.
31
F. Furet et D. Richet. op. cit. p. 58.
32
Cité in J. Godechot. op. cit. 1966, p. 395.
33
J.-D. Bredin. op. cit. p. 99.
34
F. Furet et D. Richet. op. cit. p. 279.
35
J.-M. Domenach. op. cit. p. 154.
La tourmente révolutionnaire, vol. 3.
Le texte intégral de l'ouvrage en 3 vols est disponible sur Google Drive.

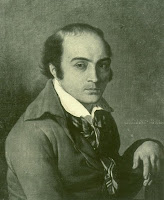


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire