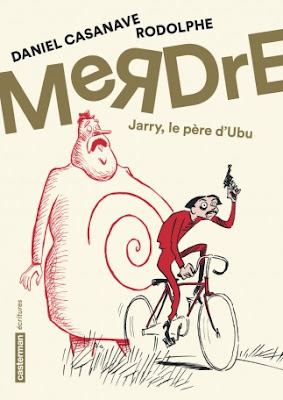ANUS MUNDI
(extraits)
 |
|
Découverte de charniers lors de la libération du camp de Bergen-Belsen, Allemagne |
Sommaire
HISTORICITÉ
I. DES FONDEMENTS DE L'ANUS MUNDI
I.1 Questions d'histoire...
I.2 De l'analité comme sens de l'unité de la civilisation occidentale
I.3 Le sentiment d'apocalypse comme sensation d'expulsion
I.4 Structure obsessionnelle de l'Anus Mundi
I.5 La conscience occidentale découvre les pulsions de mort
I.6 Les origines bourgeoises et industrielles de l'Anus Mundi
I.7 De la transcendance du pouvoir à la matérialité des régimes
I.8 La jeunesse dans la mire de la gérontocratie occidentale
II. LE DÉCLIN DE L'OCCIDENT
II.1 Le poétique du déclin de l'OccidentII.1.1 «Les yeux grands ouverts, en pleine conscience»
II.1.2 La loi de l'entropie
II.1.3 Dissolution
II.1.4 De l'auto-altération
II.1.5 Le suicide moral
II.1.6. Faillite de l'auto-détermination
II.2 La double schize occidentale
II.2.1 De la déspécification
II.2.2 Le Propriétaire
II.2.3 Le Citoyen
II.2.4 L'Homme-Machine
II.2.5 La brutalisation du Sujet kantien
II.3 Historicité russe
II.3.1 De la Russie et de l'Occident
II.3.2 Slaves
II.3.3 Byzance
II.3.4 La chrétienté orthodoxe
II.3.5 La révolution pétrovienne
II.3.6 L'Intelligentzia
II.3.7 Occidentalistes et Slavophiles
II.3.8 Le défi de la modernisation
II.3.9 Qu'appelle-t-on «L'âme russe»?
II.4 Historicité juive
II.4.1 Juifs et Occidentaux
II.4.2 Historicité juive négative
II.4.3 Historicité juive positive
II.4.4 De l'antijudaïsme à l'antisémitisme
II.4.5 La Völkerwanderung ostjuden
II.4.6 L'effet de la Grande Guerre sur l'historicité juive
II.5 Historicité allemande
II.5.1 L'impossible unité allemande
II.5.2 Le poids des nations étrangères sur la formation de l'Allemagne
II.5.3 L'Allemagne faustienne
II.5.4 L'Esprit contre l'État
II.5.5 La nouvelle mythologie germanique
II.5.6 La Question allemande
II.5.7 Histoire constitutionnelle de l'Allemagne
II.5.8 Le miroir aux alouettes
II.5.9 L'Allemand de 1871
II.5.10 Les paranoïas allemandes
II.5.11 Culpabilités historiques
II.5.12 Intentionnalisme et fonctionnalisme
II.5.13 L'Allemagne entre archaïsme et futurisme
II.6 Percussion entre États universels
II.6.1 L'idée d'État universel au Moyen Âge au XIXe siècle
II.6.2 L'idée d'État universel à l'époque moderne
II.6.3 L'Empire colonial comme première forme d'État universel
II.6.4 L'Impérialisme stade suprême de l'État universel?
II.6.5 L'État universel russe comme source de paranoïas occidentales
II.6.6 Mare Nostrum et Troisième Reich
III. CONVERGENCES CONCENTRATIONNAIRES
III.1 Logique des contingences
III.1.1 Des camps de concentration
III.1.2 D'Auschwitz au Goulag
III.1.3 Hôpitaux et camps américains
III.1.4 Autres peuples, autres camps
III.1.5 À la recherche d'une définition
III.1.6 Contingences concentrationnaires
III.2 Des gaz aux fours crématoires
III.2.1 De Profundis
III.2.2 La guerre chimique
III.2.3 Les chambres à gaz
III.2.4 Redécouverte de la crémation
III.2.5 Du fourneau au crématoire
III.3 Des usines aux camps
III.3.1 D'une cheminée l'autre
III.3.2 Efficacité et profits
III.3.3 Usines et prisons
III.3.4 Usines et guerres
III.4 Des réserves aux camps
III.4.1 Le parc colonial
III.4.2 Les sources nord-américaines
III.4.3 Le pivot axial : la guerre des Boers
III.4.4 Les camps français
III.4.5 L'impact des deux guerres mondiales
III.4.6 Le Goulag
III.4.7 La synthèse allemande
III.5 L'obsession hygiéniste
III.5.1 Puer n'est pas tuer
III.5.2 Les voies de l'hygiène
III.5.3 Péril vénérien et Tibi
III.5.4 L'abject
III.5.5 La promiscuité de la foule
III.5.6 Bouillon de culture de haine
III.6 L'idéologie française
III.6.1 B.H.L. entre Paxton et Sternhell
III.6.2 Alors? Pourquoi pas en France?
III.6.3 Et pourquoi l'idéologie française?
III.6.4 Le contenu problématique de l'idéologie française
III.6.5 L'Affaire
III.6.6 Ni... ni... peau d'chien
III.6.7 De la France et de l'Allemagne
III.7 Slaughterhouse
III.7.1 Delicatessen
III.7.2 De la condition animale en Occident
III.7.3 De la boucherie
III.7.4 Des abattoirs à ciel ouvert
III.7.5 Des abattoirs aux massacres
III.7.6 De la guerre comme abattoir de masse
III.7.7 L'abattoir pasteurisé
III.7.8 Antithèse ou synthèse du cuit et du crû?
III.8 Enchaînement de circonstances
III.8.1 Des conjonctures
III.8.2 Des coïncidences
III.8.3 Du Destin
IV. DE LA FATALITÉ DE LA GUERRE CIVILE
IV.1 Logique de nécessité
IV.1.1 Amor fati
IV.1.2 Nécessité fait loi
IV.1.3 De la nécessité de l'État fort
IV.1.4 La nécessité historique à l'œuvre
IV.1.5 La Shoah dans la guerre civile occidentale
IV.1.6 La symphonie des angoisses
a) L'angoisse vitale
b) L'angoisse psychique
c) L'angoisse historique
d) L'angoisse existentielle
e) L'angoisse métaphysique
IV.2 L'esprit de la guerre civile
IV.2.1 L'effondrement
IV.2.2 La révolution gelée
IV.2.3 La guerre civile occidentale
IV.2.4 La Seconde Guerre de Trente Ans
IV.3 Dialogique des conflits
IV.3.1 La guerre de Sécession
IV.3.2 La guerre de 1870 et la Commune de Paris
IV..3.3 Agitations de surface
IV.3.4 La Grande Guerre
IV.3.5 La Révolution russe
IV.3.6 La guerre civile d'Espagne
IV.3.7 La Seconde Guerre mondiale
V. HYGIE
V.1 Clio et Hygie
V.2 Pollutions
VI. CRISE DE L'ÉPISTÉMOLOGIE MODERNE
VI.1 Expérimentations
VI.2 Panlogisme
VII. CRISE DE LA FOI MODERNE
VII.1 Un siècle irréligieux?
VII.2 Les sciences dites occultes
VII.3 Un revival religieux?
VII.3.1 Le réveil catholique
VII.3.2 La confrontation irréligieuse
VII.3.3 Le triomphe de l'anticléricalisme
VII.3.4 Littéraires et artistes au secours du catholicisme
VII.3.5 Des grands réveils nord-américains
VII.3.6 Transfert de la sacralité sur l'État
VIII. LES MODERNITÉS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
VIII.1 Réalisme et naturalisme
VIII.2 Le symbolisme
VIII.3 L’impressionnisme
VIII.4 Modern style et Avant-Garde
VIII.5 L'expressionnisme
VIII.6 Cubisme et futurisme
VIII.7 Du réalisme socialiste au proletkult
VIII.8 Dada et surréalisme
VIII.9 La première société du spectacle
VIII.10 La Galaxie Marconi
VIII.11 Photographie et cinéma
VIII.12 Littératures
IX. LA SECONDE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
IX.1 Économie et sociétés
IX.2 Crises économiques ou la poursuite de la guerre par d'autres moyens
IX.2.1 Des crises économiques
IX.2.2 La crise de 1873
IX.2.3 De 1873 à 1929 : crises occidentales
IX.2.4 Le krach de 1929
IX.2.5 La crise des années trente
IX.2.6 La diffusion européenne de la crise de 1929
X. ONTOLOGIE
X.1 Anthropologique
X.2 Le délire ontologique
X.3 Le surhomme
X.4 Les sous-hommes
XI. SOCIÉTÉS DE MASSES
XI.1 Sociologie historique
XI.2 La société de masse, stade suprême des sociétés fermées?
XII. QUEL ÉTAT POUR LA SOCIÉTÉ DE MASSES?
XII.1 Domination, Puissance et pouvoirs
XII.2 La nation comme phénomène de psychologie collective
XII.3 Théories de la nation
XII.3.1 Origines du concept de nation
XII.3.2 Nation civique et nation ethnique
XII.3.3 Critiques de la nation
XII.3.4 France : nation-modèle
XII.3.5 Vers le nationalisme fasciste
XII.3.6 De l'idée au sentiment national
XII.4 De la biocratie
XII.4.1 Lassitude de la vie
XII.4.2 Les biopouvoirs
XII.5 L'âge des extrêmes
XII.6 De l'État total
XIII. IMAGINAIRE HISTORIOGRAPHIQUE À L'ÂGE DE L'ANUS MUNDI
XIII.1 Temps et formes
XIII.1.1 Du temps et des formes
XIII.1.2 Bergson : durée et mémoire
XIII.1.3 Proust : le temps perdu retrouvé
XIII.1.4 Einstein : le temps en relativité
XIII.1.5 La génération du Zeitgeist de la Grande Guerre
XIII.2 De la mémoire
XIII.3 Le mythe de l'éternel retour
XIII.3.1 Les spécificités de l'éternel retour
XIII.3.2 La conception nietzschéenne de l'éternel retour
XIII.3.3 L'éternel retour à la rencontre de la répétition historique
XIII.3.4 La répétition historique comme avatar de l'éternel retour
XIII.4 Des mythes aux mythistoires
XIII.4.1 Du mythe sorélien
XIII.4.2 Du mythe révolutionnaire
XIII.4.3 Le mythe du Peuple-élu
XIII.4.4 Le mythistoire russe
XIII.4.5 Mythistoires d'Amérique du Nord
XIII.5 Les philosophies de l'histoire XIXe-XXe siècles
XIII.5.1La postérité hégélienne à travers le marxisme
XIII.5.2 Le retour de Hegel chez Gramsci
XIII.5.3 Retour de la théologie de l'histoire
XIII.5.4 Errance de la philosophie de l'histoire
XIII.5.5 Le néo-kantisme du tournant du XXe siècle
XIII.5.6 Influences de Pareto dans les philosophies de l'histoire
XIII.5.7 Le relativisme crocien
XIII.5.8 L'errence heideggerienne
XIII.5.9 ...et Adolf Hitler? Philosophe de l'histoire?
XIII.6 Vers l'existentialisme allemand et l'histoire de l'Être
XIII.6.1 Nietzsche : De l'éternel retour à la fin de l'histoire
XIII.6.2 Nietzsche : D'Appolon et de Dionysos
XIII.6.3 Nietzsche : La Seconde Considération intempestive
XIII.6.4 Dilthey et l'herméneutique
XIII.6.5 Heidegger et l'historialité
XIII.6.6 Jaspers : du temporel à l'éternel
XIII.7 Historiographie entre positivisme et relativisme
XIII.7.1 L'histoire entre chien et loup
XIII.7.2 Pour la suite de l'histoire
XIII.7.3 1870, Annus mirabilis de l'historiographie occidentale
XIII.7.4 Le positivisme comme philosophie
XIII.7.5 Le positivisme comme épistémologie
XIII.7.6 Le positivisme comme historiographie
XIII.7.7 Critique du positivisme en histoire
XIII.7.8 Le subjectivisme comme réaction
XIII.7.9 Le relativisme en histoire
XIII.7.10 Le présentisme en histoire
XIII.8 Explication & compréhension en histoire
XIII.8.1 Dilthey et le »cercle herméneutique»
XIII.8.2 Explication & compréhens
XIII.9 La triade Renan, Taine, Fustel
XIII.9.1 De l'orientalisme en guide d'introduction
XIII.9.2 Ernest Renan (1823-1892)
XIII.9.3 Hippolyte Taine (1828-1893)
XIII.9.4 Numa Fustel de Coulanges (1830-1889)
XIII.10 De Burckhardt et de Croce
XIII.10.1 Jacob Burckhardt (1818-1897)
XIII.10.2 Benedetto Croce (1866-1952)
XIII.10.3 Croce eet son relativisme en histoire
XIII.11 Le cas Spengler
XIII.11.1 La confusion K/Z
XIII.11.2 Kultur et civilisation
XIII.11.3 De l'évolutionnisme entre Kultur et Zivilisation
XIII.11.4 Spengler et le déclin de l'Occident
XIII.11.5 Spengler philosophe
XIII.11.6 Spengler philosophe de l'histoire
XIII.11.7 Âme apollinienne et âme faustienne
XIII.11.8 Résurrections de Spengler
XIII.12 De la théorie et de la pratique de l'histoire nationale
XIII.12.1 Du patriotisme avant toutes choses
XIII.12.2 Théorie de l'histoire nationale
XIII.12.3 Conscience historique et familienroman national
XIII.12.4 Pratique de l'histoire nationale
XIII.12.5 Comment on raconte l'histoire aux enfants
XIII.12.6 Pratique du familienroman national français
XIII.12.7 Pratique du familienroman national canadien
DE LA CONSCIENCE HISTORIQUE À L'ÂGE DE L'ANUS MUNDI
SIGNIFICATION
I. LA BELLE INVENTION DE BENEDICT MOREL...
I.1 De la dégénérescence
I.1.1 De la dégénérescence à la régression
I.1.2 Les pathologies collectives
I.2 De l'évolutionnisme naturel à l'évolutionnisme social
I.2.1 L'évolutionnisme naturel
I.2.2 L'évolutionnisme social
I.2.3 Application politique de l'évolutionnisme
I.3 De l'esthétique du sang
II. LA RÉGRESSION SADIQUE-ANAL
II.1 Rappel de la théorie des stades de développement libidinal
II.2 L'âge du sadisme-anal
II.2.1 De l'analité au sadisme
II.2.2 Le temps de l'abjection
II.2.3 Perversions polymorphes liées à l'analité
II.2.4 La nécrophilie, stade suprême de la régression sadique-anale
II.2.5 L'humour noir
II.2.6 L'amour mise à mal
II.2.7 La propreté de la merde
II.2.8 Le puritanisme pervers du victorianisme
II.2.9 La perversion binaire : rétention et expulsion
II.3 Des troubles obsessifs-compulsifs
II.3.1 Le phénomène de compulsion obsessionnelle
II.3.2 Des dépressionnaires
II.3.3 Des compulsifs
II.3.4 La martingale des spéculateurs
II.3.5 L'érotomanie morbide
II.3.6 Des ressentiments
II.3.7 Apothéose de la nécrophilie
II.4 Le voyeurisme métaphysique
II.5 Le rire brun
II.6 L'école gothique
II.6.1 L'école de la République
II.6.2 Les public schools britanniques
II.6.3 Le monde germanique
II.6.4 L'éducation répressive
II.6.5 Les révoltes étudiantes
II.6.6 L'antichambre de la caserne
II.7 Cruauté active
II.7.1 Qu'est-ce que la cruauté?
II.7.2 Les métamorphoses
II.7.3 Du goût de la destructivité
II.7.4 De la cruauté morale
II.7.5 Intoxication et rumeurs
II.7.6 De la sociopathie
II.7.7 De la cruauté mentale
II.7.8 De la cruauté active
II.8 L'amour au temps du choléra
II.8.1 Absence de l'amour
II.8.2 L'amour de la haine
II.8.3 L'amour exclue des liens sociaux
II.8.4 L'amour volage au temps du choléra
II.8.5 L'amour tendre au temps du choléra
II.8.6 L'amour folie au temps du choléra
II.8.7 L'amour tragique au temps du choléra
II.9 Les mécanismes de la régression
II.9.1 De la régression
II.9.2 Atavismes
II.9.3 Fantasmes régressifs
II.9.4 De la rigidité de l'esprit
II.9.5 La dynamique des atavismes de masse
II.9.6 Un certain goût en bouche
III. IMPACTS DE L'EFFACEMENT DE LA FIGURE MATERNELLE SUR LA NATION
III.1 La figure maternelle
III.2 La Mère-Nation
III.3 Le sentiment national
IV. IMPACTS DE LA CRISE DE LA FIGURE PATERNELLE SUR L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT
IV.1 Être père
IV.2 La crise de la figure paternelle sur l'État
IV.3 Les gérontocrates
IV.3.1 L'Empereur de tous les malheurs
IV.3.2 L'Empereur fantasque
IV.3.3 Le Père absent
IV.3.4 Le génocide familial
V. LES DILEMMES DE L'ENFANT-PEUPLE
V.1 Retour sur le malheur russe
V.2 Le clan des Frères
V.2.1 Le parricide se paie du prix de la guerre civile
V.2.2 Des meneurs
V.2.3 L'organisation de la fraternité
V.2.4 Les faux-frères
V.2.5 Des guerres civiles
V.3 Des bâtards... partout!
V.3.1 Les bâtards de l'âge de l'Anus Mundi
V.3.2 Les enfants-trouvés de l'âge de l'Anus Mundi
V.3.3 Entre parthénogénèse et palingénésie
V.4 Des homos... !
V.4.1 La gynophobie précède l'homophobie
V.4.2 L'homosexualité à l'âge de l'Anus Mundi
V.4.3 Lieux de transferts de l'homosexualité individuelle à l'homoérotisme collectif
V.4.4 Affirmation de la condition homosexuelle
V.4.5 Les affaires Wilde et Eulenburg
V.4.6 L'homosexualité larvée du régime nazi
V.4.7 L'homosexualité pénètre le monde littéraire
V.4.8 La contamination orientale
V.4.9 La décriminalisation progressive de l'homosexualité
V.5 Des jeunes... partout!
V.6 Furie révolutionnaire
V.7 Führerprinzip
VI. PÉRIL EN LA DEMEURE
VI.1 Défaillance du roman familial
VI.1.1 Transfert du familial au social
VI.1.2 Le génocide familial des Romanov
VI.1.3 Effets de la dépopulation sur la structure familiale
VI.1.4 Atavismes héréditaires
VI.1.5 L'explosion du couple bourgeois
VI.1.6 Des parents et des enfants
VI.1.7 Défense de la famille
VI.1.8 La lutte des sexes comme facteur de désagrégation de la famille
VI.1.9 Du familienroman au nationalerroman
VI.2 Totem et tabou
VI.3 L'énigme policière
VI.4 Le pattern de Vercingétorix
VI.5 La révolte contre le père
VI.6 La rencontre du pot de chambre et du pot de fer
VI.6.1 Le névrosé et le paranoïaque
VI.6.2 Face à la souillure
VI.6.3 Névrosés et paranoïaques devant le familienroman
VI.6.4 Névrosés et paranoïaques devant l'État
VI.6.5 Névrose religieuse
VI.6.6 Névrose de guerre
VI.6.7 Psychose paranoïaque
VI.7 L'infanticide qui ne dit pas son nom
VI.7.1 La guerre comme anus collectif
VI.7.2 Résurrection du culte de la force
VI.7.3 La captation des enfants
VI.7.4 L'État pervers contemporain
VI.7.5 Retour de la machiavélisation de l'Éros
VI.7.6 De la pédophtorie d'État
VI.7.7 Les festins de Moloch
VI.7.8 La guerre est la santé de l'État et la mort des enfants
VII. UNE CULTURE DE LA HAINE
VII.1 Anxiétés des classes moyennes
VII.1.1 Les classes moyennes et leurs prédispositions au fascisme
VII.1.2 Anxiétés bourgeoises
VII.1.3 Des dépressions
VII.1.4 Sources anxiogènes
VII.2 La culture de la haine
VII.2.1 Les haines politiques
VII.2.2 Haine et psychohistoire
VII.2.3 Les haines littéraires
VII.2.4 La répulsion
VII.2.5 Les races
VII.2.6 Les nécessités domestiques
VII.2.7 Les ressentiments
VII.2.8 Haines sociales
VII.2.9 Haines religieuses
VII.2.10 Une haine radicale : Charles Maurras
VII.2.11 Haines internationales
VII.3 Duel, guerre, suicide
VII.3.1 Éthologie du duel
VII.3.2 L'esprit d'affrontement
VII.3.3 Éthologie du suicide
VII.3.4 Art et suicide
VII.3.5 Suicide et crise économique de 1929
VII.3.6 De la guerre au suicide
VII.4 Doppelgänger
VII.4.1 Hystéries
VII.4.2 Inversion du double
VII.4.3 Le phénomène du dédoublement
VII.4.4 Nature du double
VII.4.5 Le double criminel
VII.4.6 Le double abjectivé
VII.4.7 Doppelgänger et paranoïa
VII.5 Dolchstoß
VII.6 Haine du corps
VII.6.1 «Nous ne dirons rien de leurs femelles par respect pour les femmes...»
VII.6.2 Mâles absents?
VII.6.3 Haines exotiques
VII.6.4 Effroi et pudeur
VII.6.5 Pudeur et perversions
VII.6.6 De la prostitution
VII.6.7 De la répression sexuelle
VII.6.8 Naissance de la sexologie
VII.7 Gothique tropical
VII.7.1 La nouvelle conquista
VII.7.2 Les nouveaux conquistadores
VII.7.3 Émergence du primitif en Occident
VII.7.4 Le stade du miroir, à nouveau fracassé
VII.7.5 La ballade de Voulet et Chanoine
VII.7.6 De la répression coloniale
VII.7.7 Érotisme et exotisme
VII.7.8 Le martyre des Congolais
VII.7.9 Vers la libération?
VII.8 Une culture de la paranoïa
VII.8.1 La traversée des peurs paniques
VII.8.2 Paranoïa, retour théorique
VII.8.3 L'Internationale
VII.8.4 Peur des Allemands
VII.8.5 Du rôle des complots
VII.8.6 Des infiniment petits aux grandes menaces
VII.8.7 Le sang juif
VII.8.8 Complots sexuels
VII.8.9 Des sauvages et des barbares
VII.8.10 Paranoïa religieuse
VII.8.11 De la paranoïa non-critique
VII.8.12 L'avancée spartakiste
VII.8.13 Le spectre du bolchevique le couteau entre les dents
VII.8.14 Le bolchevisme comme généalogie du fascisme
VII.8.15 La paranoïa, aboutissement concret
VIII. DES FOULES ET DE LEURS CHEFS
VIII.1 Une civilisation de foules
VIII.1.1 Foules émeutières ou prises de panique?
VIII.1.2 La foule comme phénomène de psychologie collective
VIII.1.3 Les foules féminines
VIII.1.4 Médecins des foules... Le Bon, Tarde, Seghele, Freud
VIII.1.5 Chefs de foules
VIII.2 Motivation, manipulation, fascination, mysticisme
VIII.2.1 Motivations totalitaires
VIII.2.2 Quelques cas, en passant
VIII.2.3 Le cas russe
VIII.2.4 Manipulations de foules
VIII.2.5 Goût de la guerre
VIII.2.6 Fascination morbide
VIII.3 Hypnose et auto-suggestion comme instruments des motivations totalitaires
VIII.3.1 L'hypnose
VIII.3.2 Les somnambules
VIII.3.3 L'auto-suggestion
VIII.3.4 Le cœur conscient/inconscient
VIII.3.5 L'hypnose collective
VIII.4 Des chefs charismatiques
VIII.4.1 Du despotisme
VIII.4.2 Définition du pouvoir charismatique
VIII.4.3 Des chefs politiques
VIII.4.4 Le culte de la personnalité
VIII.4.5 La personnalité du chef charismatique
IX. SOURCES DE L'IMPULSION BELLIQUEUSE
IX.1 Le mythe de la grève générale
IX.1.1 La grève comme confrontation ouvrière
IX.1.2 Grèves et impulsions belliqueuses
IX.1.3 La grève générale comme mythe
IX.1.4 La fin d'un mythe
IX.2 Les paradoxes de l'hypertonie belliqueuse
IX.2.1 L'hypertonie belliqueuse
IX.2.2 Hypertonie et atonie
IX.2.3 L'atonie comme effet des horreurs de la guerre
IX.2.4 Guerre pour causes morales et retour de l'hypertonie
IX.3 Des uniformes colorés aux chemises monochromes
IX.3.1 L'uniforme comme porteur de virilité
IX.3.2 L'uniforme comme porteur d'autorité
IX.3.3 Uniforme scolaire et scoutisme
IX.3.4 Uniforme et discipline
IX.3.5 Chemises monochromes de toutes les couleurs
IX.4 Guerre ludique
IX.4.1 Les rossignols du carnage
IX.4.2 Soldats de plomb en perte d'honneur
IX.4.3 La guerre est une fête
IX.4.4 La guerre est un sport
IX.5 Guerre expiatrice
IX.5.1 Jugement
IX.5.2 Châtiment
IX.5.3 Rachat
IX.6 Guerre exterminatrice
IX.6.1 L'Ange exterminateur
IX.6.2 Colonies, Fascismes, Camps
IX.6.3 La reprise du Drang nach osten
IX.6.4 Le concept de guerre totale
IX.6.5 La guerre totale : première phase
IX.6.6 La guerre totale : seconde phase
IX.7 Guerre esthétique
IX.7.1 Comment l'art ouvrit l'esprit aux guerres mondiales
IX.7.2 Guerre esthétique et homoérotisme
IX.7.3 L'esthétique de la guerre
IX.7.4 L'esthétisme de la guerre
X. HYGIÈNE RACIALE
X.1 L'odorat
X.1.1 La puanteur publique
X.1.2 Métaphores olfactives
X.1.3 Odeurs et érotisme
X.1.4 Refoulement d'égout
X.1.5 L'odeur de la race
X.1.6 Les odeurs de la guerre
X.2 Dans la solitude des marécages
X.2.1 Approche théorique
X.2.2 Retour du gibet
X.2.3 Des métaphores littéraires de la fange
X.2.4 Des métaphores politiques de la fange
X.2.5 Des marais et des cadavres
X.2.6 Dans les marécages américains
X.2.7 Les marécages de la Grande Guerre
X.2.8 Les marécages de Russie
X.3 Cadavres exquis
X.3.1 Le cadavre
X.3.2 Le goût d'un cadavre
X.3.3 Le cadavre comme charogne
X.3.4 La désodorisation des cadavres
X.3.5 La douloureuse avancée de l'armée des ombres
X.3.6 L'érotisme du cadavre
X.4 Mutilations, amputations et prothèses
X.4.1 La reconstruction du général John A.B.C. Smith
X.4.2 L'amputation/castration dans les arts plastiques
X.4.3 Le «monstre» de Freud
X.4.4 Disjecta Membra
X.4.5 Prothèses
X.4.6 Des nations amputées
X.5 Un monde étroniforme
X.5.1 L'excrément
X.5.2 Évacuation
X.5.3 Cette «merde morale où nous pataugeons»
X.5.4 De l'angoisse au complexe de castration
X.6 Hygiène et races
X.6.1 De l'hygiène à l'épuration
X.6.2 De la notion de races
X.6.3 Des classes et des sexes
X.6.4 Blancs sur noirs
X.6.5 Des Juifs et des Occidentaux
X.6.6 Les objectifs fantasmatiques de l'eugénisme
XI. MORT DE L'ART?
XI.1 Un thème rémanent : la mort de l'art
XI.1.1 La mort de l'art
XI.1.2 Apologie de la laideur
XI.1.3 L'évolution des genres
a) De l'impossible réalisme
b) De l'impressionnisme à la faillite du cubisme
c) Décadents et art nouveau
d) De la photographie
X.1.4 Le triomphe de l'art pour l'art
X.1.5 Du surréalisme...
X.1.6 ...au fascisme
X.2 L'académisme, la tuberculose de l'art
X.2.1 La persistance du classicisme
X.2.2 L'académisme comme avatar du classicisme
X.2.3 La lutte contre l'académisme
X.3 La catalepsie : le nu sclérosé
XI.3.1 Entre nudité et érotisme
XI.3.2 Nudité et fascismes
XI.4 L'éléphantiasis : l'architecture mégalomane
XI.4.1 Les sources du XIXe siècle
XI.4.2 Les recherches du XXe siècle
XI.4.3 Architectures totalitaires
XI.4.4 Le monumentalisme allemand
XI.5 L'abrutissement : le Kitsch
XI.5.1 Définition
XI.5.2 Critique du Kitsch
XI.5.3 Le fétichisme de la marchandise kitsch
XI.6 Les grands moments de l'efflorescence artistique moderne
XI.6.1 La morbidezza vénitienne
XI.6.2 Les gaietés parisiennes
XI.6.3 Vienna fin-de-siècle
XI.6.4 Le cercle de Bloomsbury
XI.6.5 La culture de Weimar
XI.6.6 La culture sous l'Allemagne wilhelminienne
XI.6.7 La Kultrurpessimismus allemande
XI.6.8 Le régime de Weimar
XI.6.9 La culture de Weimar
XI.6.10 La fin de l'expressionnisme allemand
XI.6.11 La Neue Sachlichkeit
XI.6.12 Le Bauhaus
XII. MORT DE DIEU ET TRIOMPHE DE SATAN
XII.1 Danses macabres
XII.1.1 Les morts
XII.1.2 La danse macabre
XII.1.3 Entrechats de loups
XII.1.4 La grande danse macabre de Trente Ans
XII.1.5 La sarabande
XII.2 Dieu est mort, vive Satan!
XII.2.1 ...Dieu est mort!
XII.2.2 Dieu et Satan
XII.2.3 Portrait de Satan
XII.2.4 Partisans de Satan
XII.2.5 Un Satan absolument moderne
XII.2.6 Le culte de l'obscénité et l'obscénité du culte
XII.2.7 Devant la malignité
XII.2.8 Malignité politique : la Révolution
XII.2.9 Malignité politique : les sociétés secrètes
XII.2.10 Le cas Taxil
XII.2.11 Le cas Huysmans
XII.2.12 Le cas Hitler
XII.3 Des éjaculations ectoplasmiques aux embryons oniriques
XII.3.1 Une pénétrable atmosphère de hantise
XII.3.2 La galerie spirite
XII.3.3 L'escadron du guéridon
XII.3.4 Des fantômes et des revenants
XII.3.5 Spectres de guerre
XII.4 Des labyrinthes
XII.4.1 Du labyrinthe de la solitude
XII.4.2 La fonction religieuse du labyrinthe
XII.4.3 Vers la Swastika
XII.4.4 Le labyrinthe de la littérature
XII.4.5 Le Swastika
XII.5 Archaïsme et métamorphose
XII.5.1 Retour sur la métamorphose
XII.5.2 Les petits et les gros
XII.5.3 Des hommes et des bêtes
XII.5.4 Du vampirisme comme métaphore
XII.5.5 Des origines du vampirisme occidental
XII.5.6 Du vampirisme au cannibalisme
XII.5.7 Dracula – Hitler - Staline
XII.6 Futurisme et métempsycose
XII.6.1 De la métempsycose
XII.6.2 Prémonitions
XII.6.3 De la solidarité entre les générations
XII.6.4 De la transmigration des âmes
XII.6.5 De la transfiguration
XII.6.6 De la réincarnation
XII.6.7 De la régénération
XIII. SENS HISTORIOGRAPHIQUES À L'ÂGE DE L'ANUS MUNDI
XIII.1 Irruptions nostalgiques
XIII.1.1 La Gradiva de Jensen
XIII.1.2 L'archéologue
XIII.1.3 Le reconstructeur
XIII.1.4 La nostalgie, entre oubli et progrès
XIII.1.5 La lutte fasciste à la nostalgie
XIII.2 L'ère des mauvais sentiments
XIII.2.1 Hypothèques de la scène primitive collective
XIII.2.2 De l'usage de la force dans l'histoire
XIII.2.3 Irrationalisme et mauvais sentiments
XIII.2.4 Des prétentions à l'absolu au triomphe de l'absurde
XIII.2.5 De la mauvaise conscience...
XIII.2.6 ...à la conscience malheureuse
XIII.2.7 La conscience historienne
XIII.3 Le corps de l'histoire et ses fantômes
XIII.3.1 Le corps de l'histoire
XIII.3.2 L'anatomie historique
XIII.3.3 Cimetière et fausse d'aisance
XIII.3.4 Le culte occidental des ancêtres
XIII.3.5 Rienzo/Mussolini : un cas de transfert historique
XIII.3.6 Les fantômes de l'histoire
XIII.3.7 La production de masse de fantômes de l'histoire
XIII.3.8 Le héros comme incarnation de l'histoire
XIII.4 Rétroprojections historiques
XIII.4.1 Rétroprojections révolutionnaires
XIII.4.2 Rétroprojections françaises
XIII.4.3 Rétroprojections coloniales
XIII.4.4 Rétroprojections russes
XIII.5 Angoisse de la répétition historique
XIII.5.1 Doppelgänger historiques
XIII.5.2 Répétition de la décadence romaine
XIII.5.3 Répétitions tirées du Moyen Âge
XIII.5.4 Répétitions canadiennes-françaises
XIII.5.5 Répétitions de la Révolution française
XIII.5.6 Répétitions allemandes
XIII.5.7 Répétitions russes
XIII.5.8 Répétitions contemporaines
XIII.6 Conscience et inconscient historiques en Allemagne
XIII.6.1 De l'Allemagne comme sujet de sa propre histoire
XIII.6.2 L'Allemagne et l'aversion dionysiaque
XIII.6.3 Nietzsche et l'inconscient historique
XIII.6.4 La transition diltheyenne
XIII.6.5 La perspective heideggerienne
XIII.7 Soucis d'historiens
XIII.7.1 Le souci de Jacob Burckhardt
XIII.7.2 Le souci de Benedetto Croce
XIII.7.3 Le souci de Fustel de Coulanges
XIII.7.4 Le souci d'Hippolyte Taine
XIII.8 La finalité spenglérienne
XIII.8.1 De la vie et de la mort des cultures
XIII.8.2 Formes apollinienne et faustienne
XIII.8.3 La dégénérescence de la culture faustienne
XIII.8.4 La haine des sexes au cœur du Déclin de l'Occident
DU SYMBOLIQUE HISTORIQUE À L'ÂGE DE L'ANUS MUNDI
MORALISATION
I. LE CRÉPUSCULE DE L'IDÉE DE PROGRÈS
I.1 De la décadence
I.2 Honte, ressentiments et vengeance
I.3 Massacres sans culpabilité
I.4 De l'humanisme à l'humanitarisme
I.5 La lutte des races
I.6 Développement de l'élitisme
I.7 La faillite de l'éducation
I.8 La paganisation de l'Occident
II. TECTONIQUE DE PLAQUES IDÉOLOGIQUES
II.1 Eschatologie et sotériologie
II.2 Les plaques idéologiques
II.3 Les idéologèmes négatifs
II.3.1 L'antisémitisme
II.3.2 L'anticléricalisme
II.3.3 L'anti-intellectualisme
II.3.4 L'antimilitarisme
II.3.5 L'anticolonialisme
II.3.6 L'antimaçonnisme
II.3.7 De l'antimilitarisme à l'anticapitalisme
II.3.8 De l'antilibéralisme à l'antiparlementarisme
II.3.9 L'anticommunisme
II.3.10 L'antifascisme
II.4 Fantasmes de la destruction
II.4.1 Praxis de l'auto-destruction
II.4.2 La guerre civile comme praxéologie de l'auto-destruction
II.4.3 La guerre totale
II.4.4 La première étape de la guerre totale (1914-1918)
II.4.5 La seconde étape de la guerre totale (1919-1939)
II.4.6 La troisième étape de la guerre totale (1939-1945)
III. ORDRE HYGIÉNISTE EN ENFER FÉCAL
III.1 L'enfer fécal
III.1.1 Mort à crédit
III.1.2 Voirie politique
III.1.3 Un nouveau Malebolge
III.1.4 Le premier cercle : Le Malebolge de 1914-1918
III.1.5 Le second cercle : Le Malebolge des camps d'internement
III.2 Le water-closet, trône de la démocratie
III.2.1 Les origines de la merveilleuse invention
III.2.2 Les mécanismes de l'invention
III.2.3 L'éthologie de l'excrétion
III.2.4 La cuvette en arts et lettres
III.2.5 Latrines et politique
III.2.6 Les grandes chiasses occidentales
III.3 Stratégies hygiénistes
III.3.1 Les égouts
III.3.2 Hygiène corporelle
III.3.3 L'État hygiéniste
III.3.4 Hygiène urbaine
III.3.5 De l'hygiénisme moral
III.3.6 L'hygiénisme politique
III.3.7 Hygiène de guerre
III.3.8 Stratégies hygiénistes raciales
III.4 Prophylaxie sportive
III.4.1 De l'esprit de la gymnastique
III.4.2 Une culture de la jeunesse
III.4.3 L'éclosion des sports
III.4.4 Les vertus morales du sport
III.4.5 Les vertus sociales et nationales du sport
III.4.6 Les vertus esthétiques du sport
III.4.7 Le sport et la guerre : une liaison dangereuse
III.5 L'eugénisme
III.5.1 L'évolutionnisme
III.5.2 Les grandes menaces
III.5.3 L'eugénisme
III.5.4 Les Lebensborn
III.5.5 Stérilisation
III.5.6 Euthanasie
III.5.7 Génocide
IV. LE MILITARISME
IV.1 L'esprit de la guerre
IV.1.1 Le militarisme ordinaire et extraordinaire
IV.1.2 L'attente du sauveur au glaive
IV.1.3 En attendant la guerre
IV.1.4 Militarisation
IV.2 La guerre de Sécession
IV.2.1 Causes et conséquences économiques de la guerre de Sécession
IV.2.2 La guerre de Sécession
IV.2.3 La guerre hispano-américaine
IV.3 La guerre de 1870
IV.3.1 La défense nationale
IV.3.2 Le siège de Paris
IV.3.3 L'unification de l'Allemagne
IV.4 Les guerres coloniales
IV.4.1 Les guerres coloniales françaises et italiennes
IV.4.2 Les guerres coloniales britanniques
IV..4.3 Les guerres coloniales allemandes
IV.5 La Grande Guerre
IV.5.1 Les buts de guerre
IV.5.2 1914
IV.5.3 Le blocus naval
IV.5.4 1915-1916
IV.5.5 Le torpillage du Lusitania, 7 mai 1915
IV.5.6 Le télégramme Zimmermann, 16 janvier 1917
IV.5.7 1917
IV.5.8 1918
IV.5.9 Des civils
IV.5.10 La paix totalitaire de Versailles
IV.5.11 La fin de l'Ancien Régime
IV.6 La guerre civile espagnole
IV.6.1 Conditions extrêmes de la guerre civile espagnole
IV.6.2 La crise de la gauche au sein de la guerre civile espagnole
IV.6.3 La guerre civile espagnole comme guerre totale
IV.6.4 Les Brigades internationales
IV.6.5 Sortie de guerre civile
IV.7 La Seconde Guerre mondiale
IV.7.1 Un second avant-guerre
IV.7.2 Les stratégies de 1939
IV.7.3 1940
IV.7.4 La guerre des bombardements aériens
IV.7.5 1941 : L'entrée en guerre du Japon et des États-Unis
IV.7.6 La Russie en guerre
IV.7.7 1942-1944, le temps des débarquements
IV.7.8 La fin de la guerre européenne
IV.7.9 Bilan de la Seconde Guerre mondiale
V. LE SECTARISME
V.1 De l'esprit de secte
V.1.1 Typologie
V.1.2 Les Carbonari
V.1.3 La Franc-Maçonnerie moderne
V.1.4 Des Rose-Croix à l'Ordre de Chéronée
V.1.5 De la Ligue aux Partis communistes
V.1.6 Secrète Russie
V.1.7 Ku Klux Klan & Associées
V.2 De l'assassinat politique considéré comme un des beaux-arts
V.2.1 L'esthétique française du crime politique
V.2.2 L'esthétique russe du crime politique
V.2.3
L'esthétique allemande du crime politique
V.3 Des partis politiques
V.3.1 Héritières de la mère des Parlements
V.3.2 Partis politiques en France
V.3.3 Partis politiques en Russie
V.3.4 Partis politiques en Allemagne
VI. DE LA DÉMOCRATIE ET DE SES TRAVERS
VI.1 Des démocraties
VI.1.1 Démocratie : la mal-aimée
VI.1.2 Démocratie : définitions
VI.1.3 Démocratie libérale
VI.1.4 Les difficiles débuts de la démocratie occidentale
VI.1.5 Le suffrage universel
VI.1.6 Vers la démocratie sociale
VI.1.7 La nature instable de la démocratie libérale
VI.1.8 Le défi de la guerre
VI.2 De la tyrannie de la majorité
VI.2.1 Tocqueville et De la démocratie en Amérique
VI.2.2 Toynbee et le réajustement démocratique
VI.2.3 Ochlocratie & oligarchie
VI.2.4 Apathie & corruption
VI.2.5 Conformisme et appauvrissement de la démocratie
VI.3 De la démocratie totalitaire
VI.3.1 Talmon et Les origines de la démocratie totalitaire
VI.3.2 La tentation totalitaire
VI.3.3 Le parti unique et la démocratie totalitaire
VI.3.4 Fascismes et démocratie totalitaire
VII. DU NATIONALISME ET DE LA CITOYENNETÉ
VII.1 Du nationalisme
VII.1.1 Fondements et évolution du nationalisme français
VII.1.2 Le nationalisme canadien-français
VII.1.3 Le nationalisme italien
VII.1.4 Le nationalisme allemand
VII.1.5 Du nationalisme à l'impérialisme
VII.1.6 Du nationalisme russe au marxisme soviétique
VII.2 Les fédéralismes
VII.2.1 Fédéralisme français
VII.2.2 Fédéralismes allemand et italien
VII.2.3 Fédéralisme austro-hongrois
VII.2.4 Le Commonwealth britannique
VII.2.5 Fédéralisme canadien & nationalisme québécois
VII.2.6 Fédéralisme soviétique
VII.3 Ethnie, citoyenneté et étrangers
VII.3.1 Les ethnies
VII.3.2 La citoyenneté désabusée
VII.3.3 Étrangers dans sa nation
VIII. DU SYNDICALISME AU SOCIALISME
VIII.1 Du syndicalisme
VIII.1.1 Évolution du syndicalisme en Grande-Breetagne
VIII.1.2 Évolution du syndicalisme en France
VIII.1.3 Évolution du syndicalisme en Allemagne
VIII.1.4 Évolution du syndicalisme au Canada
VIII.1.5 L'effet de la Grande Guerre sur le syndicalisme
VIII.1.6 Le syndicalisme russe et la révolution de 1917
VIII.1.7 Le syndicalisme entre le fascisme et le corporatisme
VIII.1.8 Le syndicalisme français entre le Front populaire et Vichy
VIII.2 Du socialisme
VIII.2.1 De la vocation internationale du socialisme
VIII.2.2 La social-démocratie allemande
VIII.2.3 Le socialisme français : au temps de Guesde et de Jaurès
VIII.2.4 Le Labour Party britannique
VIII.2.5 Le socialisme austro-hongrois
VIII.2.6 Deux socialismes de droite : Péguy et Sorel
VIII.2.7 Le socialisme russe
VIII.2.8 Le socialisme français : au temps de blum et de Man
IX. DU COMMUNISME
IX.1 Évolution de l'idéologème communiste
IX.1.1 Des antécédents du communisme en Russie
IX.1.2 La social-démocratie russe
IX.1.3 Lénine et le léninisme
IX.1.4 Le bolchevisme
IX.1.5 La théorie et la révolution
IX.1.6 Le césaro-papisme soviétique
IX.1.7 Le communisme européen
IX.2 La Révolution russe
IX.2.1 Le travail de sape de l'Intellilgentzia
IX.2.2 La Russie de Nicolas II
IX.2.3 La percée socialiste
IX.2.4 1905
IX.2.5 Février
IX.2.6 Les hauts et les bas du Gouvernement provisoire
IX.2.7 Octobre
IX.2.8 Lénine, c'est la paix
IX.2.9 Les insurrections
IX.2.10 Lénine au pouvoir
IX.2.11 La réception occidentale
IX.3 L'Union soviétique
IX.3.1 La vraie nature du capitalisme russe
IX.3.2 Staline le terrible
IX.3.3 Le régime stalinien
IX.3.4 L'Europe à l'heure de Moscou
IX.4 Le Komintern
IX.4.1 Le communisme précoce allemand : Spartacus
IX.4.2 Le Komintern
IX.4.3 Éphéméride des partis communistes occidentaux
a) France
b) Italie
c) Espagne
d) Les puissances anglo-saxonnes
e) La Seconde Guerre mondiale
X. DE L'ANARCHISME
X.1 La Commune de Paris
X.1.1 Au fil des jours
X.1.2 Blanqui, Proudhon, Marx et les Communards
X.1.3 La Commune comme «révolution culturelle»
X.1.4 Bilans littéraires et politiques
X.1.5 De la Commune de Paris à la mutinerie de Cronstadt
X.2 L'anarchisme
X.2.1 Max Stirner et l'Unique
X.2.2 Proudhon et la Commune de Paris
X.2.3 Bakounine et les nihilistes
X.2.4 Au temps des marmites
X.2.5 Kropotkine et Malatesta
X.2.6 Les anarchistes en guerre : Makhno et Durruti
X.2.7 L'anarchisme aux États-Unis
X.3 Le syndicalisme révolutionnaire
X.3.1 Jean Allemane et Émile Pouget : vers le syndicalisme révolutionnaire
X.3.2 Fernand Pelloutier et le destin du syndicalisme d'action directe
X.3.3 La C.G.T.
X.3.4 Le syndicalisme révolutionnaire au gré des nations
a) Italie
b) Espagne
c) Grande-Bretagne
d) États-Unis d'Amérique
XI. DU FÉMINISME
XI.1 Les origines du féminisme
XI.2 Féminisme et totalitarisme
X.2.1 La Russie bolchevique
X.2.2 La Russie soviétique
X.2.3 Le familialisme fasciste
X.2.4 Le nazisme et l'antiféminisme
XI.3 La question homosexuelle
X.3.1 ...dans le pays où l'amour n'ose pas dire son nom
X.3.2 ...dans une Allemagne libérale
XI.3.3 ...dans une France tolérante
XII. DU COSMOPOLITISME
XII.1 À la recherche du cosmopolitisme
XII.1.1 Socialisme et pacifisme
XII.1.2 Le pacifisme intégral
XII.1.3 Les anciens combattants de la Grande Guerre
XII.1.4 La mort du pacifisme ancien
XII.2 Vaines tentatives de cosmopoliltisme
XII.2.1 Wilson et le wilsonisme
XII.2.2 La société des nations
XII.2.3 Échec et critique de la société des nations
XIII. DU COLONIALISME ET DE L'IMPÉRIALISME
XIII.1 La fin de l'esclavage
XIII.1.1 L'abolitionnisme américaine
XIII.1.2 De l'abolitionnisme britannique
XIII.1.3 L'abolitionnisme français
XIII.1.4 Le retour de l'esclavage
XIII.2 Du fardeau de l'homme blanc à la mission civilisatrice
XIII.2.1 Mission civilisatrice
XIII.2.2 Le fardeau britannique
XIII.2.3 La mission française
XIII.2.4 Les parents pauvres de la mission civilisatrice
XIII.3 Du colonialisme
XIII.3.1 De la colonisation au colonialisme
XIII.3.2 Colonialisme britannique
XIII.3.3 Colonialisme français
XIII.3.4 Les tard venus au colonialisme
XIII.3.5 Les aléas de l'Afrique coloniale
XIII.4 L'impérialisme
XIII.4.1 Distinctions
XIII.4.2 Le régime impérial
XIII.4.3 Commerce mondial et impérialisme social
XIII.4.4 La transition britannique du colonialisme à l'impérialisme
XIII.4.5 L'impérialisme nouveau
XIII.4.6 Théories de l'impérialisme
XIII.4.7 Le nazisme : stade suprême de l'impérialisme ou du colonialisme?
XIV. DES FASCISMES
XIV.1 Le fascisme
XIV.1.1 La parole mussolinienne
XIV.1.2 Les héritiers de Pareto et Sorel
XIV.1.3 L'héroïsation de la jeunesse
XIV.1.4 Le corporatisme
XIV.1.5 L'impossible internationale fasciste
XIV.1.6 Peut-on faire une théorie du fascisme?
XIV.2 Proto-fascismes
XIV.2.1 Le bonapartisme
XIV.2.2 Monsieur Thiers s'en va-t-en guerre
XIV2.3 C'est Boulanger qu'il nous faut!
XIV2.4 De Clemenceau à De Gaulle
XIV.2.5 Le proto-fascisme italien
XIV.2.6 Le proto-fascisme russe
XIV.2.7 Le proto-fascisme allemand
XIV.3 Le fascisme italien
XIV.3.1 Le pré-fascisme italien
XIV.3.2 La marche du fascisme italien
XIV.3.3 Une révolution réactionnaire ou une réaction révolutionnaire?
XIV.3.4 Fascisme et classes sociales
XIV.3.5 L'esthétisation de l'État fasciste
XIV.4 Les ligues françaises
XIV.4.1 La Ligue des Patriotes de Paul Déroulède
XIV.4.2 L'affaire Dreyfus, pépinière de ligues
XIV.4.3 La Ligue d'Action française
XIV.4.4 Les ligues d'entre-deux-guerres
XIV.5 Le nazisme
XIV.5.1 Les origines du nazisme
XIV.5.2 La carrière peu tranquille du Führer
XIV.5.3 Révolutionnaire et antibolchevique
XIV.5.4 Les fondements économiques et sociaux du nazisme
XIV.5.5 Les fondements idéologiques du nazisme
XIV.5.6 L'esthétisation nazie du politique
XIV.5.7 Le régime hitlérien
XIV.5.8 Le nazisme, stade suprême de la culture de la haine occidentale
XV. DE L'AUTORITARISME
XV.1 Du despotisme
XV.1.1 Du despotisme clérical
XV.1.2 Le despotisme de Pie IX
XV.1.3 La question romaine
XV.1.4 Le dogme de l'infaillibilité pontificale
XV.1.5 Ignace Bourget et l'ultramontanisme canadien-français
XV.1.6 Le despotisme romain au XXe siècle
XV.1.7. Les despotismes de l'entre-deux-guerres
XV.2 Du totalitarisme
XV.2.1 Qu'est-ce que le totalitarisme?
XV2.2 L'État totalitaire
XV.2.3 La société totalitaire
XV.2.4 L'interpénétration des sphères
XV.3 De la bureaucratie
XV.3.1 Des grandes écoles
XV.3.2 Des univers kafkaïens
XV.3.3 La bureaucratie française
XV.3.4 Biourocrat
XV.3.5 La bureaucratie allemande
XV.4 Les voies de l'intimidation-1 : Propaganda
XV.4.1 De la publicité
XV.4.2 De la propagande
XV.4.3 Les supports de la propagande
XV.4.4 Campagnes d'intoxication
XV.4.5 L'Agitprop
XV.4.6 La propagande nazie
XV.4.7 L'intoxication durant la Seconde Guerre mondiale
XV.5 Les voies de l'intimidation-2 : le terrorisme
XV.5.1 La Russie d'Ancien Régime
XV.5.2 Terreurs françaises
XV.5.3 Terreurs allemandes
XV.5.4 Terreurs de guerres
XV.5.5 Terreur bolchevique
XV.5.6 Terreur fasciste
XV.5.7 Terreurs de l'entre-deux-guerres
XV.5.8 Terreur nazie
XV.5.9 Terreur stalinienne
XV.6 Défaillance : les mutineries
XV.6.1 Des marins du Potemkine à ceux de Cronstadt
XV.6.2 Mutineries dans l'armée française, 1917
XV.6.3 Mutineries anglo-saxonnes
XV.6.4 Mutineries italiennes & allemandes
XV.6.5 Défaillance et mutineries
XV.7 Déviance : les collaborations
XV.7.1 L'occupation coloniale
XV.7.2 L'occupation de la France (1940-1944)
XV.7.3 Occupations diverses
XV.7.4 L'épineux problème de la question juive
XV.7.5 Approches de la vie quotidienne sous l'Occupation
XV.7.6 Déviance et collaboration
XV.8 Défiance : les résistances
XV.8.1 Résistances coloniales
XV.8.2 Résistance italienne
XV.8.3 Résistance allemande
XV.8.4 Résistance espagnole
XV.8.5 Résistance française
XV.8.6 Résistances sur le front Est
XV.8.7 Résistances juives
XV.8.8 La vie quotidienne sous la résistance
XV.8.9 Défiance et résistance
XVI. HISTORIOGRAPHIE ET IDÉOLOGIES
XVI.1 Foi religieuse à l'égard de la science historique
XVI.1.1 Les leçons de l'histoire au pouvoir : Napoléon et Nicolas
XVI.1.2 Les leçons de l'histoire à l'école
XV.2 Du déterminisme au présentisme
XVI.2.1 Sources du déterminisme
XVI.2.2 Déterminisme marxiste-léniniste
XVI.2.3 Déterminisme conservateur
XVI.2.4 Déterminisme nationaliste
XVI.2.5 Sources du relativisme
XVI.2.6 Sources du présentisme
XVI.3 Historiographie et idéologies
XVI.3.1 Instruction et vulgarisation historiques
XVI.3.2 Historiographie et idéologies en France
XVI.3.3 Subversions idéologiques de l'historiographie
XVI.3.4 Historiographie et idéologies en Allemagne
XVI.3.5 Historiographie et idéologies en Russie
XVI.4 Du progressisme à l'héroïsme
XVI.4.1 Du progressisme
XVI.4.2 De l'héroïsme
XVI.4.3 De l'éthique du héros
XVI.4.4 Les héros nationaux
XVI.4.5 Les masses contre le héros
XVI.4.6 Hitler et l'héroïsme
XVI.5 Morale de la philosophie existentialiste de l'histoire
XVI.5.1 À l'ombre de Dionysos
XVI.5.2 De la morale nietzschéenne de l'histoire
XVI.5.3 Contre le capitalisme et l'État
XVI.5.4 De décadence en Germanie
XVI.5.5 Le passage de Dilthey
XVI.5.6 L'anti-technicisme de Spengler et de Heidegger
XVI.5.7 Morale du Déclin de l'Occident
XVI.5.8 Heidegger et Spengler face aux nazis
XVI.5.9 En conclusion : Karl Jaspers
XVI.6 Moralisations historiographiques
XVI.6.1 Moralisation chez Burckhardt
XVI.6.2 Moralisation chez Croce
XVI.6.3 Moralisation chez Fustel de Coulanges
XVI.6.4 Moralisation chez Taine et Renan
XVI.6.5 Moralisation de l'orientalisme
XVI.7 L'historiographie bainvillienne : un cas d'espèce
XVI.7.1 Prolégomènes
XVI.7.1.1 L'historiographie de la droite avant l'Action Française
XVI.7.1,2 L'Action Française et l'Histoire
XVI.7.1.3 Jacques Bainville, sa vie, sa pensée
XVI.7.1.4 Les bainvilliens
XVI.7.1.5 L'honnêteté avant l'épistémé
XVI.7.1.6 La méthode Bainville : la sympathie intuitive
XVI.7.1.7 Une historiographie nationaliste
XVI.7.2 Leçons bainvilliennes de l'histoire
XVI.7.2.1 Civilisation et anarchie
XVI.7.2.2 Trahisons intérieures et ennemis extérieurs
XVI.7.2.3 Le principe monarchique
XVI.7.2.4 Le parricide révolutionnaire
XVI.7.2.5 Le principe démocratique
XVI.7.3 Les lois bainvilliennes de l'histoire
XVI.7.3.1 La loi de la répétition historique
a) dans l'histoire de la France;
b) dans l'histoire de l'Allemagne;
c) dans l'histoire de l'Espagne;
d) autres répétitions
XVI.7.3.2 La loi de l'immuabilité
XVI.7.3.3 La loi de conséquences
XVI.7.3.4 La loi de l'oubli
XVI.7.4 Le sens bainvillien de l'unité historique
XVI.7.5 Le diptyque bainvillien
XVI.7.6 Monstres et merveilles...
XVI.7.7 Les conflits d'intérêts
XVI.7.8 Économie psychique des haines bainvilliennes
XVI.8 L'uchronie
DES VALEURS À L'ÂGE DE L'ANUS MUNDI
LA SECONDE GUERRE DE TRENTE ANS DANS LA CONSCIENCE HISTORIQUE OCCIDENTALE : LA RÉGRESSION SADIQUE-ANALE
BIBLIOGRAPHIE
HISTORICITÉ
II.1 LE POÉTIQUE DU DÉCLIN DE L’OCCIDENT
II.1.1 «LES YEUX GRANDS OUVERTS, EN PLEINE CONSCIENCE»
Le premier constat qu’il est permis de faire, si on se limite à la conscience historique, c’est que le sentiment d’apocalypse et la sensation d’expulsion se traduisent par l’idée que la nation, les peuples, bref la civilisation occidentale est irrésistiblement sur son déclin. Le succès de l’œuvre d’un petit enseignant allemand avant et après la Grande Guerre, le fameux Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler, n’est que le produit des perceptions et des analyses qui, après un siècle de progrès incontestables, sonneraient le glas de la civilisation toute entière, dans ses parties (les nations) comme dans sa totalité. Et le problème réside précisément dans ce courant continue qui va de l’entité la plus petite – la nation, voire même la ville (Paris, Vienne, Saint-Pétersbourg, Berlin, etc.) – à la plus grande – la civilisation occidentale en entier. Les auteurs passent rapidement d’un degré l’autre sans toujours distinguer s’ils identifient la civilisation comme strictement nationale ou s’ils situent leur nation à l’intérieur d’un ensemble plus vaste. Pour beaucoup, si on maintient la distinction, la culture française, c’est la civilisation occidentale sous-entendue. Pour les Allemands, la culture, c’est le pan-germanisme et la civilisation, son déclin sous les influences délétères des apports étrangers, gaulois ou slaves. Les Russes, de même, sont divisés entre l’occidentalisme, véhiculé depuis l’époque de Pierre le Grand par l’élite autocratique autour du Tsar, tandis que les slavophiles considèrent cet Occident matérialiste comme antithétique aux traditions de leur culture.
Un autre problème consiste à considérer sous quel angle les intellectuels définissent la civilisation et expliquent ce qu’ils considèrent comme un déclin. La tradition allemande, qui sera celle de Spengler, voit la culture comme un organisme et son déclin comme une phase qu’elle identifie à la Zivilisation. Pour les Français et les Anglais, il s’agit surtout du ralentissement d’un mécanicisme dont les lois de l’énergie, en physique, prêteront le concept d'«entropie» pour rendre l’explication «scientifiquement acceptable». Des années 1860 aux années 1940, l’idée de déclin reste au centre de la philosophie occidentale de l’histoire. Elle s’inspire du destin des civilisations antiques, qui sont au cœur des découvertes archéologiques, et des indices que les enquêtes sociologiques, économiques, démographiques et autres peuvent fournir sur les inquiétantes attitudes des Occidentaux qui tendent à bouleverser l’organisation familiale, la conduite des mœurs, l’adoption éthiquement difficile de certaines découvertes scientifiques : les lois de l’évolution de Darwin, de la génétique de Mandel, de l’hystérie de Charcot, de l’inconscient de Freud…
Dans tous les cas, que ce soit sous le mode organiciste ou mécaniciste, qu’on restreigne le déclin à sa propre nation ou qu’on l’étende à l’ensemble de la civilisation, le constat se résume dans ce que le même Spengler écrit dans un autre ouvrage : «Et quant à nous, êtres humains du XXe siècle, nous dévalons la pente LES YEUX GRANDS OUVERTS, EN PLEINE CONSCIENCE. Notre sens de l’histoire, notre aptitude à la décrire et à l’écrire, sont des symptômes révélant clairement que nous parcourons cette pente vers le bas. C’est à l’apogée des Hautes Cultures, au moment où elles se muent en Civilisations, que ce don de pénétrante lucidité leur vient et seulement pour un temps bref».1 Spengler ne faisait, ici, que reprendre l’image tirée de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel : que «c’est au crépuscule que la chouette prend son envol».
Le déclin est une chose. Sa conscience en est une autre. Oui ou non, la civilisation occidentale, à la fin du XIXe siècle offrait-elle des signes incontestables de déclin? Ensuite, qu’importe la réponse à la première question, d’où viendrait ce sentiment irrépressible de la conscience d’un déclin de la civilisation, prémonition de sa mort éventuelle, voire prochaine? C’est reconnaître que le déclin et son sentiment sont deux choses bien différentes dont il faut toujours avoir à l’esprit. Ainsi Gilbert Durand formule-t-il assez bien le malaise à l’origine à la fois du sentiment et du déclin comme réalité historique : «…il n’y a pas progrès de la société ou de la culture globale, mais bien perfectionnement, ou mieux, “raffinement”, et qu’il est plausible que ce soient ces perfectionnements accumulés dans un champ culturel et social donné qui provoquent paradoxalement le déclin de la société en question. Les “décadents” ont toujours eu conscience d’être des “raffinés”, et l’on a depuis longtemps observé que c’est lorsqu’une culture est imprégnée de trop de raffinements qu’elle est menacée d’éclatement interne ou de subversion extérieure. Toutes les cultures trop “raffinées”, conscientes de l’inextricable enchevêtrement des perfectionnements dans des “byzantinismes” de culture ou de civilisation, ont toujours - plus ou moins secrètement - aspiré à une régression, et quelquefois à une régression jusqu’à la “barbarie” ou du moins au “sauvage”!»2 L’affirmation de Durand, qui reprend l’interprétation de Spengler, se renverse sans perdre de sa vérité. Pour reprendre l’expression de l’historien britannique George L. Mosse, la «brutalisation» renverserait les bienfaits du perfectionnement. De l’adoucissement des mœurs, qui était la vision voltairienne et libérale du progrès dans les mœurs et dans les lois, se renverserait en «abrutissement» des mœurs; et nous obtiendrions confirmation, dans le champ culturel, de la pression, fantasmatique d’abord puis réelle ensuite, qu’exercerait la violence dans cette «culture de la haine» comme l’appelle Peter Gay. De la violence interpersonnelle : vol, viol, meurtre, suicide, duel, assassinat politique, on en viendrait à une brutalisation des relations sociales : grèves, répressions, lois d’exception abolissant les droits de l’homme, violences coloniales, guerres mondiales enfin. Les «décadents» seraient ceux qui, les premiers, prendraient conscience, quoique sur le mode de la conscience malheureuse plutôt que de la conscience critique, seraient les paratonnerres qui capteraient le mieux les indices de ce renversement du perfectionnement de l’homme en sa brutalisation. Marc Angenot reprend cette distinction lorsqu’il écrit : «Deux quasi-concepts s’opposent au paradigme du Progrès. 1. Celui de l’“Évolution”: le devenir est “en germe” dans le présent, il tend à se développer selon des lois inéluctables, mais la conjoncture recèle des germes morbides, délétères, des tendances fâcheuses et angoissantes se font jour; un tri serait nécessaire. L’“Évolution sociale”, aveugle, comporte du bon et du mauvais. 2. L’autre concept est celui de la “Décadence”, celle des nations et spécifiquement de la France, de la “dégénérescence” des races, de l’“agonie” et de la “fin de la civilisation”. Il y a évolution, mais elle est devenue négative : l’organisme social se disloque et résiste de plus en plus mal aux agressions exogènes».3 Perfectionnement et brutalisation seraient donc inscrits, ensemble, dans les «gènes» des sociétés et coloreraient, de l’un ou de l’autre, l’évolution potentielle de la civilisation. C’est du moins en ces termes qu’Angenot constate l’expression du sentiment de déclin dans la presse française de 1889. Angenot place ici une contingence, une question de choix, comme s’il relevait de la volonté de choisir entre l’un ou l’autre des deux gènes. C’est une vision de l’esprit auxquels les intellectuels de l’époque savaient très bien qu’il était impossible de se rallier. Il ne s’agissait pas d’une question de volonté, mais bien de fatalité. Il fallait être un progressiste comme l’était le romancier de science-fiction, Herbert George Wells, pour croire à cette puissance de la volonté capable de corriger la pente prise par les gènes : «La Belle Époque signifierait donc la mort de la bourgeoisie. Les charmants et inoffensifs Éloïs du roman de H. G. Wells menant une vie insouciante au soleil tomberaient à la merci des noirs Morlocks dont ils dépendaient et contre lesquels ils étaient impuissants. “L’Europe, écrivait l’économiste allemand Schulze-Gaevernitz, se déchargea du travail manuel - d’abord du travail de la terre et du travail dans les mines, puis du travail industriel le plus pénible - sur les hommes de couleur, et s’en tiendra, en ce qui la concerne, au rôle de rentier, préparant peut-être ainsi l’émancipation économique, puis politique, des races de couleur”. Tels étaient les cauchemars qui troublaient le sommeil de la Belle Époque, cauchemars où la vulnérabilité des empires se mêlait à la hantise de la démocratie».4 Certes, Wells enverra son voyageur du temps, les bras chargés de la Bible et de Shakespeare, pour redonner aux Élois la possibilité de retrouver le perfectionnement inscrit dans la dynamique du progrès de l’espèce. Mais les observations de Schulze-Gaevernitz portaient plus loin que les fausses espérances de Wells. Elles annonçaient ce que serait, jusqu’à nos jours le déclin de l’Occident : sa perte de puissance, la dissolution de son identité face à l’émergence des peuples colonisés, des peuples «de couleurs» tenus jusqu’alors dans l’infériorité par l’impérialisme mais, qui, entre-temps, apprenaient de l’Occident et seraient, un jour ou l’autre, en mesure de retourner contre l’Occident son propre enseignement.
À la fin du XIXe siècle, les thèses libérales sur la décadence, ou le déclin, étaient moins nombreuses que les spéculations sur le progrès. On les tenaient surtout des réactionnaires qui, de Joseph de Maistre à Friedrich Nietzsche, refusaient les acquis de la modernité :
Autrefois - je crois que c’était en l’an un -
La Sybille dit, ivre sans avoir bu de vin:
“Malheur, maintenant cela va mal!
“Déclin! Déclin! Jamais le monde n’est tombé si bas!
Rome s’est abaissée à la fille, à la maison publique,
Le César de Rome s’est abaissé à la bête,
Dieu lui-même s’est fait juif!
prophétise Zarathoustra devant les deux rois et l’âne.5 Les philosophes de l’histoire ne s’y arrêtaient pas plus qu’il ne fallait. Tout au plus, constataient-ils des périodes d’arrêt dans la longue et difficile marche du progrès. Ainsi Condorcet. Il faut remonter au XVIe siècle pour voir un philosophe de l’histoire donner une première explication du sentiment de décadence : « Cette confusion d’une double nostalgie, celle d’un passé individuel et celle d’un temps révolu de l’histoire, Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, l’avait déjà dénoncée au nom du simple bon sens, en termes drus et concrets. “C’est une erreur grave, commentait Bodin, que de croire que le genre humain ne cesse de dégénérer. Et comme ceux qui la commettent sont généralement des vieillards, il est probable qu’ils se rappellent le charme de leur jeunesse toujours renaissante de joie et de volupté, tandis qu’ils se voient désormais sevrés de tout plaisir.” Pure fiction donc, phantasmes de l’âge que ces images de gloire, de félicité ou d’innocence attachées à l’évocation d’un passé disparu. “Il arrive alors qu’accablés par de tristes pensées et trompés par une représentation inexacte des choses ils se figurent que la bonne foi et l’amitié ont disparu entre les hommes, et, comme s’ils revenaient d’une longue navigation à travers ces temps fortunés, ils se mettent à parler de l’Âge d’or…”»6 Ceci pourrait s’appliquer intégralement à la gérontocratie de la fin du XIXe siècle, tant il est vrai, comme le remarque Hobsbawm que «la fin du XIXe siècle ne fut pas, sur le plan culturel, une époque de certitudes et de triomphalisme, les connotations qu’évoque aujourd’hui l’expression “fin de siècle” sont plutôt, à tort, celles de la “décadence”, dont s’enorgueillissaient tant d’artistes établis ou ambitieux au cours des années 1880-1890…»7 En fait, il s’agissait surtout d’une perte progressive de confiance dans l’idée de progrès, et surtout d’un doute qui commença à s’insinuer, grâce aux découvertes de Darwin et de Mendel, sur le soi-disant perfectionnement de l’espèce humaine. Comme le relève Stuart Hughes : «The new self-consciousness could readily slip into a radical skepticism: from an awareness of the subjective character of social thought it was an easy step to denying the validity of all such thought - or, alternatively, to a desperate resolve to “think with the blood”. In evaluating the permanent signifiance of the generation of the 1890’s, we need constantly to bear in mind the central paradox of their achievement: more often than not, their work encouraged an anti-intellectualism to which the vast majority of them were intensely hostile».8
Il serait important, toutefois, de noter quelques précisions de vocabulaire tant les mots vont voir leur sémantique s’échanger d’un concept à l’autre. Déjà, à côté de déclin, nous venons de rencontrer celui de décadence. Est-ce bien là la même chose? Pour Michel Winock, «il faudrait distinguer la décadence du déclin (d’un peuple, d’une société, d’une civilisation). Le déclin peut être apprécié en termes objectifs: avec des statistiques et des courbes, avec des poids et des mesures, car le déclin ressortit à l’économie, à la démographie, à la production culturelle. Dans ce dernier cas, les critères objectifs sont déjà moins sûrs…»9 Bref, pour l’historien français, une chose est claire, le terme de déclin s’adresse davantage à l’«esprit scientifique», alors que celui de décadence demeure imbue de subjectivité, plus précisément d’un jugement moral duquel l’historien professionnel devrait se tenir éloigné. Dans un sens, il a parfaitement raison. Mais l’épistémologie de l’histoire de M. Winock demeure essentiellement mécaniciste, d’où le choix de ses quatre explications de la «décadence»:
- L’explication de type marxiste par la lutte des classes. Dans cette perspective, le discours de la décadence est le discours des vaincus. Il s’agit d’une inversion des signes: ce qui est progrès pour le peuple, les masses, les anciens esclaves, est décadence pour les aristocraties et leur clientèle…
- Une explication conjoncturaliste insiste sur la variation d’intensité observable dans les discours de la décadence (le discours de la décadence suit les états de crise)…
- Le passage plus ou moins brutal de la société tribale, rurale, patriarcale, à la société urbaine, industrielle et libérale, a provoqué des peurs en chaîne, qui peuvent se résumer dans la principale: “la peur de la liberté”…
- Une interprétation anthropologique assimilerait le discours de la décadence à celui de l’homme devant la mort».10
Toutes ces explications, en effet, sont intervenues durant les quatre-vingt-quatre années que couvre l’époque de l’Anus Mundi, et nous aurons l’occasion de le vérifier tout au long de cette enquête. La question que soulève la seconde explication contredit ce que nous avons déjà affirmé : que le fantasme de déclin précède la crise historique. Certes, nous pourrions nous abandonner ici à l’aporie de l’œuf et de la poule. Mais ce serait une solution trop facile. Concevons que, dans l’ensemble de la civilisation occidentale, des nations ont pu expérimenter la conscience du déclin après une crise alors que d’autres ont anticipé la crise avant même qu’elle ne se réalise pour vraie. Dans le premier cas, nous avons le parcours de l’Angleterre et du choc traumatique que causa la guerre des Boers au début du XXe siècle. Dans le second, nous avons le parcours de la France, qui fantasmait déjà son déclin avant même que ne survienne la traumatique défaite de Sedan en 1870. Dans un cas comme dans l’autre, nous verrons les jeunes loups, les Etats-Unis d’Amérique et la Russie, attendre pour faire la curée de la vieille Europe coloniale.
Le cas de l’Angleterre d’abord. Lorsque la reine Victoria fêta son jubilé pour son soixantième anniversaire sur le trône du Royaume-Uni, il semblait que l’Empire britannique avait hérité de ce qu’on disait, jadis, de l’empire de Charles Quint : que le soleil ne s’y couchait jamais. Son chantre, le poète Rudyard Kipling exprimait, toutefois, des doutes sur la viabilité de cet empire : «En 1897, Kipling, le plus grand - et peut-être le seul - poète de l’impérialisme, salua ce grand moment de démagogie et d’orgueil impérial, le jubilée de diamant de la reine Victoria, par ce rappel prophétique de la fragilité des empires :
Appelées au loin, nos forces navales s’épuisent;
Au-dessus des dunes et des promontoires les phares s’éteignent
Hélas, toute notre pompe d’autrefois
A rejoint celle de Ninive et de Tyr!
Juge des Nations, épargne-nous encore,
De crainte que nous ne l’oublions ».11
Deux années ne s’étaient pas écoulées, en effet, que l’Angleterre devait affronter, avec la guerre des Boers, en Afrique du Sud, une épreuve de confiance qu’elle ne pouvait s’imaginer auparavant. La découverte d’or et de diamants dans les terres d’Afrique du Sud, qui appartenaient à deux territoires habités par les descendants de Hollandais, de Français huguenots et de Britanniques peu recommandables, poussa les explorateurs et les promoteurs anglais à investir massivement et violemment les terres réservées jusqu’alors à l’élevage et à l’agriculture. Les conquérants impérialistes s’imaginaient que ce serait une partie de campagne que d’occuper les territoires convoités. Mais les peuples des petites républiques du Transvaal et d’Orange décidèrent de résister à l’envahisseur. «L’année 1899 se termina en Angleterre dans une atmosphère de catastrophe. La nouvelle des défaites d’Afrique plongea le pays dans la consternation. On se rendit confusément compte des fautes politiques et militaires qui, après de si nombreuses victoires sur d’autres théâtres d’opérations, avaient abouti à un tel désastre. Mais, même dans les rangs des libéraux, on fut unanimement d’accord pour considérer que la politique impériale, qui avait abouti à cette guerre, ne pouvait se dénouer que par une victoire. Aucune concession n’était possible avant une réhabilitation complète des armes britanniques. On ressentit cruellement les affronts successifs, que le petit peuple boer venait d’infliger aux divisions britanniques. Mais que faire maintenant? Il fallait, avant tout, remporter la victoire, remonter le courant, muddle through et faire front à l’adversité…»12 Tout au long du XIXe siècle, les rébellions irlandaises et canadiennes avaient été mâtées par la main de fer ganté de velours de Londres. Mais cette fois, les Boers entreprirent de résister, coûte que coûte, ce qui leur attira un capital de sympathie européen : «Cette vague d’hostilité atteignit son paroxysme au moment où le Président Kruger entreprit son voyage de propagande en Europe. La Grande-Bretagne fut alors la victime d’une réprobation unanime. Que l’on se souvienne: “L’Angleterre, en 1900, c’était, dans les numéros spéciaux du Rire, John Bull disant à Cecil Rhodes: ‘Les affaires, c’est le sang des autres’”».13 Le flegmatisme britannique se transforma alors en opiniâtreté. La voie diplomatique sur laquelle était prête à s’engager les représentants boers fut rejetée par Londres, ne laissant plus le choix à leurs dirigeants : «Les présidents Steyn et Kruger prirent alors la résolution de demander la paix (5 mars 1900). Ils la subordonnaient cependant au maintien “de l’incontestable indépendance des deux Républiques comme États Souverains internationaux”. Lord Salisbury rejeta cette offre: “Le Gouvernement de Sa Majesté ne pouvait consentir à accorder l’indépendance ni à la République Sud-Africaine (Transvaal), ni à l’État libre d’Orange”. La guerre continua donc».14 Pour la première fois, un pays occidental s’engageait dans ce que serait une guerre totale, avec camps de concentration, barbelés, armements techniques utilisés contre des populations sous-armées. Quinze ans plus tard, la perte de confiance en soi sera raffermie par la quantité de jeunes Tommies qui tomberont dans les tranchées en Flandres et dans le nord de la France. Kipling y perdra son fils unique. La confiance en l’avenir s’était évanouie. Un américain établi en Angleterre, le romancier Henry James «emploie souvent le terme “collapse” pour désigner à la fois l’effondrement psychologique et le bouleversement social».15 Après la Grande Guerre, ce sera autour d’un autre américain établi en Angleterre, le poète et dramaturge T. S. Eliot, de reprendre le thème de l’effondrement moral : «Le poème d’Eliot exprime toute la détresse et l’angoisse de ce temps. Il respire le désespoir; qui est aussi au fond de Valéry et de Proust: cette atmosphère de fin du monde qui incite Joyce à introduire The End of the World dans l’hallucinant cortège d’une scène de son Ulysse. C’est l’atmosphère aussi de ces vers qui terminent le poème d’Eliot :
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.
(The Waste Land)
Il fallait supporter tout cela, le souffrir jusqu’à l’amer dénouement. Il fallait que fussent dits le supplice de la soif, l’épuisement au milieu d’un désert de pierres, l’effroi de la mort. […] Il n’y avait pas d’autre route que cette agonie pour trouver une naissance nouvelle».16
On pourrait penser que dans le cas de la France, la défaite de 1870 aurait joué le même rôle de «crise existentielle» que joua la guerre des Boers pour les Anglais. Mais il s’avère que l’idée de déclin hantait, obsédait littéralement les Français. Cette obsession, elle leur avait été suggérée par l’enseignement de Herder, le philosophe allemand de l’histoire qui eût un rôle déterminant dans le romantisme et le nationalisme grâce au concept de Volksgeist : «Tout est donc provisoire dans l’Histoire; l’inscription portée sur son temple est : néant et putréfaction… Comme des ombres, l’Égypte, la Perse, la Grèce et Rome sont passées…»17 Traduit par Quinet, propagé, avec Vico, par Michelet en France dès le milieu du siècle, la défaite de 1870 semblait confirmer la thèse du philosophe allemand énoncé un siècle plus tôt : «C’est ainsi que commence avec Herder la longue réflexion sur la décadence, sur la mort des civilisations et leur relativité qui culmine au XXe siècle avec Spengler. En effet, pour Herder, tout apogée présage une décadence et cette décadence est irrémédiable. Le Journal proclame inévitable le crépuscule de l’Occident: “L’esprit politique raffiné de l’Europe n’échappera pas à son déclin.” Ce déclin viendra, même si le processus doit être long comme ce le fut pendant toute la période qui a précédé la chute de Rome: le feu a couvé longtemps, “à notre époque il lui faudra couver encore plus longtemps, mais il n’en éclatera que plus soudainement. […] Tout cela est inévitable de par la nature des choses. La même matière qui nous fortifie et fait de nos cartilages des os finit aussi par transformer en os les cartilages qui devraient toujours rester des cartilages: et ce même raffinement qui rend policé notre bas peuple finira aussi par le rendre vieux, faible et bon à rien. Qui peut aller contre la nature des choses? Herder reprend cette idée dans Une autre philosophie de l’histoire où il élabore d’une manière systématique ses réflexions sur l’épuisement de la civilisation européenne, ce qui le plus souvent signifie pour lui l’étiolement du classicisme et de la civilisation française».18 À un Ernest Renan qui invitait, dans sa Réforme intellectuelle et morale, d’imiter les méthodes allemandes, des réactionnaires nationalistes français, dont le chef de file fut Charles Maurras, le publiciste de l’Action française, décidèrent de prendre à revers l’argumentaire de Herder, de ressourcer la civilisation européenne par la restauration du classicisme de la civilisation française. Ainsi, «Henri Massis disait que l’œuvre de Maurras n’était qu’une longue méditation sur la mort. En effet, le nationalisme de Maurras enseignait qu’il fallait saisir cet instant où une nation arrivée à l’apogée de sa gloire, ou de son génie propre, commence à décliner».19 Il est vrai que la France marchait de crise en crise depuis sa défaite de 1870 : la Commune de Paris, l’aventure du général Boulanger, le scandale de Panama, finalement l’Affaire Dreyfus donnaient, au tournant du XXe siècle, peu de chances d’entrevoir un avenir radieux. Pour beaucoup, c’était la «fin des jours faciles et ensoleillés, début de temps qui, tantôt ensanglantés, tantôt seulement sombres resteront toujours marqués du signe de l’angoisse».20 En effet, la Belle Époque, elle aussi, allait s’embourber dans les tranchées de Flandres et sur le Chemin des Dames.
Cependant, on l’a dit, l’obsession allait ressurgir aux lendemains de la victoire, comme si la revanche sur l’ennemie dite «héréditaire» n’avait pas suffit à redonner confiance à cette nation française qui avait vécue un déclin démographique tout au long du dernier tiers du XIXe siècle et qui, en plus, venait de voir une grande partie de sa jeunesse mobilisée, blessée, amputée, tuée, rendue impropre à la production économique. Le cas du jeune Drieu La Rochelle, jeune combattant au Chemin des Dames et collaborateur de l’ennemi «héréditaire» lors de la prochaine, est assez caractéristique de la persistance de l’obsession : «Obsédé par l’idée de décadence, il tend à confondre métaphores sexuelles et interprétation politique. Jean-Louis Saint-Ygnan, qui analyse la notion de décadence chez Drieu, remarque que pour lui la civilisation occidentale est en déclin depuis le Moyen Âge. L’équilibre entre le corps et l’esprit a été rompu au profit du second, les villes ont pris le pas sur les campagnes. […] La décadence sexuelle, identifiée à la stérilité, fait ainsi corps avec le déclin national et la dépopulation. La thématique de l’homosexualité, corps féminin, rejoint celle de la désagrégation du corps social, symbole d’une nation efféminée, gangrénée par des éléments étrangers».21 Drieu appartenait à cette génération dite non-conformiste qui, dans les années 1930 allaient participer au discours français de la décadence. S’il employait une métaphore organiciste pour s’expliquer la crise morale vécue par la France aux lendemains de la guerre, il ne faisait, en ce cas, que rejoindre l’obsession telle qu’elle s’exprimait à la fin du siècle précédant. C’est en répondant encore à Herder que Georges Bernanos, ancien camelot du roi, c’est-à-dire membre de la troupe de choc des partisans de l’Action Française de Maurras, considérait, en son âge mature, que «le problème qui se pose aujourd’hui n’est pas plus politique que social: il est cela sans doute, mais il est aussi beaucoup plus que cela. C’est un problème de civilisation».22 Un de ses contemporains, P. de Longmar, dans les Cahiers 1929, écrivait de même : «Lentement une civilisation meurt à l’horizon, la nôtre».23 Si les Français qui restaient fidèles à la pensée libérale ou s’investissaient dans le socialisme et le communisme croyaient toujours au perfectionnement de l’homme, c’est plutôt du côté réactionnaire que s’engagea cette génération non-conformiste. Réaction fut d’ailleurs le titre donnée à une de leur revue dont le manifeste était clair : «Les premières lignes du manifeste de “Réaction” étaient, à cet égard, très explicites: “Jamais, déclaraient-elles, l’homme n’avait atteint une telle perfection dans la connaissance des phénomènes, ni une telle puissance dans l’utilisation des forces naturelles et l’accumulation des richesses. Et pourtant, il y a une crise du monde moderne”. Thierry Maulnier constatait de son côté: “Chacun sent que la civilisation est parvenue à un moment crucial (…) Il ne fait de doute pour personne que nous soyons dans une des phases critiques de la civilisation et peut-être de l’espèce.” Diagnostiquant une “crise totale de civilisation”, Mounier notait pour sa part : “Nous sommes, à n’en plus douter, à un point de bascule de l’histoire: une civilisation s’incline, une autre se lève.” L’“Ordre Nouveau” affirmait de même que la crise contemporaine était celle “d’une civilisation qui, tout entière, pêche par la base” et Daniel-Rops situait dans toute leur ampleur les perspectives du mouvement en précisant qu’il s’engageait dans “un combat dont l’enjeu est notre civilisation même”, car, ajoutait-il, “les destins dont les fils en ce moment se nouent sont ceux de l’humanité entière, ceux de tout un ensemble de données, de traditions, de croyances sur lesquelles le monde a longtemps vécu”».24 Il ne restait plus, pour cette génération réactionnaire, qu’à s’en remettre à l’envahisseur, désormais porteur de la reviviscence de la Civilisation.
La question de la civilisation touchait la conscience historique elle-même. Réaction invitait à résister à la descente pénible que semblait vivre inexorablement la culture française. Le sentiment du déclin, dans ce premier numéro d’avril 1930, y était exprimé de manière impérative et invitait au regard introspectif des Français : «Tel était d’ailleurs le thème essentiel du manifeste qui ouvrait le premier numéro de “Réaction” et dont les premières phrases constataient: “Jamais l’homme n’avait atteint une telle perfection dans la connaissance des phénomènes, ni une telle puissance dans l’utilisation des forces naturelles et l’accumulation des richesses. Et pourtant il y a une crise du monde moderne”. “Crépuscule des nations blanches”, “Déclin de l’Occident”, approche des “Derniers Jours”, avènement d’un “Nouveau Moyen-Âge”, de toutes parts s’élèvent des cris annonciateurs de la fin du monde…” Le texte continuait par l’analyse des manifestations de cette crise qui, selon “Réaction”, était aussi bien une crise des structures politiques, sociales et économiques qu’une crise spirituelle beaucoup plus profonde d’un monde ayant perdu le sens d’un “ordre humain”…»25 La conscience historique demandait des éclaircissements au passé. Dans le contexte d’une crise obsessionnelle permanente, comme dit Galbraith, «l’historien…, peut espérer [fournir] à la mémoire un substitut qui freinera un peu ce déclin».26 On comprend alors le succès de la littérature historienne, sous forme de romans comme sous forme d’historiographie, dans les années 1930, mais c’était surtout l’histoire nationale dont on ne cessait de questionner le passé afin de savoir où se situait, précisément, le moment critique à l’origine de la crise, car la crise de la civilisation, c’était d’abord et avant tout la crise de la culture française : «Ce diagnostic de “crise de la civilisation” ne présentait pas une originalité absolue, car, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, des voix isolées, plus ou moins écoutées, s’étaient fait entendre qui formulaient des jugements analogues. Dès 1919, l’après-guerre s’était ouverte sur les paroles célèbres de Valéry: “Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles (…) Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie.” Depuis, nombre d’ouvrages, dont certains avaient nourri la réflexion des jeunes intellectuels des années 1930, étaient allés dans le même sens. Il suffit de rappeler quelques titres pour noter leur parenté avec l’esprit des groupes dont nous retraçons l’histoire : le Chaos européen de Norman Angel (1920), le Déclin de l’Europe d’Albert Demangeon (1920), le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler (1922), Un Nouveau Moyen-Âge de Nicolas Berdiaeff (1924), Défense de l’Occident d’Henri Massis (1925), l’Éclipse de l’Europe d’Arnold Toynbee (1926), la Tentation de l’Occident d’André Maurois (1926), la Crise du monde moderne de René Guénon (1927), Situation spirituelle de notre époque de Karl Jaspers (1930), le Déclin de la liberté de Daniel Halévy (1931), la Fin d’un temps de Gaston Gaillard (1932), la Révolution mondiale et la responsabilité de l’esprit d’Hermann Keyserling (1933). Le fait nouveau, dans les années 1930, c’est que cette idée de crise de civilisation débouchait avec ces mouvements sur le forum».27 Cette pensée, centrée sur le sort de la culture française placée au cœur de la crise de la civilisation occidentale, ne pouvait que suggérer une solution typiquement française. Après deux siècles, il s’agissait de répondre au défi lancé par Herder, non pas avec le classicisme du XVIIe siècle, impropre à l’ère industrielle, mais avec le Personnalisme, forme de christianisme social avancé, qui s’énonce dans l’article paru dans la revue Esprit en 1937, où «Mounier écrivait, parlant du nazisme, que “le socialisme allemand, comme d’ailleurs le socialisme russe, ne saurait être qu’une étape - peut-être nécessaire dans ces pays - vers le personnalisme intégral, fin naturelle et spirituelle de la civilisation d’Occident”».28
Le déclin de l’Occident n’était donc pas un thème typiquement allemand, malgré Spengler. En lui, se retrouvaient la crise de la culture française comme celle de l’impérialisme anglais. Aux yeux des édiles cultivés, on ressassait les lieux communs de la chouette de Hegel : «La métaphore de la tombée du jour et du soleil qui s’éteint va admirablement mettre en lumière les fondements de la sensibilité “fin de siècle”. La splendeur tardive du crépuscule ressemble à s’y méprendre à l’éclat sourd du déclin d’un monde, à la dilution des valeurs d’une sensibilité exténuée. Le coucher de soleil n’est plus, comme à l’époque romantique, le spectacle harmonieux et mélancolique offert par une nature aimable et féconde, il sonne le glas du vieux monde…»29 Le passage de la vision romantique à celle d’une fatalité inscrite dans les processus vitaux s’est accompli avec le siècle, parallèlement avec la défiguration des campagnes anglaises ou françaises et des forêts allemandes, sous l’irrésistible montée des villes populeuses où se ramassait la crasse et les détritus : «Le thème de la décadence - des mœurs, de l’art, de la religion, de la civilisation, de la domination politique de l’Occident - fleurissait dans l’intelligentsia de la seconde moitié du XIXe siècle (l’intelligentsia d’aujourd’hui croit bien à tort l’avoir inventé) et se renforçait de trouver un appui “scientifique” dans les théories neuropsychologiques, alors à la mode, de la dégénérescence nerveuse (extrapolée sans preuve à l’hystérie) et de la dégénérescence familiale (censée expliquer l’apparition d’un arriéré dans une fratrie aussi bien qu’établir le dogme de l’hérédité des maladies mentales). Seule échappait à la décadence la science, en progrès au contraire continu et dépositaire d’un espoir grandiose (que nous savons maintenant vain), celui d’apporter le bien-être, la raison et la concorde à l’humanité. D’où le schéma familial qui a servi alors de code à plusieurs romanciers et à de nombreux romans: l’aîné de la fratrie aura un destin “noble”; il sera savant ou médecin; le cadet ne sera qu’un artiste, un écrivain: c’est l’“idiot de la famille” (Flaubert, James, Proust, Huxley ont conformé leur vocation à ce schéma). Quant au troisième, s’il y en a, et surtout si c’est une troisième, elle sera dégénérée, hystérique: un “monstre” (par exemple, Alice, la sœur de William et d’Henry James)».30 Enfin, la guerre nouvelle, technicienne, destructrice de masse, celle à laquelle participèrent nombre de jeunes esprits cultivés et non plus des soudards comme dans les anciennes guerres monarchiques. La technique, c’était bien, mais elle était abandonnée dans des mains qui ne savaient l’utiliser que pour détruire et enlaidir le monde. «What concerned these writers or would-be writers was the decline of culture and the waning of vital energies; what drove them together was the desire to create new values and to replace those that were fading; what incited them to action was the conviction that they represented the future in the present; what dismayed them was their problematic relationship to the masses they would have liked to lead. Whether they called themselves Expressionists, Futurists, or Fabians, they felt above all like “young men of today”».31 L’énergie vitale était un thème nouveau parmi les philosophes, dont le Français Bergson fut le plus grand utilisateur. Il donnait à l’idée de déclin un aspect biologique, énergétique appelé à renouveler le thème là où les romantiques du siècle précédent l’avait conduit. Sans le prévoir, il allait conduire à l’investissement biologique du politique. Les thèses raciales, anthropologiques, souvent ramassis de préjugés et de stéréotypes issus de comparaisons gratuites, ouvraient irrésistiblement sur le racisme. D’autre part, les thèses psychologiques issues de la psychiatrie des Krafft-Ebing et autres criminalistes à la Lombroso, présentaient les facultés mentales et cérébrales comme sujettes à des dégénérescences dont le comportement violent était la traduction automatique. Entre la Psyché et le Logos, un fossé se creusait, fossé qu’eut beau condamné un Thomas Mann, revenu de sa passion nationaliste d’avant-guerre, aux lendemains de 1919 : «À partir de 1924, instruit par l’expérience personnelle et les leçons de l’histoire, il accordera le primat à la raison et à la volonté de l’homme contre les facteurs irrationnels. Ce qu’il reprochera à Nietzsche, c’est d’avoir méconnu le vrai rapport des forces entre l’intellect et l’instinct. Ce dernier, déjà trop puissant, n’a pas besoin d’être défendu contre l’esprit qui, lui, ne peut que vérifier sa faiblesse chaque fois qu’il se mesure avec les impulsions de la nature ou avec les mouvements de l’histoire. Toute la lutte menée contre le rationalisme depuis la fin du dix-huitième siècle repose donc sur une erreur. Certes, on ne peut plus souscrire à la formule naïve que tout est rationnel, ou que tout pourra et devra être rationalisé. Mais il est possible et souhaitable, notamment au niveau de la civilisation, d’introduire une certaine dose de rationalité dans le jeu des forces irrationnelles, dont il serait puéril de vouloir poursuivre la neutralisation complète. L’homme serait perdu s’il se soumettait sans lutte aux fatalités naturelles, et encore plus sûrement si, par un amor fati mal compris, il allait jusqu’à pactiser avec les puissances qui lui sont foncièrement hostiles».32 Mann était passé de l’école de Nietzsche à celle de Freud. Mais, comme bien d’autres, il devait réaliser que les temps n’étaient pas à l’intelligence.
Ils étaient à l’instinct. Et dans le contexte de l’impérialisme, ils allaient complaire aux théories raciales, eugénistes, psychiatriques. C’est là où l’hygiène rencontre l’idée de déclin, venant la confirmer tout en lui proposant des mesures prophylactique qui seront, par analogie, transférées sur les stratégies politiques et, malheureusement, policières et politiques. «Il circulait alors des théories raciales, biologiques et eugénésique - parfois même hygiéniques, dans l’esprit d’une prétendue “réforme de vie, qui ne peuvent être séparées des craintes simultanées d’une détérioration raciale générale. Cet état d’esprit est bien mis en valeur par les nombreux synonymes donnés au mot “danger”. Un écrivain allemand, A. Wirth, dépeint la mentalité de ses compatriotes en ces termes : “Autrefois, c’était les Français qui nous faisaient bouillir le sang; depuis quelque temps, ce sont les Américains, ou l’Internationale rouge, ou l’“Internationale de l’or” qui nous font trembler; ou l’ours russe qui essaie de nous dévorer ou le boa anglais qui prétend nous étrangler. Le danger “noir” ou “brun” était à la mode depuis la guerre des Hereros… À présent, l’immense “dragon jaune” est échauffé et menace d’assombrir notre ciel tel une puissante comète. Mais nous n’en resterons pas là”».33 L’effet produit ne pouvait être qu’une augmentation de la paranoïa, alimentant l’angoisse vécue par l’Occident depuis la fin du Moyen Âge. Cette croissance de la paranoïa allait fournir au sentiment d’apocalypse et à la menace d’expulsion un surcroît fantasmatique d’agressivité. De façon brutale, elle poserait ainsi la question : «Et pourquoi, après tout, notre domination sur le monde serait-elle la seule, dans l’Histoire, à être marquée du sceau de l’Éternité?»34 Marqué plutôt du sceau de la fatalité de tous les grands empires historiques, c’est dans le lointain passé – dans la Grèce ancienne, dans la Rome décadente – et dans le lointain Orient mystique, avec les preuves du déclin par analogie, que l’Occident irait chercher la confirmation du déclin dont il se voyait frappé.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la mode était à l’orientalisme. Les fouilles archéologiques, en Égypte et au Proche-Orient avaient été stimulées par l’expédition française sous le jeune général Bonaparte. Les romantiques et les archéologues avaient repris le flambeau. En remontant le temps, ils passaient par la chute de Rome sous le coup des invasions barbares; l’épuisement de la culture hellénique dans cette Alexandrie d’Égypte pleine de mystères d’Isis; les grands empires assyro-babyloniens avaient laissé des empreintes qui marquaient des étapes successives de déclins irréversibles. Bref, Valéry avait raison lorsqu’il proclamait que toutes les civilisations étaient mortelles. Les découvertes faites en Crète, loin de la Grèce continentale reconnue comme classique, laissaient transparaître une civilisation éclatante, bien plus primitive, mais tout aussi riche et dont les traces de la disparition brutale laissaient réfléchir : «“Les Minoens, après les deux millénaires où ils élaborèrent la première civilisation occidentale, disparurent de la scène occidentale, disparurent de la scène de l’histoire européenne” (De Sanctis). Leur chute fut-elle causée par une vie trop joyeuse et facile, bien que fortifiée par une croyance à la fois religieuse et politique? Il n’y a en effet pas trace sur l’île de grands temples minoens élevés pour abriter les images des dieux du ciel: de ce fait, il est légitime de supposer que leur culte était plutôt tourné vers l’adoration des divinités chtoniennes, dont les signes évidents sont l’histoire du labyrinthe et du Minotaure, et en général, l’importance qu’avait pris chez eux le “culte” du Taureau».35 En fait, les vestiges de Cnossos exhumés par Evans ne provenaient pas d’une décadence des mœurs mais d’un puissant tremblement de terre suivi d’un raz-de-marée qui, en ruinant la mer Égée et la Méditerranée orientale, avaient mis fin à la thalassocratie minoenne. C’est donc dire que les analyses du déclin de civilisations antiques servaient de miroir aux propres jugements de valeurs portés par les analystes sur l’Occident de leur époque. Ce n’est pas des réponses qu’ils cherchaient, mais des confirmations qu’ils étaient prêts à trouver, peu importe ce qu’il en coûterait à la vérité historique. En fait, tout ce que l’histoire minoenne pouvait confirmer, c’était l’avertissement que le président américain Ulysses S. Grant avait déjà prédit en 1873 : «Comme le commerce, l’éducation et le transport rapide de la pensée et de la matière par le télégraphe et la vapeur changent toute chose, je suis porté à croire que le Créateur s’occupe de faire du monde une maison unique, parlant une langue unique, une réalisation qui rendra désormais inutiles les armées de terre et de mer».36 C’est-à-dire que les empires n’étaient pas affaire de mœurs ou même de puissance politique, mais de voies de communication, de transports, d’éducation et de commerce. C’est ce qui avait fait la grandeur de Minos des millénaires avant le Christ, c’est ce qui devait faire la grandeur de l’Occident (et plus particulièrement des États-Unis dans l’esprit de Grant) pour le siècle à venir. En un sens, le président alcoolique avait parfaitement raison.
Les projections du déclin occidental dans le miroir de la situation de l’Orient étaient porteuses de confirmations plus exaltantes! L’exemple le plus proche de lui, c’est «l’homme malade de l’Europe», c’est-à-dire l’empire ottoman qui règne sur l’ensemble du Proche-Orient. Lors de la guerre de Crimée, les Anglais et les Français l’ont soutenu contre l’agressivité russe, un œil toujours fixé sur le passage des Dardanelles qui donnerait à l’Empire des Tsars un accès à la Méditerranée. Ses territoires africains font d’ailleurs partie de l’enjeu du partage de l’Afrique au congrès de Berlin : «La Turquie participait évidemment au congrès [de Berlin de 1878] qui était en effet consacré entièrement à la “question d’Orient”. Au fond ce n’était pas une question, ou plutôt c’était un problème qui contenait sa propre solution. Ce problème était celui de la dissolution de l’Empire ottoman. La solution consistait à partager ce qu’il en restait. Ces deux choses étaient si étroitement liées qu’il arrivait que l’on ne sache plus très bien si la dissolution était antérieure au partage ou si le partage était antérieur à la dissolution. Il s’agissait de savoir comment devait s’effectuer ce partage, mais cela non plus, ce n’était pas un vrai problème dans la mesure où il y aurait toujours assez à partager. Si l’Autriche voulait la Bosnie, la Russie pouvait obtenir la Valachie, l’Angleterre pourrait se contenter de Chypre et la France pourrait hériter de la Tunisie en guise de compensation. Si les États concernés le souhaitaient, le partage pourrait s’effectuer autrement. Ainsi, l’on joua très longtemps à ce petit jeu étant donné que, dans cet Empire ottoman, il y avait énormément à partager. Avec ses deux tentacules, cet Empire avait étreint jadis le bassin méditerranéen, s’étendant dans le Sud jusqu’au Maroc en embrassant au passage le Proche-Orient et l’Égypte, et atteignant dans le Nord les Balkans en se prolongeant jusqu’à la Bosnie et l’Herzégovine. Mais au fil du temps cet Empire s’était en grande partie effrité. Le tsar de Russie, Nicolas Ier, avait déclaré dès 1853 que la Turquie était l’homme malade de l’Europe et qu’il s’agissait de partager son héritage. L’Empire turc était en déclin depuis si longtemps déjà qu’il est quasi incompréhensible qu’il ait pu connaître une agonie aussi longue sans disparaître. Le déclin ottoman n’était pas un processus, mais une structure».37 L’état de l’empire ottoman en 1900 contrastait avec la grande peur qu’il avait suscité deux siècles plus tôt. Son État universel s’était désagrégé, comme l’avait dit le tsar, petit à petit, après la défaite de Lépante contre les armées alliées européennes. Le Divan (le gouvernement ottoman) apparaissait comme le modèle typique d’un Orient décadent, entre ses harems et ses étuves. L’écrivain Pierre Loti, qui avait résidé à Istambul et voyagé dans l’ensemble de l’empire, y avait aimé et y avait trouvé la matière de ses romans exotiques. À la veille de la Grande Guerre, où l’on verrait la Turquie s’allier avec les Empires centraux, «en 1910, Loti pleure la mort de tout ce qui avait permis le songe oriental, de tout ce qu’il venait retrouver depuis l’idylle d’Eyoub: “Choses du passé, toute cette ville qui s’effrite, tout cet Islam qui se décompose. Choses du passé, et du passé musulman, l’histoire de ma petite amie et de moi-même, choses qui vont finir ensemble dans la même poussière…”. Idée de déclin qui a tourné au leit-motiv. Dans les jardins du consul de France, à Orta-Keuï, où la fièvre l’a contraint à chercher asile, il regarde “fuir l’été, finir l’Orient, finir (sa) vie; c’est le déclin de tout”. Si, la nuit, le site environnant, le chant du muezzin, le heurt du bâton du veilleur évoquent toujours l’Orient, c’est de “l’Orient si triste, de l’Orient d’automne, de soir, de déclin et de mort”».38 L’Occident surveillait d’un œil perplexe la décomposition de cet empire qui ne faisait plus trembler, ni par son prosélytisme religieux, ni par sa tradition militaire.
En lieu et place, on chercha, angoisse paranoïde oblige, un nouvel épouvantail : «“Les Jaunes vivent dans le passé, les Noirs dans le présent, les Blancs dans l’avenir”, écrit en 1906 Félicien Challaye, pourtant l’un des esprits les plus ouverts de son temps, violent pourfendeur par ailleurs des crimes coloniaux. L’Asie, naguère prestigieuse, mère de civilisations fort belles, mais désormais flétries, décadentes… L’Afrique, peu évoluée, encore au stade de l’enfance, comme ses habitants qui vivent au jour le jour… L’Europe, seule capable d’imaginer un avenir fait de progrès ininterrompu… tout est dans cette formule».39 Avec la guerre des Boxers dans l’empire chinois morcelé, on crut bien l’avoir trouvé : «En 1900, la complicité de l’Empire chinois dans le siège mené par les Boxers des légations étrangères à Pékin entraîne l’envoi d’une expédition internationale de grande envergure, menée par des marins britanniques, des cosaques russes, de l’infanterie coloniale française, des bersaglieri italiens, des détachements des armées allemande et austro-hongroise, ainsi que par des gardes japonais et des marines américains. Cette opération est une totale réussite, montrant que l’Europe peut agir de concert quand elle le veut. Elle peut aussi vibrer et penser de concert. Les élites européennes partagent peu ou prou la même culture, un goût commun pour l’art de la renaissance italienne et flamande, la musique de Mozart et de Beethoven, le grand opéra, l’architecture médiévale, le renouveau classique, ainsi que pour la littérature étrangère moderne».40 Les Américains déjà fantasmaient, à la suite de la forte immigration de coolies chinois dans les grands centres de la côte ouest, l’idée d’un «péril jaune», et le gouvernement fédéral avait déjà édicté des mesures restreignant l’immigration chinoise dès le début des années 1880. Car, «la plus connue de toutes ces formules lapidaires est “le péril jaune” (dérivé sans doute du “péril américain”) qui exprimait tout un ensemble de menaces. Dans les pays blancs, les travailleurs redoutaient la concurrence des coolies et craignaient de se voir préférer une main d’œuvre habituée à un faible niveau de vie. Les économies européenne et américaine du Nord redoutaient la production japonaise. Enfin, on présentait une image des grandes nations “jaunes” qui, émancipées politiquement, dotées d’armes modernes, fortes de leur supériorité numérique, rejetaient les “blancs” de l’Extrême-Orient et se rendraient maîtres de l’Orient, peut-être même du monde. À cela se mêlait la crainte de voir s’infiltrer dans des territoires autrefois gouvernés par des blancs, non seulement des travailleurs jaunes mais aussi des fermiers et des immigrants de race jaune. Il y avait bien d’autres slogans synonymes de danger. Ainsi, à “l’Afrique aux Africains” s’opposait “le péril noir” et, réciproquement, l’Extrême-Orient commença bientôt de parler d’un péril “européen” ou “blanc” ou “occidental”. Enfin, ce fut seulement lorsque la politique eut pris des dimensions mondiales et que les peuples eurent commencé à se sentir concernés à une échelle mondiale par des ennemis, des conspirations, par la création de blocs et de fronts, que l’idée d’une conspiration sioniste visant à dominer le monde put se former et trouver créance…»41 Tous ces peuples lointains ou mystérieux apparaissaient comme des menaces potentielles sous formes de «géants endormis», les Chinois par leur population nombreuse; les Africains par la couleur de leur peau considérée comme une menace de métissage potentielle de la race blanche pure par des germes de dégénérescence négroïde. D’Afrique ne pouvait venir que des maladies contagieuses, des épidémies de fièvre jaune, des maladies du sommeil et autres exotismes mortels.
En fait, les Occidentaux angoissaient sans précisément savoir sur quoi précisément ils fixaient leurs angoisses. Celles-ci se déplaçaient selon les informations du moment, les découvertes ethnologiques ou les aventures relatées par des voyageurs qui, souvent, inséraient des pages purement fictives dans leurs carnets de voyages. La Salambô de Flaubert comme les tableaux orientaux de Delacroix fournissaient une série de thèmes érotico-violents qui jetaient à la fois, dans l’esprit des Occidentaux, des approches ambigües de l’étranger. Il ne faut pas oublier que le cinéma propagea ce type d’approches avec des films, tel celui de John Ford, intitulé The Lost Patrol (1934) : «Une patrouille chemine dans le désert d’Arabie pour se rendre à un endroit connu seulement de l’officier qui la commande. Mais cet officier est tué dans une escarmouche. Le sergent et ses hommes poursuivent leur marche sans savoir où ils vont. Exténués ils découvrent une oasis et décident d’y passer la nuit. Le lendemain l’homme de garde est trouvé poignardé. Les chevaux ont été volés. Un homme est blessé d’un coup de feu venu d’au delà des dunes et Abelson, grimpé en haut d’un palmier pour inspecter l’horizon, tombe tué d’une balle en plein front. Après une nuit tragique Cook et Mac Kay tentent de franchir la zone pour chercher du secours. Le soir deux chevaux ramènent leurs cadavres mutilés. Le matin suivant Quincannon s’élance, ivre de rage et tombe à quinze pas. Hale qui va le chercher est blessé et meurt après des heures de fièvre et de délire. Sanders, le mystique, s’effondre en prières. Soudain, un avion parti à leur recherche découvre la mosquée transformée en fortin et atterrit à cent mètres de là. Morelli, qui tente de prévenir l’aviateur inconscient du danger, est blessé à l’épaule et le pilote est tué. Brown et quelques autres succombent à leur tour. Cependant le sergent et Morelli rampent jusqu’à l’avion, dévissent la mitrailleuse malgré les balles qui crépitent autour d’eux et incendient l’appareil, espérant guider la colonne envoyée à leur recherche. Sanders en proie à une crise de folie mystique s’échappe, grimpe sur le haut des dunes. Morelli tente de le rattraper mais tous deux sont tués. Le sergent, blessé, reste seul survivant. Alors les Arabes se montrent, approchent… Secoué par les saccades de la mitrailleuse, le sergent, devenu fou furieux, les abat les uns après les autres. Quelques heures plus tard la colonne arrive. Le sergent, au garde-à-vous, désigne pour toute réponse les tumulus de sable sur chacun desquels, en guise de croix, un sabre est enfoncé. La colonne repart avec le sergent, hébété, à demi fou et disparaît derrière les dunes. Il n’y a plus rien autour de l’oasis que du sable, le soleil écrasant, le silence et la mort».42 Cette perception, inquiétante, de l’Arabie s’éloignait radicalement de celles fournies par Isabelle Eberhard ou T. E. Lawrence. C’était la vieille vision du «western» américain projeté en plein cœur de l’Afrique. À l’époque où l’Italie allait s’engager dans son aventure éthiopienne, c’était là servir des objectifs de civilisation des peuples restés «sauvages», à l’exemple de ce que les Américains venaient tout juste d’achever avec la conquête de l’Ouest.
Le déclin de l’Occident, c’était, pour le moment, le déclin de l’Europe et de son influence sur le reste du monde. Herder et Spengler avaient raison : c’est lorsqu’un empire atteint son plus haut point de développement que l’idée de déchéance, de déclin fait son apparition, et cause aussi des dommages importants au niveau de la conscience morale et de l’estime de soi. Le développement des moyens de transports et des voies de communications entraînaient une dérive du centre des civilisations, comme l’observait déjà Toynbee dans son Study of History. «Les États-Unis en 1898, le Japon en 1905, remportent respectivement sur l’Espagne et la Russie des victoires dont l’ampleur et la rapidité plongent l’Europe dans la stupeur. Ainsi, bien avant la guerre de 1914-1918 qui précipitera le mouvement, l’hégémonie plusieurs fois séculaire de l’Europe semble-t-elle condamnée à terme».43 Un tel constat suffit à saisir la racine profonde de la conscience du Déclin de l’Occident au tournant du XXe siècle. Si l’Orient pouvait toujours exercer un certain pouvoir de fascination pour les peuples des nations occidentales, la qualité affective de cette fascination tanguait de l’attirance à la répugnance. Des reportages nourrissaient cette instabilité affective de l’Autre, mais ne pensant qu’à soi, le déclin devenait la menace non seulement de perdre de sa vitalité énergétique, mais aussi de se voir envahir et dominé par une vitalité énergétique autre. Les Occidentaux apprenaient à se méfier des autres à la manière dont les Russes, en particulier les slavophiles, se méfiaient des Occidentaux. «L’amour du mode de vie russe, de l’esprit russe sont le pendant d’un rejet de l’Occident et de ses valeurs. Professeur à l’université de Moscou, Stepan Chevyrev, slavophile ardent […], écrit à propos de l’Occident et des Occidentaux: “Nous nous embrassons, nous nous étreignons, nous partageons le festin de la pensée, nous buvons la coupe des sentiments, sans remarquer le poison caché dans notre insouciant contact avec eux, nous ne sentons pas, dans l’amusement du festin, l’odeur du futur cadavre qu’ils dégagent déjà.” Alexandre Herzen lui fait écho: “Je vois la mort inévitable de la vieille Europe et ne regrette rien de ce qui y existe”».44 Si le sentiment du déclin de l’Occident était resté quelque chose de secret, de tabou ou à ne partager qu’entre soi, le sentiment aurait pu se vivre sans trop d’angoisses, mais dans la mesure où il était partagé par des observateurs étrangers, appartenant à des civilisations étrangères et potentiellement hostiles, cela devenait une menace, voire une condamnation irrémédiable, comme tant de romans, de films et de conférences le véhiculèrent avant et après la Grande Guerre. De fait, le discours sur le déclin de l’Occident resta un discours «pour adultes seulement». Il est douteux que dans ses classes Oswald Spengler ait longtemps entretenu ses jeunes élèves à cultiver ses théories. La chose devait rester du domaine des «grandes personnes». Ainsi en témoigne un Canadien de notre époque qui s’étonne que les manuels scolaires ne lui aient jamais enseigné l’histoire de la crise de 1929 : «Jamie est un étudiant très intelligent de dixième année, à Calgary, à qui l’on a beaucoup enseigné au sujet des rois et des reines d’Angleterre, des guerres obscures d’Europe, des premières explorations et découvertes sur la planète, sur l’histoire des États-Unis et la colonisation du Canada, à partir de Jacques Cartier jusqu’au Rapport Durham et la rébellion de Louis Riel, en 1885; alors, je l’ai questionné sur la Crise : “On nous l’a jamais enseignée, la Crise… les temps durs. Y a rien dans nos manuels, y a peut-être quelque chose à la bibliothèque mais j’ai rien vu. Ils nous l’enseignent pas, du moins, pas jusqu’à maintenant. Non, je sais pas pourquoi. Peut-être qu’ils veulent pas qu’on le sache, tout simplement. Je sais que c’est une époque où personne avait d’argent, même pas le pays. Oui, je sais ça. Ma mère me l’a dit. Elle m’en a un peu parlé, mais rien d’autre”».45 Cette censure institutionnelle montre ce que devait être le tabou que représentait le discours du déclin pour le commun peuple. «Ne pas vouloir savoir», mais être tenaillé par ce sentiment persistant du déclin, la hantise d’une apocalypse imminente, la répulsion à l’idée de se voir expulser de la domination du monde qui a si bien réussie à l’Occident depuis le XVe siècle. Non. Il valait mieux ne pas en parler.
1 O. Spengler. op. cit. pp. 51-52.
2 G. Durand. Introduction à la mythodologie, Paris, Albin Michel, Col. Biblio-Essais, # 4300, 1996, pp. 125-126.
3 M. Angenot. 1889, un état du discours social, Longueuil, Éditions du Préambule, Col. L’Univers du discours, 1989, p. 315.
4 E. J. Hobsbawm. L’ère des empires, Paris, Fayard, Col. Pluriel, # 8831, 1989, p. 114.
5 Cité in R.-J. Dupuy. Politique de Nietzsche, Paris, Armand Colin, Col. U, 1969, p. 255.
6 R. Girardet. Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, Col. L’Univers historique, 1986, pp. 134-135.
7 E. J. Hobsbawm. op. cit. 1989, pp. 292-293.
8 H. Stuart-Hugues. Consciousness and society, New York, Vintage Books, 1977, p.17.
9 M. Winock. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H131, 1990, p. 325.
10 M. Winock. ibid. pp. 109-110.
11 E. H. Hobsbawm. op. cit. 1989, p. 113
12 J. Crokaert. Histoire de l’Empire britannique, Paris, Flammarion, 1947, pp. 426-427.
13 J. Crokaert. ibid. p. 446.
14 J. Crokaert. ibid. p. 435.
15 J. Perrot. Henry James. Paris, Aubier, 1982, p. 11.
16 E. R. Curtius. Essais sur la littérature européenne, Paris, Grasset, 1954, 56pp. 258-259.
17 Cité in P. Sloterdijk. Globes, Paris, Maren-Sell Éditions, Col. Sphère, # 2, 2010, p. 244.
18 Z. Sternhell. Les anti-Lumières, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, #176, 2010, pp. 166-167.
19 Z. Sternhell. ibid. p. 595.
20 J. Chastenet. La France de M. Fallières, Paris, Fayard, rééd. Livre de poche, #2858, 1949, p. 469.
21 F. Tamagne. Histoire de l’homosexualité en Europe, Paris, Seuil, Col. L’Univers historique, 2000, p. 591.
22 Cité in J.-L. Loubet del Bayle. op. cit. p. 7.
23 Cité in J.-L. Loubet del Bayle. ibid. p. 52.
24 J.-L. Loubet del Bayle. ibid. pp. 248-249.
25 J.-L. Loubet del Bayle. ibid. p. 65.
26 J. K. Galbraith. La crise économique de 1929, Paris, Payot, Col. P.B.P., #138, 1961, p. 19.
27 J.-L. Loubet del Bayle. ibid. pp. 266-267.
28 P. Burrin. op. cit. 2000, p. 224.
29 S. Jouve. Les Décadents, Paris, Plon, 1989, p. 8.
30 D. Anzieu. Le corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque de l’Inconscient, 1981, pp. 198-199.
31 R. Wohl. op. cit. p. 5.
32 L. Leibrich. Thomas Mann, Paris, Éditions universitaires, #12, 1954, pp. 91-92.
33 H. Gollwitzer. L’impérialisme de 1880 à 1918, Paris, Flammarion, Col. Histoire illustrée de l’Europe, 1970, p. 172.
34 A. Ruscio. Le credo de l’homme blanc, Bruxelles, Éditions Complexes, 2002, p. 282.
35 P. Santarcangeli. Le livre des labyrinthes, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 1974, pp. 101-102.
36 Cité in E. J. Hobsbawm. op. cit. 1989, p. 75.
37 H. Wesseling. Le partage de l’Afrique, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, #107, 1996, pp. 43-44.
38 H. El Nouty. Le Proche-Orient dans la littérature française, Paris, Nizet, 1958, p. 135.
39 A. Ruscio. op. cit. p. 79.
40 J. Keegan. op. cit. 2005, p. 25.
41 H. Gollwitzer. op. cit. pp. 174-176.
42 J. Mitry. John Ford, t. 1, Paris, Éditions universitaires, #1, 1954, pp. 109-110.
43 P. Milza. Les relations internationales de 1871 à 1914, Paris, Armand Colin, Col. U, 1968, p. 165.
44 M. Heller. Histoire de la Russie et de son empire, Paris, Plon, 1997, p. 721.
45 B. Broadfoot. La grande dépression, Montréal, Québec-Amérique, 1978, pp. 7-8.
II.1 LE POÉTIQUE DU DÉCLIN DE L’OCCIDENT
II.1.1 «LES YEUX GRANDS OUVERTS, EN PLEINE CONSCIENCE»
Le premier constat qu’il est permis de faire, si on se limite à la conscience historique, c’est que le sentiment d’apocalypse et la sensation d’expulsion se traduisent par l’idée que la nation, les peuples, bref la civilisation occidentale est irrésistiblement sur son déclin. Le succès de l’œuvre d’un petit enseignant allemand avant et après la Grande Guerre, le fameux Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler, n’est que le produit des perceptions et des analyses qui, après un siècle de progrès incontestables, sonneraient le glas de la civilisation toute entière, dans ses parties (les nations) comme dans sa totalité. Et le problème réside précisément dans ce courant continue qui va de l’entité la plus petite – la nation, voire même la ville (Paris, Vienne, Saint-Pétersbourg, Berlin, etc.) – à la plus grande – la civilisation occidentale en entier. Les auteurs passent rapidement d’un degré l’autre sans toujours distinguer s’ils identifient la civilisation comme strictement nationale ou s’ils situent leur nation à l’intérieur d’un ensemble plus vaste. Pour beaucoup, si on maintient la distinction, la culture française, c’est la civilisation occidentale sous-entendue. Pour les Allemands, la culture, c’est le pan-germanisme et la civilisation, son déclin sous les influences délétères des apports étrangers, gaulois ou slaves. Les Russes, de même, sont divisés entre l’occidentalisme, véhiculé depuis l’époque de Pierre le Grand par l’élite autocratique autour du Tsar, tandis que les slavophiles considèrent cet Occident matérialiste comme antithétique aux traditions de leur culture.
Un autre problème consiste à considérer sous quel angle les intellectuels définissent la civilisation et expliquent ce qu’ils considèrent comme un déclin. La tradition allemande, qui sera celle de Spengler, voit la culture comme un organisme et son déclin comme une phase qu’elle identifie à la Zivilisation. Pour les Français et les Anglais, il s’agit surtout du ralentissement d’un mécanicisme dont les lois de l’énergie, en physique, prêteront le concept d'«entropie» pour rendre l’explication «scientifiquement acceptable». Des années 1860 aux années 1940, l’idée de déclin reste au centre de la philosophie occidentale de l’histoire. Elle s’inspire du destin des civilisations antiques, qui sont au cœur des découvertes archéologiques, et des indices que les enquêtes sociologiques, économiques, démographiques et autres peuvent fournir sur les inquiétantes attitudes des Occidentaux qui tendent à bouleverser l’organisation familiale, la conduite des mœurs, l’adoption éthiquement difficile de certaines découvertes scientifiques : les lois de l’évolution de Darwin, de la génétique de Mandel, de l’hystérie de Charcot, de l’inconscient de Freud…
Dans tous les cas, que ce soit sous le mode organiciste ou mécaniciste, qu’on restreigne le déclin à sa propre nation ou qu’on l’étende à l’ensemble de la civilisation, le constat se résume dans ce que le même Spengler écrit dans un autre ouvrage : «Et quant à nous, êtres humains du XXe siècle, nous dévalons la pente LES YEUX GRANDS OUVERTS, EN PLEINE CONSCIENCE. Notre sens de l’histoire, notre aptitude à la décrire et à l’écrire, sont des symptômes révélant clairement que nous parcourons cette pente vers le bas. C’est à l’apogée des Hautes Cultures, au moment où elles se muent en Civilisations, que ce don de pénétrante lucidité leur vient et seulement pour un temps bref».1 Spengler ne faisait, ici, que reprendre l’image tirée de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel : que «c’est au crépuscule que la chouette prend son envol».
Le déclin est une chose. Sa conscience en est une autre. Oui ou non, la civilisation occidentale, à la fin du XIXe siècle offrait-elle des signes incontestables de déclin? Ensuite, qu’importe la réponse à la première question, d’où viendrait ce sentiment irrépressible de la conscience d’un déclin de la civilisation, prémonition de sa mort éventuelle, voire prochaine? C’est reconnaître que le déclin et son sentiment sont deux choses bien différentes dont il faut toujours avoir à l’esprit. Ainsi Gilbert Durand formule-t-il assez bien le malaise à l’origine à la fois du sentiment et du déclin comme réalité historique : «…il n’y a pas progrès de la société ou de la culture globale, mais bien perfectionnement, ou mieux, “raffinement”, et qu’il est plausible que ce soient ces perfectionnements accumulés dans un champ culturel et social donné qui provoquent paradoxalement le déclin de la société en question. Les “décadents” ont toujours eu conscience d’être des “raffinés”, et l’on a depuis longtemps observé que c’est lorsqu’une culture est imprégnée de trop de raffinements qu’elle est menacée d’éclatement interne ou de subversion extérieure. Toutes les cultures trop “raffinées”, conscientes de l’inextricable enchevêtrement des perfectionnements dans des “byzantinismes” de culture ou de civilisation, ont toujours - plus ou moins secrètement - aspiré à une régression, et quelquefois à une régression jusqu’à la “barbarie” ou du moins au “sauvage”!»2 L’affirmation de Durand, qui reprend l’interprétation de Spengler, se renverse sans perdre de sa vérité. Pour reprendre l’expression de l’historien britannique George L. Mosse, la «brutalisation» renverserait les bienfaits du perfectionnement. De l’adoucissement des mœurs, qui était la vision voltairienne et libérale du progrès dans les mœurs et dans les lois, se renverserait en «abrutissement» des mœurs; et nous obtiendrions confirmation, dans le champ culturel, de la pression, fantasmatique d’abord puis réelle ensuite, qu’exercerait la violence dans cette «culture de la haine» comme l’appelle Peter Gay. De la violence interpersonnelle : vol, viol, meurtre, suicide, duel, assassinat politique, on en viendrait à une brutalisation des relations sociales : grèves, répressions, lois d’exception abolissant les droits de l’homme, violences coloniales, guerres mondiales enfin. Les «décadents» seraient ceux qui, les premiers, prendraient conscience, quoique sur le mode de la conscience malheureuse plutôt que de la conscience critique, seraient les paratonnerres qui capteraient le mieux les indices de ce renversement du perfectionnement de l’homme en sa brutalisation. Marc Angenot reprend cette distinction lorsqu’il écrit : «Deux quasi-concepts s’opposent au paradigme du Progrès. 1. Celui de l’“Évolution”: le devenir est “en germe” dans le présent, il tend à se développer selon des lois inéluctables, mais la conjoncture recèle des germes morbides, délétères, des tendances fâcheuses et angoissantes se font jour; un tri serait nécessaire. L’“Évolution sociale”, aveugle, comporte du bon et du mauvais. 2. L’autre concept est celui de la “Décadence”, celle des nations et spécifiquement de la France, de la “dégénérescence” des races, de l’“agonie” et de la “fin de la civilisation”. Il y a évolution, mais elle est devenue négative : l’organisme social se disloque et résiste de plus en plus mal aux agressions exogènes».3 Perfectionnement et brutalisation seraient donc inscrits, ensemble, dans les «gènes» des sociétés et coloreraient, de l’un ou de l’autre, l’évolution potentielle de la civilisation. C’est du moins en ces termes qu’Angenot constate l’expression du sentiment de déclin dans la presse française de 1889. Angenot place ici une contingence, une question de choix, comme s’il relevait de la volonté de choisir entre l’un ou l’autre des deux gènes. C’est une vision de l’esprit auxquels les intellectuels de l’époque savaient très bien qu’il était impossible de se rallier. Il ne s’agissait pas d’une question de volonté, mais bien de fatalité. Il fallait être un progressiste comme l’était le romancier de science-fiction, Herbert George Wells, pour croire à cette puissance de la volonté capable de corriger la pente prise par les gènes : «La Belle Époque signifierait donc la mort de la bourgeoisie. Les charmants et inoffensifs Éloïs du roman de H. G. Wells menant une vie insouciante au soleil tomberaient à la merci des noirs Morlocks dont ils dépendaient et contre lesquels ils étaient impuissants. “L’Europe, écrivait l’économiste allemand Schulze-Gaevernitz, se déchargea du travail manuel - d’abord du travail de la terre et du travail dans les mines, puis du travail industriel le plus pénible - sur les hommes de couleur, et s’en tiendra, en ce qui la concerne, au rôle de rentier, préparant peut-être ainsi l’émancipation économique, puis politique, des races de couleur”. Tels étaient les cauchemars qui troublaient le sommeil de la Belle Époque, cauchemars où la vulnérabilité des empires se mêlait à la hantise de la démocratie».4 Certes, Wells enverra son voyageur du temps, les bras chargés de la Bible et de Shakespeare, pour redonner aux Élois la possibilité de retrouver le perfectionnement inscrit dans la dynamique du progrès de l’espèce. Mais les observations de Schulze-Gaevernitz portaient plus loin que les fausses espérances de Wells. Elles annonçaient ce que serait, jusqu’à nos jours le déclin de l’Occident : sa perte de puissance, la dissolution de son identité face à l’émergence des peuples colonisés, des peuples «de couleurs» tenus jusqu’alors dans l’infériorité par l’impérialisme mais, qui, entre-temps, apprenaient de l’Occident et seraient, un jour ou l’autre, en mesure de retourner contre l’Occident son propre enseignement.
À la fin du XIXe siècle, les thèses libérales sur la décadence, ou le déclin, étaient moins nombreuses que les spéculations sur le progrès. On les tenaient surtout des réactionnaires qui, de Joseph de Maistre à Friedrich Nietzsche, refusaient les acquis de la modernité :
Autrefois - je crois que c’était en l’an un -
La Sybille dit, ivre sans avoir bu de vin:
“Malheur, maintenant cela va mal!
“Déclin! Déclin! Jamais le monde n’est tombé si bas!
Rome s’est abaissée à la fille, à la maison publique,
Le César de Rome s’est abaissé à la bête,
Dieu lui-même s’est fait juif!
prophétise Zarathoustra devant les deux rois et l’âne.5 Les philosophes de l’histoire ne s’y arrêtaient pas plus qu’il ne fallait. Tout au plus, constataient-ils des périodes d’arrêt dans la longue et difficile marche du progrès. Ainsi Condorcet. Il faut remonter au XVIe siècle pour voir un philosophe de l’histoire donner une première explication du sentiment de décadence : « Cette confusion d’une double nostalgie, celle d’un passé individuel et celle d’un temps révolu de l’histoire, Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, l’avait déjà dénoncée au nom du simple bon sens, en termes drus et concrets. “C’est une erreur grave, commentait Bodin, que de croire que le genre humain ne cesse de dégénérer. Et comme ceux qui la commettent sont généralement des vieillards, il est probable qu’ils se rappellent le charme de leur jeunesse toujours renaissante de joie et de volupté, tandis qu’ils se voient désormais sevrés de tout plaisir.” Pure fiction donc, phantasmes de l’âge que ces images de gloire, de félicité ou d’innocence attachées à l’évocation d’un passé disparu. “Il arrive alors qu’accablés par de tristes pensées et trompés par une représentation inexacte des choses ils se figurent que la bonne foi et l’amitié ont disparu entre les hommes, et, comme s’ils revenaient d’une longue navigation à travers ces temps fortunés, ils se mettent à parler de l’Âge d’or…”»6 Ceci pourrait s’appliquer intégralement à la gérontocratie de la fin du XIXe siècle, tant il est vrai, comme le remarque Hobsbawm que «la fin du XIXe siècle ne fut pas, sur le plan culturel, une époque de certitudes et de triomphalisme, les connotations qu’évoque aujourd’hui l’expression “fin de siècle” sont plutôt, à tort, celles de la “décadence”, dont s’enorgueillissaient tant d’artistes établis ou ambitieux au cours des années 1880-1890…»7 En fait, il s’agissait surtout d’une perte progressive de confiance dans l’idée de progrès, et surtout d’un doute qui commença à s’insinuer, grâce aux découvertes de Darwin et de Mendel, sur le soi-disant perfectionnement de l’espèce humaine. Comme le relève Stuart Hughes : «The new self-consciousness could readily slip into a radical skepticism: from an awareness of the subjective character of social thought it was an easy step to denying the validity of all such thought - or, alternatively, to a desperate resolve to “think with the blood”. In evaluating the permanent signifiance of the generation of the 1890’s, we need constantly to bear in mind the central paradox of their achievement: more often than not, their work encouraged an anti-intellectualism to which the vast majority of them were intensely hostile».8
Il serait important, toutefois, de noter quelques précisions de vocabulaire tant les mots vont voir leur sémantique s’échanger d’un concept à l’autre. Déjà, à côté de déclin, nous venons de rencontrer celui de décadence. Est-ce bien là la même chose? Pour Michel Winock, «il faudrait distinguer la décadence du déclin (d’un peuple, d’une société, d’une civilisation). Le déclin peut être apprécié en termes objectifs: avec des statistiques et des courbes, avec des poids et des mesures, car le déclin ressortit à l’économie, à la démographie, à la production culturelle. Dans ce dernier cas, les critères objectifs sont déjà moins sûrs…»9 Bref, pour l’historien français, une chose est claire, le terme de déclin s’adresse davantage à l’«esprit scientifique», alors que celui de décadence demeure imbue de subjectivité, plus précisément d’un jugement moral duquel l’historien professionnel devrait se tenir éloigné. Dans un sens, il a parfaitement raison. Mais l’épistémologie de l’histoire de M. Winock demeure essentiellement mécaniciste, d’où le choix de ses quatre explications de la «décadence»:
- L’explication de type marxiste par la lutte des classes. Dans cette perspective, le discours de la décadence est le discours des vaincus. Il s’agit d’une inversion des signes: ce qui est progrès pour le peuple, les masses, les anciens esclaves, est décadence pour les aristocraties et leur clientèle…
- Une explication conjoncturaliste insiste sur la variation d’intensité observable dans les discours de la décadence (le discours de la décadence suit les états de crise)…
- Le passage plus ou moins brutal de la société tribale, rurale, patriarcale, à la société urbaine, industrielle et libérale, a provoqué des peurs en chaîne, qui peuvent se résumer dans la principale: “la peur de la liberté”…
- Une interprétation anthropologique assimilerait le discours de la décadence à celui de l’homme devant la mort».10
Toutes ces explications, en effet, sont intervenues durant les quatre-vingt-quatre années que couvre l’époque de l’Anus Mundi, et nous aurons l’occasion de le vérifier tout au long de cette enquête. La question que soulève la seconde explication contredit ce que nous avons déjà affirmé : que le fantasme de déclin précède la crise historique. Certes, nous pourrions nous abandonner ici à l’aporie de l’œuf et de la poule. Mais ce serait une solution trop facile. Concevons que, dans l’ensemble de la civilisation occidentale, des nations ont pu expérimenter la conscience du déclin après une crise alors que d’autres ont anticipé la crise avant même qu’elle ne se réalise pour vraie. Dans le premier cas, nous avons le parcours de l’Angleterre et du choc traumatique que causa la guerre des Boers au début du XXe siècle. Dans le second, nous avons le parcours de la France, qui fantasmait déjà son déclin avant même que ne survienne la traumatique défaite de Sedan en 1870. Dans un cas comme dans l’autre, nous verrons les jeunes loups, les Etats-Unis d’Amérique et la Russie, attendre pour faire la curée de la vieille Europe coloniale.
Le cas de l’Angleterre d’abord. Lorsque la reine Victoria fêta son jubilé pour son soixantième anniversaire sur le trône du Royaume-Uni, il semblait que l’Empire britannique avait hérité de ce qu’on disait, jadis, de l’empire de Charles Quint : que le soleil ne s’y couchait jamais. Son chantre, le poète Rudyard Kipling exprimait, toutefois, des doutes sur la viabilité de cet empire : «En 1897, Kipling, le plus grand - et peut-être le seul - poète de l’impérialisme, salua ce grand moment de démagogie et d’orgueil impérial, le jubilée de diamant de la reine Victoria, par ce rappel prophétique de la fragilité des empires :
Appelées au loin, nos forces navales s’épuisent;
Au-dessus des dunes et des promontoires les phares s’éteignent
Hélas, toute notre pompe d’autrefois
A rejoint celle de Ninive et de Tyr!
Juge des Nations, épargne-nous encore,
De crainte que nous ne l’oublions ».11
Deux années ne s’étaient pas écoulées, en effet, que l’Angleterre devait affronter, avec la guerre des Boers, en Afrique du Sud, une épreuve de confiance qu’elle ne pouvait s’imaginer auparavant. La découverte d’or et de diamants dans les terres d’Afrique du Sud, qui appartenaient à deux territoires habités par les descendants de Hollandais, de Français huguenots et de Britanniques peu recommandables, poussa les explorateurs et les promoteurs anglais à investir massivement et violemment les terres réservées jusqu’alors à l’élevage et à l’agriculture. Les conquérants impérialistes s’imaginaient que ce serait une partie de campagne que d’occuper les territoires convoités. Mais les peuples des petites républiques du Transvaal et d’Orange décidèrent de résister à l’envahisseur. «L’année 1899 se termina en Angleterre dans une atmosphère de catastrophe. La nouvelle des défaites d’Afrique plongea le pays dans la consternation. On se rendit confusément compte des fautes politiques et militaires qui, après de si nombreuses victoires sur d’autres théâtres d’opérations, avaient abouti à un tel désastre. Mais, même dans les rangs des libéraux, on fut unanimement d’accord pour considérer que la politique impériale, qui avait abouti à cette guerre, ne pouvait se dénouer que par une victoire. Aucune concession n’était possible avant une réhabilitation complète des armes britanniques. On ressentit cruellement les affronts successifs, que le petit peuple boer venait d’infliger aux divisions britanniques. Mais que faire maintenant? Il fallait, avant tout, remporter la victoire, remonter le courant, muddle through et faire front à l’adversité…»12 Tout au long du XIXe siècle, les rébellions irlandaises et canadiennes avaient été mâtées par la main de fer ganté de velours de Londres. Mais cette fois, les Boers entreprirent de résister, coûte que coûte, ce qui leur attira un capital de sympathie européen : «Cette vague d’hostilité atteignit son paroxysme au moment où le Président Kruger entreprit son voyage de propagande en Europe. La Grande-Bretagne fut alors la victime d’une réprobation unanime. Que l’on se souvienne: “L’Angleterre, en 1900, c’était, dans les numéros spéciaux du Rire, John Bull disant à Cecil Rhodes: ‘Les affaires, c’est le sang des autres’”».13 Le flegmatisme britannique se transforma alors en opiniâtreté. La voie diplomatique sur laquelle était prête à s’engager les représentants boers fut rejetée par Londres, ne laissant plus le choix à leurs dirigeants : «Les présidents Steyn et Kruger prirent alors la résolution de demander la paix (5 mars 1900). Ils la subordonnaient cependant au maintien “de l’incontestable indépendance des deux Républiques comme États Souverains internationaux”. Lord Salisbury rejeta cette offre: “Le Gouvernement de Sa Majesté ne pouvait consentir à accorder l’indépendance ni à la République Sud-Africaine (Transvaal), ni à l’État libre d’Orange”. La guerre continua donc».14 Pour la première fois, un pays occidental s’engageait dans ce que serait une guerre totale, avec camps de concentration, barbelés, armements techniques utilisés contre des populations sous-armées. Quinze ans plus tard, la perte de confiance en soi sera raffermie par la quantité de jeunes Tommies qui tomberont dans les tranchées en Flandres et dans le nord de la France. Kipling y perdra son fils unique. La confiance en l’avenir s’était évanouie. Un américain établi en Angleterre, le romancier Henry James «emploie souvent le terme “collapse” pour désigner à la fois l’effondrement psychologique et le bouleversement social».15 Après la Grande Guerre, ce sera autour d’un autre américain établi en Angleterre, le poète et dramaturge T. S. Eliot, de reprendre le thème de l’effondrement moral : «Le poème d’Eliot exprime toute la détresse et l’angoisse de ce temps. Il respire le désespoir; qui est aussi au fond de Valéry et de Proust: cette atmosphère de fin du monde qui incite Joyce à introduire The End of the World dans l’hallucinant cortège d’une scène de son Ulysse. C’est l’atmosphère aussi de ces vers qui terminent le poème d’Eliot :
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.
(The Waste Land)
Il fallait supporter tout cela, le souffrir jusqu’à l’amer dénouement. Il fallait que fussent dits le supplice de la soif, l’épuisement au milieu d’un désert de pierres, l’effroi de la mort. […] Il n’y avait pas d’autre route que cette agonie pour trouver une naissance nouvelle».16
On pourrait penser que dans le cas de la France, la défaite de 1870 aurait joué le même rôle de «crise existentielle» que joua la guerre des Boers pour les Anglais. Mais il s’avère que l’idée de déclin hantait, obsédait littéralement les Français. Cette obsession, elle leur avait été suggérée par l’enseignement de Herder, le philosophe allemand de l’histoire qui eût un rôle déterminant dans le romantisme et le nationalisme grâce au concept de Volksgeist : «Tout est donc provisoire dans l’Histoire; l’inscription portée sur son temple est : néant et putréfaction… Comme des ombres, l’Égypte, la Perse, la Grèce et Rome sont passées…»17 Traduit par Quinet, propagé, avec Vico, par Michelet en France dès le milieu du siècle, la défaite de 1870 semblait confirmer la thèse du philosophe allemand énoncé un siècle plus tôt : «C’est ainsi que commence avec Herder la longue réflexion sur la décadence, sur la mort des civilisations et leur relativité qui culmine au XXe siècle avec Spengler. En effet, pour Herder, tout apogée présage une décadence et cette décadence est irrémédiable. Le Journal proclame inévitable le crépuscule de l’Occident: “L’esprit politique raffiné de l’Europe n’échappera pas à son déclin.” Ce déclin viendra, même si le processus doit être long comme ce le fut pendant toute la période qui a précédé la chute de Rome: le feu a couvé longtemps, “à notre époque il lui faudra couver encore plus longtemps, mais il n’en éclatera que plus soudainement. […] Tout cela est inévitable de par la nature des choses. La même matière qui nous fortifie et fait de nos cartilages des os finit aussi par transformer en os les cartilages qui devraient toujours rester des cartilages: et ce même raffinement qui rend policé notre bas peuple finira aussi par le rendre vieux, faible et bon à rien. Qui peut aller contre la nature des choses? Herder reprend cette idée dans Une autre philosophie de l’histoire où il élabore d’une manière systématique ses réflexions sur l’épuisement de la civilisation européenne, ce qui le plus souvent signifie pour lui l’étiolement du classicisme et de la civilisation française».18 À un Ernest Renan qui invitait, dans sa Réforme intellectuelle et morale, d’imiter les méthodes allemandes, des réactionnaires nationalistes français, dont le chef de file fut Charles Maurras, le publiciste de l’Action française, décidèrent de prendre à revers l’argumentaire de Herder, de ressourcer la civilisation européenne par la restauration du classicisme de la civilisation française. Ainsi, «Henri Massis disait que l’œuvre de Maurras n’était qu’une longue méditation sur la mort. En effet, le nationalisme de Maurras enseignait qu’il fallait saisir cet instant où une nation arrivée à l’apogée de sa gloire, ou de son génie propre, commence à décliner».19 Il est vrai que la France marchait de crise en crise depuis sa défaite de 1870 : la Commune de Paris, l’aventure du général Boulanger, le scandale de Panama, finalement l’Affaire Dreyfus donnaient, au tournant du XXe siècle, peu de chances d’entrevoir un avenir radieux. Pour beaucoup, c’était la «fin des jours faciles et ensoleillés, début de temps qui, tantôt ensanglantés, tantôt seulement sombres resteront toujours marqués du signe de l’angoisse».20 En effet, la Belle Époque, elle aussi, allait s’embourber dans les tranchées de Flandres et sur le Chemin des Dames.
Cependant, on l’a dit, l’obsession allait ressurgir aux lendemains de la victoire, comme si la revanche sur l’ennemie dite «héréditaire» n’avait pas suffit à redonner confiance à cette nation française qui avait vécue un déclin démographique tout au long du dernier tiers du XIXe siècle et qui, en plus, venait de voir une grande partie de sa jeunesse mobilisée, blessée, amputée, tuée, rendue impropre à la production économique. Le cas du jeune Drieu La Rochelle, jeune combattant au Chemin des Dames et collaborateur de l’ennemi «héréditaire» lors de la prochaine, est assez caractéristique de la persistance de l’obsession : «Obsédé par l’idée de décadence, il tend à confondre métaphores sexuelles et interprétation politique. Jean-Louis Saint-Ygnan, qui analyse la notion de décadence chez Drieu, remarque que pour lui la civilisation occidentale est en déclin depuis le Moyen Âge. L’équilibre entre le corps et l’esprit a été rompu au profit du second, les villes ont pris le pas sur les campagnes. […] La décadence sexuelle, identifiée à la stérilité, fait ainsi corps avec le déclin national et la dépopulation. La thématique de l’homosexualité, corps féminin, rejoint celle de la désagrégation du corps social, symbole d’une nation efféminée, gangrénée par des éléments étrangers».21 Drieu appartenait à cette génération dite non-conformiste qui, dans les années 1930 allaient participer au discours français de la décadence. S’il employait une métaphore organiciste pour s’expliquer la crise morale vécue par la France aux lendemains de la guerre, il ne faisait, en ce cas, que rejoindre l’obsession telle qu’elle s’exprimait à la fin du siècle précédant. C’est en répondant encore à Herder que Georges Bernanos, ancien camelot du roi, c’est-à-dire membre de la troupe de choc des partisans de l’Action Française de Maurras, considérait, en son âge mature, que «le problème qui se pose aujourd’hui n’est pas plus politique que social: il est cela sans doute, mais il est aussi beaucoup plus que cela. C’est un problème de civilisation».22 Un de ses contemporains, P. de Longmar, dans les Cahiers 1929, écrivait de même : «Lentement une civilisation meurt à l’horizon, la nôtre».23 Si les Français qui restaient fidèles à la pensée libérale ou s’investissaient dans le socialisme et le communisme croyaient toujours au perfectionnement de l’homme, c’est plutôt du côté réactionnaire que s’engagea cette génération non-conformiste. Réaction fut d’ailleurs le titre donnée à une de leur revue dont le manifeste était clair : «Les premières lignes du manifeste de “Réaction” étaient, à cet égard, très explicites: “Jamais, déclaraient-elles, l’homme n’avait atteint une telle perfection dans la connaissance des phénomènes, ni une telle puissance dans l’utilisation des forces naturelles et l’accumulation des richesses. Et pourtant, il y a une crise du monde moderne”. Thierry Maulnier constatait de son côté: “Chacun sent que la civilisation est parvenue à un moment crucial (…) Il ne fait de doute pour personne que nous soyons dans une des phases critiques de la civilisation et peut-être de l’espèce.” Diagnostiquant une “crise totale de civilisation”, Mounier notait pour sa part : “Nous sommes, à n’en plus douter, à un point de bascule de l’histoire: une civilisation s’incline, une autre se lève.” L’“Ordre Nouveau” affirmait de même que la crise contemporaine était celle “d’une civilisation qui, tout entière, pêche par la base” et Daniel-Rops situait dans toute leur ampleur les perspectives du mouvement en précisant qu’il s’engageait dans “un combat dont l’enjeu est notre civilisation même”, car, ajoutait-il, “les destins dont les fils en ce moment se nouent sont ceux de l’humanité entière, ceux de tout un ensemble de données, de traditions, de croyances sur lesquelles le monde a longtemps vécu”».24 Il ne restait plus, pour cette génération réactionnaire, qu’à s’en remettre à l’envahisseur, désormais porteur de la reviviscence de la Civilisation.
La question de la civilisation touchait la conscience historique elle-même. Réaction invitait à résister à la descente pénible que semblait vivre inexorablement la culture française. Le sentiment du déclin, dans ce premier numéro d’avril 1930, y était exprimé de manière impérative et invitait au regard introspectif des Français : «Tel était d’ailleurs le thème essentiel du manifeste qui ouvrait le premier numéro de “Réaction” et dont les premières phrases constataient: “Jamais l’homme n’avait atteint une telle perfection dans la connaissance des phénomènes, ni une telle puissance dans l’utilisation des forces naturelles et l’accumulation des richesses. Et pourtant il y a une crise du monde moderne”. “Crépuscule des nations blanches”, “Déclin de l’Occident”, approche des “Derniers Jours”, avènement d’un “Nouveau Moyen-Âge”, de toutes parts s’élèvent des cris annonciateurs de la fin du monde…” Le texte continuait par l’analyse des manifestations de cette crise qui, selon “Réaction”, était aussi bien une crise des structures politiques, sociales et économiques qu’une crise spirituelle beaucoup plus profonde d’un monde ayant perdu le sens d’un “ordre humain”…»25 La conscience historique demandait des éclaircissements au passé. Dans le contexte d’une crise obsessionnelle permanente, comme dit Galbraith, «l’historien…, peut espérer [fournir] à la mémoire un substitut qui freinera un peu ce déclin».26 On comprend alors le succès de la littérature historienne, sous forme de romans comme sous forme d’historiographie, dans les années 1930, mais c’était surtout l’histoire nationale dont on ne cessait de questionner le passé afin de savoir où se situait, précisément, le moment critique à l’origine de la crise, car la crise de la civilisation, c’était d’abord et avant tout la crise de la culture française : «Ce diagnostic de “crise de la civilisation” ne présentait pas une originalité absolue, car, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, des voix isolées, plus ou moins écoutées, s’étaient fait entendre qui formulaient des jugements analogues. Dès 1919, l’après-guerre s’était ouverte sur les paroles célèbres de Valéry: “Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles (…) Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie.” Depuis, nombre d’ouvrages, dont certains avaient nourri la réflexion des jeunes intellectuels des années 1930, étaient allés dans le même sens. Il suffit de rappeler quelques titres pour noter leur parenté avec l’esprit des groupes dont nous retraçons l’histoire : le Chaos européen de Norman Angel (1920), le Déclin de l’Europe d’Albert Demangeon (1920), le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler (1922), Un Nouveau Moyen-Âge de Nicolas Berdiaeff (1924), Défense de l’Occident d’Henri Massis (1925), l’Éclipse de l’Europe d’Arnold Toynbee (1926), la Tentation de l’Occident d’André Maurois (1926), la Crise du monde moderne de René Guénon (1927), Situation spirituelle de notre époque de Karl Jaspers (1930), le Déclin de la liberté de Daniel Halévy (1931), la Fin d’un temps de Gaston Gaillard (1932), la Révolution mondiale et la responsabilité de l’esprit d’Hermann Keyserling (1933). Le fait nouveau, dans les années 1930, c’est que cette idée de crise de civilisation débouchait avec ces mouvements sur le forum».27 Cette pensée, centrée sur le sort de la culture française placée au cœur de la crise de la civilisation occidentale, ne pouvait que suggérer une solution typiquement française. Après deux siècles, il s’agissait de répondre au défi lancé par Herder, non pas avec le classicisme du XVIIe siècle, impropre à l’ère industrielle, mais avec le Personnalisme, forme de christianisme social avancé, qui s’énonce dans l’article paru dans la revue Esprit en 1937, où «Mounier écrivait, parlant du nazisme, que “le socialisme allemand, comme d’ailleurs le socialisme russe, ne saurait être qu’une étape - peut-être nécessaire dans ces pays - vers le personnalisme intégral, fin naturelle et spirituelle de la civilisation d’Occident”».28
Le déclin de l’Occident n’était donc pas un thème typiquement allemand, malgré Spengler. En lui, se retrouvaient la crise de la culture française comme celle de l’impérialisme anglais. Aux yeux des édiles cultivés, on ressassait les lieux communs de la chouette de Hegel : «La métaphore de la tombée du jour et du soleil qui s’éteint va admirablement mettre en lumière les fondements de la sensibilité “fin de siècle”. La splendeur tardive du crépuscule ressemble à s’y méprendre à l’éclat sourd du déclin d’un monde, à la dilution des valeurs d’une sensibilité exténuée. Le coucher de soleil n’est plus, comme à l’époque romantique, le spectacle harmonieux et mélancolique offert par une nature aimable et féconde, il sonne le glas du vieux monde…»29 Le passage de la vision romantique à celle d’une fatalité inscrite dans les processus vitaux s’est accompli avec le siècle, parallèlement avec la défiguration des campagnes anglaises ou françaises et des forêts allemandes, sous l’irrésistible montée des villes populeuses où se ramassait la crasse et les détritus : «Le thème de la décadence - des mœurs, de l’art, de la religion, de la civilisation, de la domination politique de l’Occident - fleurissait dans l’intelligentsia de la seconde moitié du XIXe siècle (l’intelligentsia d’aujourd’hui croit bien à tort l’avoir inventé) et se renforçait de trouver un appui “scientifique” dans les théories neuropsychologiques, alors à la mode, de la dégénérescence nerveuse (extrapolée sans preuve à l’hystérie) et de la dégénérescence familiale (censée expliquer l’apparition d’un arriéré dans une fratrie aussi bien qu’établir le dogme de l’hérédité des maladies mentales). Seule échappait à la décadence la science, en progrès au contraire continu et dépositaire d’un espoir grandiose (que nous savons maintenant vain), celui d’apporter le bien-être, la raison et la concorde à l’humanité. D’où le schéma familial qui a servi alors de code à plusieurs romanciers et à de nombreux romans: l’aîné de la fratrie aura un destin “noble”; il sera savant ou médecin; le cadet ne sera qu’un artiste, un écrivain: c’est l’“idiot de la famille” (Flaubert, James, Proust, Huxley ont conformé leur vocation à ce schéma). Quant au troisième, s’il y en a, et surtout si c’est une troisième, elle sera dégénérée, hystérique: un “monstre” (par exemple, Alice, la sœur de William et d’Henry James)».30 Enfin, la guerre nouvelle, technicienne, destructrice de masse, celle à laquelle participèrent nombre de jeunes esprits cultivés et non plus des soudards comme dans les anciennes guerres monarchiques. La technique, c’était bien, mais elle était abandonnée dans des mains qui ne savaient l’utiliser que pour détruire et enlaidir le monde. «What concerned these writers or would-be writers was the decline of culture and the waning of vital energies; what drove them together was the desire to create new values and to replace those that were fading; what incited them to action was the conviction that they represented the future in the present; what dismayed them was their problematic relationship to the masses they would have liked to lead. Whether they called themselves Expressionists, Futurists, or Fabians, they felt above all like “young men of today”».31 L’énergie vitale était un thème nouveau parmi les philosophes, dont le Français Bergson fut le plus grand utilisateur. Il donnait à l’idée de déclin un aspect biologique, énergétique appelé à renouveler le thème là où les romantiques du siècle précédent l’avait conduit. Sans le prévoir, il allait conduire à l’investissement biologique du politique. Les thèses raciales, anthropologiques, souvent ramassis de préjugés et de stéréotypes issus de comparaisons gratuites, ouvraient irrésistiblement sur le racisme. D’autre part, les thèses psychologiques issues de la psychiatrie des Krafft-Ebing et autres criminalistes à la Lombroso, présentaient les facultés mentales et cérébrales comme sujettes à des dégénérescences dont le comportement violent était la traduction automatique. Entre la Psyché et le Logos, un fossé se creusait, fossé qu’eut beau condamné un Thomas Mann, revenu de sa passion nationaliste d’avant-guerre, aux lendemains de 1919 : «À partir de 1924, instruit par l’expérience personnelle et les leçons de l’histoire, il accordera le primat à la raison et à la volonté de l’homme contre les facteurs irrationnels. Ce qu’il reprochera à Nietzsche, c’est d’avoir méconnu le vrai rapport des forces entre l’intellect et l’instinct. Ce dernier, déjà trop puissant, n’a pas besoin d’être défendu contre l’esprit qui, lui, ne peut que vérifier sa faiblesse chaque fois qu’il se mesure avec les impulsions de la nature ou avec les mouvements de l’histoire. Toute la lutte menée contre le rationalisme depuis la fin du dix-huitième siècle repose donc sur une erreur. Certes, on ne peut plus souscrire à la formule naïve que tout est rationnel, ou que tout pourra et devra être rationalisé. Mais il est possible et souhaitable, notamment au niveau de la civilisation, d’introduire une certaine dose de rationalité dans le jeu des forces irrationnelles, dont il serait puéril de vouloir poursuivre la neutralisation complète. L’homme serait perdu s’il se soumettait sans lutte aux fatalités naturelles, et encore plus sûrement si, par un amor fati mal compris, il allait jusqu’à pactiser avec les puissances qui lui sont foncièrement hostiles».32 Mann était passé de l’école de Nietzsche à celle de Freud. Mais, comme bien d’autres, il devait réaliser que les temps n’étaient pas à l’intelligence.
Ils étaient à l’instinct. Et dans le contexte de l’impérialisme, ils allaient complaire aux théories raciales, eugénistes, psychiatriques. C’est là où l’hygiène rencontre l’idée de déclin, venant la confirmer tout en lui proposant des mesures prophylactique qui seront, par analogie, transférées sur les stratégies politiques et, malheureusement, policières et politiques. «Il circulait alors des théories raciales, biologiques et eugénésique - parfois même hygiéniques, dans l’esprit d’une prétendue “réforme de vie, qui ne peuvent être séparées des craintes simultanées d’une détérioration raciale générale. Cet état d’esprit est bien mis en valeur par les nombreux synonymes donnés au mot “danger”. Un écrivain allemand, A. Wirth, dépeint la mentalité de ses compatriotes en ces termes : “Autrefois, c’était les Français qui nous faisaient bouillir le sang; depuis quelque temps, ce sont les Américains, ou l’Internationale rouge, ou l’“Internationale de l’or” qui nous font trembler; ou l’ours russe qui essaie de nous dévorer ou le boa anglais qui prétend nous étrangler. Le danger “noir” ou “brun” était à la mode depuis la guerre des Hereros… À présent, l’immense “dragon jaune” est échauffé et menace d’assombrir notre ciel tel une puissante comète. Mais nous n’en resterons pas là”».33 L’effet produit ne pouvait être qu’une augmentation de la paranoïa, alimentant l’angoisse vécue par l’Occident depuis la fin du Moyen Âge. Cette croissance de la paranoïa allait fournir au sentiment d’apocalypse et à la menace d’expulsion un surcroît fantasmatique d’agressivité. De façon brutale, elle poserait ainsi la question : «Et pourquoi, après tout, notre domination sur le monde serait-elle la seule, dans l’Histoire, à être marquée du sceau de l’Éternité?»34 Marqué plutôt du sceau de la fatalité de tous les grands empires historiques, c’est dans le lointain passé – dans la Grèce ancienne, dans la Rome décadente – et dans le lointain Orient mystique, avec les preuves du déclin par analogie, que l’Occident irait chercher la confirmation du déclin dont il se voyait frappé.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la mode était à l’orientalisme. Les fouilles archéologiques, en Égypte et au Proche-Orient avaient été stimulées par l’expédition française sous le jeune général Bonaparte. Les romantiques et les archéologues avaient repris le flambeau. En remontant le temps, ils passaient par la chute de Rome sous le coup des invasions barbares; l’épuisement de la culture hellénique dans cette Alexandrie d’Égypte pleine de mystères d’Isis; les grands empires assyro-babyloniens avaient laissé des empreintes qui marquaient des étapes successives de déclins irréversibles. Bref, Valéry avait raison lorsqu’il proclamait que toutes les civilisations étaient mortelles. Les découvertes faites en Crète, loin de la Grèce continentale reconnue comme classique, laissaient transparaître une civilisation éclatante, bien plus primitive, mais tout aussi riche et dont les traces de la disparition brutale laissaient réfléchir : «“Les Minoens, après les deux millénaires où ils élaborèrent la première civilisation occidentale, disparurent de la scène occidentale, disparurent de la scène de l’histoire européenne” (De Sanctis). Leur chute fut-elle causée par une vie trop joyeuse et facile, bien que fortifiée par une croyance à la fois religieuse et politique? Il n’y a en effet pas trace sur l’île de grands temples minoens élevés pour abriter les images des dieux du ciel: de ce fait, il est légitime de supposer que leur culte était plutôt tourné vers l’adoration des divinités chtoniennes, dont les signes évidents sont l’histoire du labyrinthe et du Minotaure, et en général, l’importance qu’avait pris chez eux le “culte” du Taureau».35 En fait, les vestiges de Cnossos exhumés par Evans ne provenaient pas d’une décadence des mœurs mais d’un puissant tremblement de terre suivi d’un raz-de-marée qui, en ruinant la mer Égée et la Méditerranée orientale, avaient mis fin à la thalassocratie minoenne. C’est donc dire que les analyses du déclin de civilisations antiques servaient de miroir aux propres jugements de valeurs portés par les analystes sur l’Occident de leur époque. Ce n’est pas des réponses qu’ils cherchaient, mais des confirmations qu’ils étaient prêts à trouver, peu importe ce qu’il en coûterait à la vérité historique. En fait, tout ce que l’histoire minoenne pouvait confirmer, c’était l’avertissement que le président américain Ulysses S. Grant avait déjà prédit en 1873 : «Comme le commerce, l’éducation et le transport rapide de la pensée et de la matière par le télégraphe et la vapeur changent toute chose, je suis porté à croire que le Créateur s’occupe de faire du monde une maison unique, parlant une langue unique, une réalisation qui rendra désormais inutiles les armées de terre et de mer».36 C’est-à-dire que les empires n’étaient pas affaire de mœurs ou même de puissance politique, mais de voies de communication, de transports, d’éducation et de commerce. C’est ce qui avait fait la grandeur de Minos des millénaires avant le Christ, c’est ce qui devait faire la grandeur de l’Occident (et plus particulièrement des États-Unis dans l’esprit de Grant) pour le siècle à venir. En un sens, le président alcoolique avait parfaitement raison.
Les projections du déclin occidental dans le miroir de la situation de l’Orient étaient porteuses de confirmations plus exaltantes! L’exemple le plus proche de lui, c’est «l’homme malade de l’Europe», c’est-à-dire l’empire ottoman qui règne sur l’ensemble du Proche-Orient. Lors de la guerre de Crimée, les Anglais et les Français l’ont soutenu contre l’agressivité russe, un œil toujours fixé sur le passage des Dardanelles qui donnerait à l’Empire des Tsars un accès à la Méditerranée. Ses territoires africains font d’ailleurs partie de l’enjeu du partage de l’Afrique au congrès de Berlin : «La Turquie participait évidemment au congrès [de Berlin de 1878] qui était en effet consacré entièrement à la “question d’Orient”. Au fond ce n’était pas une question, ou plutôt c’était un problème qui contenait sa propre solution. Ce problème était celui de la dissolution de l’Empire ottoman. La solution consistait à partager ce qu’il en restait. Ces deux choses étaient si étroitement liées qu’il arrivait que l’on ne sache plus très bien si la dissolution était antérieure au partage ou si le partage était antérieur à la dissolution. Il s’agissait de savoir comment devait s’effectuer ce partage, mais cela non plus, ce n’était pas un vrai problème dans la mesure où il y aurait toujours assez à partager. Si l’Autriche voulait la Bosnie, la Russie pouvait obtenir la Valachie, l’Angleterre pourrait se contenter de Chypre et la France pourrait hériter de la Tunisie en guise de compensation. Si les États concernés le souhaitaient, le partage pourrait s’effectuer autrement. Ainsi, l’on joua très longtemps à ce petit jeu étant donné que, dans cet Empire ottoman, il y avait énormément à partager. Avec ses deux tentacules, cet Empire avait étreint jadis le bassin méditerranéen, s’étendant dans le Sud jusqu’au Maroc en embrassant au passage le Proche-Orient et l’Égypte, et atteignant dans le Nord les Balkans en se prolongeant jusqu’à la Bosnie et l’Herzégovine. Mais au fil du temps cet Empire s’était en grande partie effrité. Le tsar de Russie, Nicolas Ier, avait déclaré dès 1853 que la Turquie était l’homme malade de l’Europe et qu’il s’agissait de partager son héritage. L’Empire turc était en déclin depuis si longtemps déjà qu’il est quasi incompréhensible qu’il ait pu connaître une agonie aussi longue sans disparaître. Le déclin ottoman n’était pas un processus, mais une structure».37 L’état de l’empire ottoman en 1900 contrastait avec la grande peur qu’il avait suscité deux siècles plus tôt. Son État universel s’était désagrégé, comme l’avait dit le tsar, petit à petit, après la défaite de Lépante contre les armées alliées européennes. Le Divan (le gouvernement ottoman) apparaissait comme le modèle typique d’un Orient décadent, entre ses harems et ses étuves. L’écrivain Pierre Loti, qui avait résidé à Istambul et voyagé dans l’ensemble de l’empire, y avait aimé et y avait trouvé la matière de ses romans exotiques. À la veille de la Grande Guerre, où l’on verrait la Turquie s’allier avec les Empires centraux, «en 1910, Loti pleure la mort de tout ce qui avait permis le songe oriental, de tout ce qu’il venait retrouver depuis l’idylle d’Eyoub: “Choses du passé, toute cette ville qui s’effrite, tout cet Islam qui se décompose. Choses du passé, et du passé musulman, l’histoire de ma petite amie et de moi-même, choses qui vont finir ensemble dans la même poussière…”. Idée de déclin qui a tourné au leit-motiv. Dans les jardins du consul de France, à Orta-Keuï, où la fièvre l’a contraint à chercher asile, il regarde “fuir l’été, finir l’Orient, finir (sa) vie; c’est le déclin de tout”. Si, la nuit, le site environnant, le chant du muezzin, le heurt du bâton du veilleur évoquent toujours l’Orient, c’est de “l’Orient si triste, de l’Orient d’automne, de soir, de déclin et de mort”».38 L’Occident surveillait d’un œil perplexe la décomposition de cet empire qui ne faisait plus trembler, ni par son prosélytisme religieux, ni par sa tradition militaire.
En lieu et place, on chercha, angoisse paranoïde oblige, un nouvel épouvantail : «“Les Jaunes vivent dans le passé, les Noirs dans le présent, les Blancs dans l’avenir”, écrit en 1906 Félicien Challaye, pourtant l’un des esprits les plus ouverts de son temps, violent pourfendeur par ailleurs des crimes coloniaux. L’Asie, naguère prestigieuse, mère de civilisations fort belles, mais désormais flétries, décadentes… L’Afrique, peu évoluée, encore au stade de l’enfance, comme ses habitants qui vivent au jour le jour… L’Europe, seule capable d’imaginer un avenir fait de progrès ininterrompu… tout est dans cette formule».39 Avec la guerre des Boxers dans l’empire chinois morcelé, on crut bien l’avoir trouvé : «En 1900, la complicité de l’Empire chinois dans le siège mené par les Boxers des légations étrangères à Pékin entraîne l’envoi d’une expédition internationale de grande envergure, menée par des marins britanniques, des cosaques russes, de l’infanterie coloniale française, des bersaglieri italiens, des détachements des armées allemande et austro-hongroise, ainsi que par des gardes japonais et des marines américains. Cette opération est une totale réussite, montrant que l’Europe peut agir de concert quand elle le veut. Elle peut aussi vibrer et penser de concert. Les élites européennes partagent peu ou prou la même culture, un goût commun pour l’art de la renaissance italienne et flamande, la musique de Mozart et de Beethoven, le grand opéra, l’architecture médiévale, le renouveau classique, ainsi que pour la littérature étrangère moderne».40 Les Américains déjà fantasmaient, à la suite de la forte immigration de coolies chinois dans les grands centres de la côte ouest, l’idée d’un «péril jaune», et le gouvernement fédéral avait déjà édicté des mesures restreignant l’immigration chinoise dès le début des années 1880. Car, «la plus connue de toutes ces formules lapidaires est “le péril jaune” (dérivé sans doute du “péril américain”) qui exprimait tout un ensemble de menaces. Dans les pays blancs, les travailleurs redoutaient la concurrence des coolies et craignaient de se voir préférer une main d’œuvre habituée à un faible niveau de vie. Les économies européenne et américaine du Nord redoutaient la production japonaise. Enfin, on présentait une image des grandes nations “jaunes” qui, émancipées politiquement, dotées d’armes modernes, fortes de leur supériorité numérique, rejetaient les “blancs” de l’Extrême-Orient et se rendraient maîtres de l’Orient, peut-être même du monde. À cela se mêlait la crainte de voir s’infiltrer dans des territoires autrefois gouvernés par des blancs, non seulement des travailleurs jaunes mais aussi des fermiers et des immigrants de race jaune. Il y avait bien d’autres slogans synonymes de danger. Ainsi, à “l’Afrique aux Africains” s’opposait “le péril noir” et, réciproquement, l’Extrême-Orient commença bientôt de parler d’un péril “européen” ou “blanc” ou “occidental”. Enfin, ce fut seulement lorsque la politique eut pris des dimensions mondiales et que les peuples eurent commencé à se sentir concernés à une échelle mondiale par des ennemis, des conspirations, par la création de blocs et de fronts, que l’idée d’une conspiration sioniste visant à dominer le monde put se former et trouver créance…»41 Tous ces peuples lointains ou mystérieux apparaissaient comme des menaces potentielles sous formes de «géants endormis», les Chinois par leur population nombreuse; les Africains par la couleur de leur peau considérée comme une menace de métissage potentielle de la race blanche pure par des germes de dégénérescence négroïde. D’Afrique ne pouvait venir que des maladies contagieuses, des épidémies de fièvre jaune, des maladies du sommeil et autres exotismes mortels.
En fait, les Occidentaux angoissaient sans précisément savoir sur quoi précisément ils fixaient leurs angoisses. Celles-ci se déplaçaient selon les informations du moment, les découvertes ethnologiques ou les aventures relatées par des voyageurs qui, souvent, inséraient des pages purement fictives dans leurs carnets de voyages. La Salambô de Flaubert comme les tableaux orientaux de Delacroix fournissaient une série de thèmes érotico-violents qui jetaient à la fois, dans l’esprit des Occidentaux, des approches ambigües de l’étranger. Il ne faut pas oublier que le cinéma propagea ce type d’approches avec des films, tel celui de John Ford, intitulé The Lost Patrol (1934) : «Une patrouille chemine dans le désert d’Arabie pour se rendre à un endroit connu seulement de l’officier qui la commande. Mais cet officier est tué dans une escarmouche. Le sergent et ses hommes poursuivent leur marche sans savoir où ils vont. Exténués ils découvrent une oasis et décident d’y passer la nuit. Le lendemain l’homme de garde est trouvé poignardé. Les chevaux ont été volés. Un homme est blessé d’un coup de feu venu d’au delà des dunes et Abelson, grimpé en haut d’un palmier pour inspecter l’horizon, tombe tué d’une balle en plein front. Après une nuit tragique Cook et Mac Kay tentent de franchir la zone pour chercher du secours. Le soir deux chevaux ramènent leurs cadavres mutilés. Le matin suivant Quincannon s’élance, ivre de rage et tombe à quinze pas. Hale qui va le chercher est blessé et meurt après des heures de fièvre et de délire. Sanders, le mystique, s’effondre en prières. Soudain, un avion parti à leur recherche découvre la mosquée transformée en fortin et atterrit à cent mètres de là. Morelli, qui tente de prévenir l’aviateur inconscient du danger, est blessé à l’épaule et le pilote est tué. Brown et quelques autres succombent à leur tour. Cependant le sergent et Morelli rampent jusqu’à l’avion, dévissent la mitrailleuse malgré les balles qui crépitent autour d’eux et incendient l’appareil, espérant guider la colonne envoyée à leur recherche. Sanders en proie à une crise de folie mystique s’échappe, grimpe sur le haut des dunes. Morelli tente de le rattraper mais tous deux sont tués. Le sergent, blessé, reste seul survivant. Alors les Arabes se montrent, approchent… Secoué par les saccades de la mitrailleuse, le sergent, devenu fou furieux, les abat les uns après les autres. Quelques heures plus tard la colonne arrive. Le sergent, au garde-à-vous, désigne pour toute réponse les tumulus de sable sur chacun desquels, en guise de croix, un sabre est enfoncé. La colonne repart avec le sergent, hébété, à demi fou et disparaît derrière les dunes. Il n’y a plus rien autour de l’oasis que du sable, le soleil écrasant, le silence et la mort».42 Cette perception, inquiétante, de l’Arabie s’éloignait radicalement de celles fournies par Isabelle Eberhard ou T. E. Lawrence. C’était la vieille vision du «western» américain projeté en plein cœur de l’Afrique. À l’époque où l’Italie allait s’engager dans son aventure éthiopienne, c’était là servir des objectifs de civilisation des peuples restés «sauvages», à l’exemple de ce que les Américains venaient tout juste d’achever avec la conquête de l’Ouest.
Le déclin de l’Occident, c’était, pour le moment, le déclin de l’Europe et de son influence sur le reste du monde. Herder et Spengler avaient raison : c’est lorsqu’un empire atteint son plus haut point de développement que l’idée de déchéance, de déclin fait son apparition, et cause aussi des dommages importants au niveau de la conscience morale et de l’estime de soi. Le développement des moyens de transports et des voies de communications entraînaient une dérive du centre des civilisations, comme l’observait déjà Toynbee dans son Study of History. «Les États-Unis en 1898, le Japon en 1905, remportent respectivement sur l’Espagne et la Russie des victoires dont l’ampleur et la rapidité plongent l’Europe dans la stupeur. Ainsi, bien avant la guerre de 1914-1918 qui précipitera le mouvement, l’hégémonie plusieurs fois séculaire de l’Europe semble-t-elle condamnée à terme».43 Un tel constat suffit à saisir la racine profonde de la conscience du Déclin de l’Occident au tournant du XXe siècle. Si l’Orient pouvait toujours exercer un certain pouvoir de fascination pour les peuples des nations occidentales, la qualité affective de cette fascination tanguait de l’attirance à la répugnance. Des reportages nourrissaient cette instabilité affective de l’Autre, mais ne pensant qu’à soi, le déclin devenait la menace non seulement de perdre de sa vitalité énergétique, mais aussi de se voir envahir et dominé par une vitalité énergétique autre. Les Occidentaux apprenaient à se méfier des autres à la manière dont les Russes, en particulier les slavophiles, se méfiaient des Occidentaux. «L’amour du mode de vie russe, de l’esprit russe sont le pendant d’un rejet de l’Occident et de ses valeurs. Professeur à l’université de Moscou, Stepan Chevyrev, slavophile ardent […], écrit à propos de l’Occident et des Occidentaux: “Nous nous embrassons, nous nous étreignons, nous partageons le festin de la pensée, nous buvons la coupe des sentiments, sans remarquer le poison caché dans notre insouciant contact avec eux, nous ne sentons pas, dans l’amusement du festin, l’odeur du futur cadavre qu’ils dégagent déjà.” Alexandre Herzen lui fait écho: “Je vois la mort inévitable de la vieille Europe et ne regrette rien de ce qui y existe”».44 Si le sentiment du déclin de l’Occident était resté quelque chose de secret, de tabou ou à ne partager qu’entre soi, le sentiment aurait pu se vivre sans trop d’angoisses, mais dans la mesure où il était partagé par des observateurs étrangers, appartenant à des civilisations étrangères et potentiellement hostiles, cela devenait une menace, voire une condamnation irrémédiable, comme tant de romans, de films et de conférences le véhiculèrent avant et après la Grande Guerre. De fait, le discours sur le déclin de l’Occident resta un discours «pour adultes seulement». Il est douteux que dans ses classes Oswald Spengler ait longtemps entretenu ses jeunes élèves à cultiver ses théories. La chose devait rester du domaine des «grandes personnes». Ainsi en témoigne un Canadien de notre époque qui s’étonne que les manuels scolaires ne lui aient jamais enseigné l’histoire de la crise de 1929 : «Jamie est un étudiant très intelligent de dixième année, à Calgary, à qui l’on a beaucoup enseigné au sujet des rois et des reines d’Angleterre, des guerres obscures d’Europe, des premières explorations et découvertes sur la planète, sur l’histoire des États-Unis et la colonisation du Canada, à partir de Jacques Cartier jusqu’au Rapport Durham et la rébellion de Louis Riel, en 1885; alors, je l’ai questionné sur la Crise : “On nous l’a jamais enseignée, la Crise… les temps durs. Y a rien dans nos manuels, y a peut-être quelque chose à la bibliothèque mais j’ai rien vu. Ils nous l’enseignent pas, du moins, pas jusqu’à maintenant. Non, je sais pas pourquoi. Peut-être qu’ils veulent pas qu’on le sache, tout simplement. Je sais que c’est une époque où personne avait d’argent, même pas le pays. Oui, je sais ça. Ma mère me l’a dit. Elle m’en a un peu parlé, mais rien d’autre”».45 Cette censure institutionnelle montre ce que devait être le tabou que représentait le discours du déclin pour le commun peuple. «Ne pas vouloir savoir», mais être tenaillé par ce sentiment persistant du déclin, la hantise d’une apocalypse imminente, la répulsion à l’idée de se voir expulser de la domination du monde qui a si bien réussie à l’Occident depuis le XVe siècle. Non. Il valait mieux ne pas en parler.
1 O. Spengler. op. cit. pp. 51-52.
2 G. Durand. Introduction à la mythodologie, Paris, Albin Michel, Col. Biblio-Essais, # 4300, 1996, pp. 125-126.
3 M. Angenot. 1889, un état du discours social, Longueuil, Éditions du Préambule, Col. L’Univers du discours, 1989, p. 315.
4 E. J. Hobsbawm. L’ère des empires, Paris, Fayard, Col. Pluriel, # 8831, 1989, p. 114.
5 Cité in R.-J. Dupuy. Politique de Nietzsche, Paris, Armand Colin, Col. U, 1969, p. 255.
6 R. Girardet. Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, Col. L’Univers historique, 1986, pp. 134-135.
7 E. J. Hobsbawm. op. cit. 1989, pp. 292-293.
8 H. Stuart-Hugues. Consciousness and society, New York, Vintage Books, 1977, p.17.
9 M. Winock. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H131, 1990, p. 325.
10 M. Winock. ibid. pp. 109-110.
11 E. H. Hobsbawm. op. cit. 1989, p. 113
12 J. Crokaert. Histoire de l’Empire britannique, Paris, Flammarion, 1947, pp. 426-427.
13 J. Crokaert. ibid. p. 446.
14 J. Crokaert. ibid. p. 435.
15 J. Perrot. Henry James. Paris, Aubier, 1982, p. 11.
16 E. R. Curtius. Essais sur la littérature européenne, Paris, Grasset, 1954, 56pp. 258-259.
17 Cité in P. Sloterdijk. Globes, Paris, Maren-Sell Éditions, Col. Sphère, # 2, 2010, p. 244.
18 Z. Sternhell. Les anti-Lumières, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, #176, 2010, pp. 166-167.
19 Z. Sternhell. ibid. p. 595.
20 J. Chastenet. La France de M. Fallières, Paris, Fayard, rééd. Livre de poche, #2858, 1949, p. 469.
21 F. Tamagne. Histoire de l’homosexualité en Europe, Paris, Seuil, Col. L’Univers historique, 2000, p. 591.
22 Cité in J.-L. Loubet del Bayle. op. cit. p. 7.
23 Cité in J.-L. Loubet del Bayle. ibid. p. 52.
24 J.-L. Loubet del Bayle. ibid. pp. 248-249.
25 J.-L. Loubet del Bayle. ibid. p. 65.
26 J. K. Galbraith. La crise économique de 1929, Paris, Payot, Col. P.B.P., #138, 1961, p. 19.
27 J.-L. Loubet del Bayle. ibid. pp. 266-267.
28 P. Burrin. op. cit. 2000, p. 224.
29 S. Jouve. Les Décadents, Paris, Plon, 1989, p. 8.
30 D. Anzieu. Le corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque de l’Inconscient, 1981, pp. 198-199.
31 R. Wohl. op. cit. p. 5.
32 L. Leibrich. Thomas Mann, Paris, Éditions universitaires, #12, 1954, pp. 91-92.
33 H. Gollwitzer. L’impérialisme de 1880 à 1918, Paris, Flammarion, Col. Histoire illustrée de l’Europe, 1970, p. 172.
34 A. Ruscio. Le credo de l’homme blanc, Bruxelles, Éditions Complexes, 2002, p. 282.
35 P. Santarcangeli. Le livre des labyrinthes, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 1974, pp. 101-102.
36 Cité in E. J. Hobsbawm. op. cit. 1989, p. 75.
37 H. Wesseling. Le partage de l’Afrique, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, #107, 1996, pp. 43-44.
38 H. El Nouty. Le Proche-Orient dans la littérature française, Paris, Nizet, 1958, p. 135.
39 A. Ruscio. op. cit. p. 79.
40 J. Keegan. op. cit. 2005, p. 25.
41 H. Gollwitzer. op. cit. pp. 174-176.
42 J. Mitry. John Ford, t. 1, Paris, Éditions universitaires, #1, 1954, pp. 109-110.
43 P. Milza. Les relations internationales de 1871 à 1914, Paris, Armand Colin, Col. U, 1968, p. 165.
44 M. Heller. Histoire de la Russie et de son empire, Paris, Plon, 1997, p. 721.
45 B. Broadfoot. La grande dépression, Montréal, Québec-Amérique, 1978, pp. 7-8.
SIGNIFICATION
Chapitre I
LA BELLE INVENTION DE BENEDICT MOREL…
À la fin du XVIIIe siècle, les partisans de la Révolution française célébraient la grande “régénération” de 1789. Un siècle plus tard, le mot restait, mais le préfixe disait tout le contraire! La dégénérescence est le thème symbolique correspondant à celui du déclin dans l’Imaginaire et de la décadence dans la Moralisation. Par sa thématique, elle investit le processus de déclin de la civilisation occidentale – fait ou thème, peu importe – d’un aspect affectif essentiellement nourri de la culture de la haine qui caractérise l’Anus Mundi. La dégénérescence donc, est d’abord un signifié vers lequel convergent des signifiants de différentes provenances. Ils lui fournissent des observations, des constats, mais surtout des fantasmes qui supposent la régression sadique-orale de la civilisation occidentale à partir du milieu du XIXe siècle, phase d’un long processus amorcé dès l’âge baroque et qui consiste à la dérive de deux schizes de la psychologie collective.
I.1 DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
Avant d’aborder la définition même de ce qu’est la dégénérescence, nous devons nous demander les sources de ce fantasme. Et je pense bien les trouver dans l’ensemble d’une série de symptômes particuliers liées à l’angoisse vitale; cet étrange paradoxe affirmant que la formation de la société de masse fait naître une angoisse du dépeuplement et, par le fait même de la dévitalisation des Occidentaux. À peu près aucune nation occidentale, sauf l’Italie, les États-Unis et le Canada anglais, semble épargnée par la hantise du dépeuplement, et en France plus que nulle part ailleurs : «La crainte de la dégénérescence hante désormais les familles bourgeoises. À ce propos, un partage morbide tend à s’opérer : le microbe se plaît et prolifère dans le sang du peuple; il s’épanouit dans le vice et la saleté; ses domaines sont la rue, le taudis et le sixième étage*. Au contact du prolétaire, le bourgeois ne risque pas que la contagion; il peut devenir la victime d’une mutation biologique : le germe virulent, monté de la sentine sociale, a toutes chances de se transmuer, dans son sang délicat, en tare héréditaire. C’est la descendance tout entière qui se trouve alors compromise, le patrimoine génétique qui menace d’être altéré».1 La dépopulation est étroitement mise en cause avec la question hygiénique qui se pose d'une manière obsessionnelle. La dégénérescence apparaît essentiellement sous deux formes : l’appauvrissement du génome humain (pour employer un terme actuel) et le malthusianisme. Sous la première forme, on retrouve le dépérissement héréditaire et la maladies transmises sexuellement. L’émigration n’apparaît pas comme une cause première, sauf exception, et cette exception est le Canada français où un grand nombre d’habitants quittent la province de Québec pour aller travailler dans les États américains industrialisés : «C’est ainsi que le pays de Québec s’est appauvri d’hommes. L’émigration devint une véritable saignée, une hémorragie. Les Canadiens étaient assez nombreux aux États-Unis pour fournir quarante mille soldats aux États du Nord pendant la guerre de Sécession. Cette saignée et une mortalité infantile assez élevée empèchèrent la population de la province d’augmenter aussi vite qu’elle l’aurait pu, grâce à sa forte natalité. L’immense Gaspésie ne comptait pas trente mille âmes. Au recensement de 1861, certaines paroisses bas-canadiennes abritaient une population moindre qu’en 1851».2 Les autres pays d’où partent les exilés sont des pays souffrant de surpopulation, comme l’Italie, les pays scandinaves et l’Europe de l’Est. Dans de tels cas, l’angoisse de la dépopulation ne se manifeste pas.
Les perceptions sont ici en cause. Elles le sont depuis le premier XIXe siècle, aux États-Unis par exemple, juste avant ladite guerre de Sécession : «…aux États-Unis, le taux de natalité des esclaves excéda leur taux de mortalité bien avant l’interdiction de la traite, tandis que partout ailleurs, au Brésil, en Jamaïque, à Cuba, à Saint-Domingue, le maintien des effectifs de la population d’esclaves dépendit de l’importation continue d’Africains. Dans ces pays, lorsque la traite s’arrêta, le nombre d’esclaves décrut. En 1810, les 1,1 million d’esclaves des États-Unis représentaient le double des Noirs déportés d’Afrique au cours des deux siècles précédents. Pendant les cinquante ans qui suivirent, cette population fit plus que tripler, pour atteindre un total de 4 millions en 1860. Par contraste, le Brésil et les Caraïbes consommaient une énorme quantité d’esclaves. La Jamaïque, par exemple, importa plus de 750 000 Africains, mais il n’en restait plus que 311 000 en 1834, date de l’émancipation. Aux États-Unis, la population esclave était six fois plus importante en 1860 que le nombre d’Africains importés; en Jamaïque, elle l’était deux fois moins. Cette situation singulière des esclaves des États-Unis était pour l’essentiel due à un taux de natalité plus élevé et à un taux de mortalité plus bas que dans les Caraïbes et au Brésil…».3 Il n’en ira pas autrement en France où l’on s’imagine que la société est affligée de plusieurs tares héréditaires, de perversités sexuelles et d’un vieillissement de la population qui l’empêche de croître au même rythme que ses voisines : «Avec une population d’environ 180 millions d’habitants vers 1800, et un taux de sexagénaires compris entre 5% et 10% selon les pays, l’Europe comptait sans doute entre 8 et 12 millions de vieux. Un siècle plus tard, la population est de 400 millions, le taux de sexagénaires est compris entre 7% et 13% : l’Europe doit alors compter de 30 à 35 millions de vieux, ce qui est, dans l’absolu, considérable. C’est en France que l’armée de la vieillesse occupe le plus de terrain; un homme de 60 ans sur six ou sept est français, alors qu’il y a moins d’un Français pour dix Européens. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, que la connaissance objective de la vieillesse comme fait pathologique ou thérapeutique ait été, au XIXe siècle, prioritairement française, de même que les spéculations numériques sur la longévité de l’espèce humaine, et que la recherche d’un vocabulaire approprié à cette réalité nouvelle».4 Pour les analystes de l’époque, «un vieillissement prématuré de la population, très lourd de conséquences. Car si la baisse de la mortalité, qui profite aux vieillards, profite aussi aux enfants, la baisse de la natalité diminue la part des jeunes, et par suite la population vieillit. Les travaux successifs de Louis Henry et d’Alfred Sauvy l’ont démontré. En France, les plus de 60 ans ont représenté 8% de la population dès 1790, 12% dès 1870, proportions qui ne sont atteintes en Angleterre qu’en 1910 et 1931. La pyramide des âges de 1901, comparée à celle du XVIIIe siècle ou à celle du milieu du XIXe siècle, montre la base déjà rétrécie, le sommet déjà grossi, les deux signes du vieillissement. Il y a des vieux en France, on peut les évaluer avec une assez grande exactitude. Pour une population de 39,6 millions en 1911, une proportion de 12% de sexagénaires représente presque 5 millions de personnes, largement plus du double de leur effectif du début du siècle, et sans doute presque autant que dans toute l’Europe du XVIIe siècle. Le nombre des grands vieillards, peu étudié, a lui-même augmenté de manière très sensible : les octogénaires sont 159 000 en France en 1801, soit 0,55% de la population; ils sont 271 000 en 1851 - 0,74% de la population -, et 405 000 en 1901, 1,04% de la population».5 Mais le vieillissement n’est qu’un des facteurs démographiques à susciter l’angoisse vitale.
En France, l'état de santé de la population générale n'était pas des plus brillantes : «“…La France tend de plus en plus à devenir un peuple de petits et de moyens rentiers, de fonctionnaires médiocres et routiniers”. (Paul Leroy-Beaulieu) Mais en 1911, il était trop tard, la rupture démographique en France était consommée, et le pays allait effectivement payer cher cette victoire du vieillissement. Le facteur démographique a certainement contribué à convaincre soixante-six millions d’Allemands qu’ils viendraient facilement à bout de trente-neuf millions de Français, d’autant plus aisément que leur supériorité était écrasante dans les classes jeunes, et donc dans les effectifs militaires: de 1890 à 1896 (classes 1910 à 1916), il était né vingt-deux Allemands pour dix Français».6 Depuis la défaite militaire de 1870, l’impression persiste du dépérissement de la race française : «Le pourcentage des jeunes gens qui étaient à la fois en bonne santé et séduisants était relativement faible. On ne possède pas de données chiffrés sur les femmes, mais les données fournies par la conscription sur les garçons sont atterrantes. Une étude publiée en 1872 révélait que sur 325 000 appelés âgés de vingt ans, 18 106 étaient d’une taille inférieure à 1 m 45. 30 524 étaient de “faible constitution”, autrement dit souffraient de rachitisme ou de phtisie, etc.; 15 988 étaient boiteux, mutilés ou atteints de hernies, de rhumatismes, etc., 9 100 étaient bossus, avaient un pied-bot ou les pieds plats, 6 934 avaient des troubles de l’audition, de la vision ou de l’odorat. 963 souffraient de troubles du langage et 4 108 étaient édentés. 5 114 étaient minés par “la débauche précoce”, 2 529 souffraient de maladies de peau, 5 213 de goîtres et d’écrouelles, 2 158 étaient paralytiques, épileptiques ou atteints de crétinisme, et 8 236 étaient affectés de troubles divers. Il y en avait donc 109 000 en tout - soit un tiers - qui étaient infirmes ou difformes, et cela à l’âge de vingt ans».7 Les examens d’entrée dans l’armée apportaient des constats inquiétants : «La taille des recrues ne cesse de décroître et le nombre des réformés d’augmenter, affirment les gens renseignés : “On a été obligé d’abaisser et d’abaisser successivement le niveau de la taille pour le service militaire, la race se rapetisse”».8 Avant même le déclenchement de cette guerre de 1870, des indices laissaient croire que le sang français n’avait plus la vigueur d’autrefois : «Les travaux des démographes et des statisticiens, dont les méthodes se perfectionnaient rapidement, avaient permis d’en prendre la mesure exacte dès le milieu du siècle. Déjà l’écrivain Prévost-Paradol avait essayé d’alerter l’opinion dans La France nouvelle (1868). Mais en 1889, le remarquable bilan réalisé par Émile Levasseur (La Population en France) ne laisse plus aucun doute sur le déclin de la natalité. Aussi, à la fin du siècle, la réaction commence-t-elle à s’orchestrer : les ouvrages sur ce sujet se multiplient, les auteurs prennent un ton de plus en plus virulent, de plus en plus polémique. […] La plupart des auteurs s’en prennent aux Français en général et de préférence aux hommes, célibataires égoïstes ou maris trop prudents. Mais on commence aussi à sermonner les femmes…».9 La défaite, évidemment, était la conclusion qui confirmait, le plus naturellement possible, l’effondrement démographique. Quoi qu’il en fut, il fallait intervenir : «…la campagne qui se mène, au début du siècle, contre la dépopulation de la France. Il y a, en 1891, 2 622 170 filles majeures libres contre 7,5 millions de femmes mariées. Une fille sur quatre doit garder le célibat. L’existence des célibataires inquiète d’autant plus qu’elle se confond avec le fait que les couples mariés ont de moins en moins d’enfants. La France va vers la dépopulation et l’affaiblissement de sa puissance. On s’interroge donc sur la “crise du mariage”, on en cherche les causes et, comme chaque fois qu’il est question de “crise”, on répond immoralité et nécessité d’assainir les mœurs».10 C'était là l'effet d'une tendance marquée vers le malthusianisme.
Pourtant, cette subite puis progressive angoisse de la dépopulation était contredite par l’évolution même des facteurs favorables à la vie : une meilleure alimentation des populations, une puériculture développée, des jardins d’enfance surtout répandus en Angleterre qui faisaient la fierté d’un Ruskin vieillissant et imbu d’optimisme : «Nous avons maintenant la possibilité du destin le plus élevé qu’ait jamais eu une nation, destin qu’il nous est loisible d’accepter ou de refuser. Notre race n’est pas encore dégénérée; c’est une race mélangée avec le meilleur sang du nord. Notre caractère n’est pas encore dissolu; nous avons encore la fermeté voulue pour gouverner et la vertu nécessaire pour obéir…».11 Ce Discours d’inauguration lancé à Oxford encouragea le jeune Cecil Rhodes à prendre sur ses épaules le fardeau de l’homme blanc et partir à la conquête impérialiste de l’Afrique centrale. Seulement s’en tenir aux progrès médicaux suffisait. Philippe Muray opère un mixité hétéroclite à son habitude lorsqu’il écrit : «Sans les progrès de la médecine, il n’y aurait peut-être pas eu de socialisme. Celui-ci épouse idéologiquement les étapes de l’entreprise de sauvetage médical des hommes. Tout cela prend naissance au 19e en même temps que les yeux s’ouvrent sur cette nouvelle catégorie à prendre en compte : la démographie. La multiplication de la population. Dont toutes les théories du pouvoir vont désormais s’occuper. Pour s’assurer d’un droit de vie et de mort sur la prolifération. Essayer de l’encourager, de la programmer. Trop nombreux? Pas assez? Combien? Épidémies, hygiène, habitat, deviennent des sous-ensemble du nouvel ensemble majeur que personne ne pourra plus négliger désormais : la science démographique. L’ennuyeux, c’est qu’à se préoccuper si étroitement de la santé, on frôle d’inquiétantes tentations : c’est ainsi que naît médicalement la théorie de la dégénérescence, des sangs pourris, des sangs viciés, des souches épuisées qui ne se reproduisent plus. Des fins de races hémophiles héréditairement cariées. Les classes pourries… Au fond du précipice, le racisme biologique attend son heure…».12 En effet, si malgré les progrès médicaux, la dépopulation française sautait aux yeux des observateurs, il fallait bien en trouver la cause et y remédier.
La cause provenait-elle de l'intérieure ou de l'extérieure de la France? Pourquoi pas les deux? Comme les fils de paysans et d’ouvriers étaient les premiers appelés sous les drapeaux, on considéra d'abord que le mal appartenait à ces deux groupes sociaux : «L’Europe est en train de s’avilir, et tout fout le camp. Les ouvriers français sont même décrits dans les enquêtes les plus sérieuses comme particulièrement faibles; les canuts lyonnais sont par exemple vus à l’époque comme des “petits bonshommes rabougris aux jambes cagneuses”. Jules Simon parle d’un “lamentable abâtardissement de la race”. La crainte du bourgeois est à son comble quand, le 3 mai 1863, le journal “Le Siècle” lui annonce : “On sait que le ministère de la Guerre a cru devoir abaisser de quelques centimètres la taille des conscrits exigée par les anciens règlements. Serons-nous bientôt forcés de l’abaisser encore?” Il faut toute l’autorité de Paul Broca pour résister à la marée générale qui entraîne dans la psychose beaucoup de ses confrères, y compris au plus haut de l’université. Dans son ouvrage de contre-attaque, il démontre que, en fait, la stature des conscrits ne cesse de croître et que, si l’armée a abaissé la taille minimum, c’est seulement pour en enrôler davantage; que la durée de vie s’allonge, la moyenne passant de 27 ans en 1786 à 42 ans en 1856; que, si l’alcoolisme se répand très certainement en Espagne, Italie, France, Allemagne, c’est un signe d’élévation du niveau de vie. Mais ces précisions ne suffisent pas à endiguer la grande peur».13 Tenant compte du fait que ces deux classes étaient taxées d’avance de stéréotypes, «progressivement, les deux figures de la sauvagerie se différencièrent, le paysan étant plutôt abruti, l’ouvrier plutôt brutal. Les paysans trouvaient de plus en plus grâce aux yeux des critiques. Leur ignorance était moins fréquemment évoquée. Au contraire, la violence des populations urbaines et ouvrières résumait les menaces contre l’ordre social. Le changement intervint dès les années 1880 […]. Le philosophe Alfred Fouillée risquait un parallèle […] : “Le paysan ignorant est moins absurde que l’ouvrier à moitié éclairé.” Le jugement intervenait avant la grève de Decazeville en 1886 et la fusillade de Fourmies en 1891. Le souvenir des crimes ruraux, comme celui de Hautefaye en 1870, s’estompait, tandis que les grèves, les attentats anarchistes de la fin du siècle les supplantaient parmi les peurs de la bourgeoisie. Les troubles électoraux suscitaient des fantasmes proches. Les lieux de la barbarie s’étaient déplacés. Dans cette localisation sociale et imaginaire, il ne s’agissait pas de comprendre les significations complexes des comportements mais de les stigmatiser».14 Autrement, il fallait regarder du côté allemand : «En septembre [1870], certains observateurs de la dénatalité française, qui comptaient en leur sein de nombreux démographes amateurs, commencèrent à mettre en cause le contrôle des naissances de plus en plus pratiqué dans le pays. La contraception, prétendaient-ils, empêchait les familles bourgeoises de mettre au monde les rudes soldats dont le pays allait avoir besoin pour venger la honte de Sedan et repousser sur l’autre rive du Rhin ces Huns militaristes qui avaient volé l’Alsace et la Lorraine à la France. Du côté allemand on ne cessait évidemment de trouver fort alarmantes ces inquiétudes françaises. Et l’on n’était pas loin d’admettre que la notion de famille avait bien du mal à s’imposer outre-Rhin, même au sein des classes les plus prospères. De plus, il était clair que le taux de croissance de la population faiblissait sensiblement, alors que les Russes massés sur les marches orientales de l’empire produisaient un nombre de fils aussi considérable qu’inquiétant. La lutte pour la vie se devait également de prendre en compte le nombre des combattants. Ces prophètes de malheur se souciaient également de la condition physique des futurs combattants, nombre de ceux-ci présentant des malformations corporelles ou des handicaps visuels qui n’allaient pas manquer d’alerter les sergents recruteurs».15 De là à chercher chez le vainqueur l’origine de la décroissance nuptiale des Français, il n’y avait qu’un pas : «Certains démographes - tel René Gonnard dans sa Dépopulation de la France - imputèrent même à la lecture de Schopenhauer la baisse de la natalité française. Kant, Schopenhauer… Il y avait une symétrie des mauvais maîtres; chacun dénonçait celui de l’adversaire. Les deux camps se réconciliaient à tout le moins sur l’origine géographique des vents de l’esprit : ils provenaient des hautes pressions germaniques».16 Contrairement à Ruskin qui encouragea l’impérialisme et l’expansion coloniale par la valeur émérite du sang britannique, le cardinal Lavigerie, apôtre de la conquête de l’Algérie, de manière pessimiste, annonçait qu’«en France tout semble fini; dans l’immense Afrique au contraire, tout commence».17
Tous ces progrès médicaux et leurs résultats encourageants faisaient surgir les tares possibles qui pouvaient ramollir le caractère guerrier des Occidentaux, car il est significatif et important de considérer que si la hausse démographique de jadis importait pour les impôts et les taxes, présentement, cette hausse – ou cette baisse – n'était perçue qu'en fonction de la violence et de la guerre. Les médecins et les démographes rappelaient que «le taux de mortalité et l’espoir de survie ne sont pas les seuls critères de la santé d’un peuple; la morbidité ne diminue pas nécessairement lorsque le taux de mortalité est en baisse».18 À quoi bon servait d’accroître la quantité et la qualité de vie si celle-ci ne favorisait que l’abaissement des mœurs? Comme le regrettait Dostoïevski : «Quel est le péché, ou le malheur, de l’homme du Sous-Sol, cet intellectuel type du XIXe siècle? Le voici : “Nous tous, nous avons perdu l’habitude de la vie… À ce point même que nous éprouvons pour la vraie vie vivante une espèce de dégoût… Nous ne savons plus où elle est, la vie”».19 Ce péché gâtait la vitalité de l’homme qui ne répondait plus aux ambitions bourgeoises de l’économie ou à l’esprit guerrier des États. L’ex-président Théodore Roosevelt, qui avait été un enfant chétif et s’était mis à la boxe et à l’alpinisme pour faire saillir ses muscles, donnait le ton : «L’un des risques majeurs que présente la civilisation, déclara-t-il lors d’une conférence prononcée à l’université de Berlin en 1910, est - et a toujours été - sa propension à causer la disparition des vertus viriles agressives et la perte de l’esprit combatif. Lorsque les hommes parviennent à un certain niveau de confort et de luxe, il existe un risque que cette langueur agisse comme un acide sur la fibre de leurs qualités viriles. Le spectre de la perte de la virilité hantait, et ce qui le désespérait le plus était de constater que le sens du devoir résistait bien mal à l’apparition de situations jugées déplaisantes, dangereuses ou éprouvantes».20 Pour l'ex-Président des États-Unis, c'était là une rengaine qu'il ressassait depuis qu'il avait publié The Winning of the West au cours des années 1880, alors que la Frontière cédait devant l'urbanisation : «Pour Roosevelt..., et d'autres partisans de l'idéologie patricienne de l'art de la guerre et de l'expansion outre-mer, une exposition aux risques de la Frontière était censée fournir un correctif aux effets amollissants du confort et d'un excès de raffinement, un salutaire goût du danger qui restaurerait les qualités belliqueuses requises par le gouvernement d'État, la diplomatie et la guerre. La peur d'une décadence raciale hantait les hommes comme Roosevelt. L'élite dirigeante semblait avoir perdu une bonne partie de son élément "teuton". Son obsession pour l'économie, son retrait fastidieux du politique, sa natalité déclinante, parmi tant d'autres attitudes peu enclines à la guerre trahissaient toutes, aux yeux de Roosevelt, une perte de virilité. Les hommes "aux petits pieds et aux mentons fuyants" ne se montreraient pas à la hauteur des peuples, dont la grossièreté égalait le taux de natalité, qui étaient en train d'envahir le pays».21 Ernst Jünger fut facile à convertir : «La question cruciale, dans ces remous, est de savoir si l’on peut délivrer l’homme de la peur. Il importe plus d’y parvenir que de l’armer ou de lui fournir des médicaments. La force et la santé demeurent en l’intrépide. Au contraire,la crainte assiège ceux même qui s’arment jusqu’aux dents - et ceux-là plus que d’autres. On peut en dire autant de ceux qui nagent dans l’abondance. Les armes, les trésors sont impuissants à conjurer les menaces. Ce ne sont que des pis-aller».22 C’est avec ce type de pensées que les armées de 1914 s’engagèrent dans une guerre appelée à revigorer le sang des différentes nationalités en conflits. Le comble du paradoxe se ramena à la quantité effroyable de morts comptabilisée aux lendemains de l’armistice. «Plus de quatre ans d’hostilités ont enseveli un million et demi de Français, des hommes jeunes pour la plupart. Cette saignée sans précédent dans le corps d’une nation précocement atteinte par la dénatalité accuse le vieillissement de la France».23 En Angleterre également on ne s’en inquiéta pas moins : «Dès l’armistice, des voix s’élevèrent en Angleterre pour faire remarquer que cette victoire avait été payée très cher et que la perte de vies humaines se traduisait par une diminution énorme de la vitalité britannique. Or, une telle hémorragie est mortelle pour un État qui domine qualitativement le quart de l’Univers. Le rapport des forces, pour peu que l’on persistât dans ces errements, serait bientôt catastrophique».24 Dans son roman Gilles, Drieu La Rochelle étalait les tares de la société française : «“La France se meurt”, de maladies multiples et incurables. Il n’est besoin que de visiter un village normand pour mesurer les ravages de la dépopulation et de l’alcoolisme; il y a eu les morts de la Grande Guerre, les blessés, les mutilés, survivants sans progéniture, ou ceux qui ont eu des enfants, “tous morts en bas âge; alcoolisme et syphilis…”, et puis tous ceux qui sont partis pour la ville. Le tableau soulève le cœur. La France ne s’est pas remise de la grande saignée, et ceux qui y ont survécu sont abîmés dans l’éthylisme et l’infécondité. Quand la décadence a corrompu jusqu’au village, on imagine dans quelle turpitude la ville se putréfie. “Les cinémas et les cafés, les maisons de passe, les journaux, les bourses, les partis et les casernes”, autant d’attributs infamants du monde moderne. Au nadir, Paris est devenu une concentration d’intellectuels débraillés (qui ont perdu “la dignité des anciennes mœurs”), de noceurs, d’homosexuels (“Il y en a partout. Avec la drogue, c’était la maladie qui lui avait le plus déchiré le cœur à Paris”); la peinture de Picasso, les music-halls, les romanciers catholiques, les Juifs, “les cauteleux radicaux francs-maçons”… On jauge la profondeur du mal».25 Drieu n’était pas le seul à avoir perdu toute confiance dans le sang français. Le 29 septembre 1939, au moment où la guerre avec l’Allemagne commence, le député socialiste Peschadour lança : «La France, victorieuse ou vaincue, sera une nation perdue si la guerre dure quelques années. On ne peut pas, je crois, dans une nation aussi peu peuplée que la nôtre, faire une saignée de quelques millions de jeunes hommes sans que s’effondre cette nation».26
Comme on l’a vu avec l’échantillon de tares apporté par Drieu, le comportement sexuel était le premier visé parmi les causes de la dépopulation et dans l’ensemble de la dégénérescence du sang national. En Italie, on visa moins les Juifs que ceux dont on soupçonnait une tare génétique ou une déviation sexuelle. L’ennemi, «(du moins jusqu’à la guerre d’Éthiopie en 1935 et aux lois raciales de 1938), ne s’incarnait pas dans une minorité (les Juifs) ni dans une puissance étrangère, mais était figuré par la menace de dégénérescence qui sapait le pays de l’intérieur. Toutes les vertus viriles de discipline d’action, de camaraderie, furent élevées au rang de suprêmes valeurs morales. Achille Starace, secrétaire général du Parti fasciste entre 1931 et 1938, organisa des croisades de pureté qui en appelaient à plus d’austérité et de rigueur. Le fasciste était un être exemplaire, en lutte contre la dégénérescence, incarnant la pureté masculine».27 En Allemagne, on mènera simultanément la guerre raciale et la guerre sexiste. En France, «le Dr Sicard de Plauzoles, dans un ouvrage intitulé Pour le salut de la race : éducation sexuelle (1931), soutient que les conscrits sains, robustes, bien constitués, sont en diminution constante. Par contre, le nombre d’anormaux et de dégénérés ne cesse d’augmenter, avec pour cause “la civilisation”, c’est-à-dire l’alcool, la misère, la syphilis, la tuberculose, la perte des repères sexuels. De la même façon, le Dr Jean Pouÿ, dans Conseils à la jeunesse sur l’éducation sexuelle (1931), explique qu’on pourrait “arrêter sur la pente des habitudes perverses bien des jeunes gens dont la France dépeuplée réclame toutes les énergies”. Une seule solution : “l’acte admirable de la procréation”…».28 L’entraînement physique qui fit des régimes fascistes les guides de la nouvelle éducation moderne et la sévère morale sexuelle n’empêchèrent pas davantage l’inéluctable : «Or la Seconde Guerre mondiale a vu se reproduire des scènes d’horreur, déclenchées par une crainte toujours présente dont l’holocauste est un des signes. Tous ces éléments font penser que la panique, la rapidité avec laquelle elle se répand, représente pour l’essentiel une infection narcissique. De même que dans toutes les infections, virus et microbes sont présents, latents. Mais, tant que nous sommes en bonne santé, tant que notre état physiologique demeure satisfaisant, rien ne se passe. Aussitôt cependant que, pour des raisons d’alimentation, de fatigue excessive, de mauvaises conditions de vie, cet état de santé se détériore, virus et microbes se manifestent et prolifèrent. Pour cette raison, on comprend combien il est difficile d’enrayer la panique. On se trompe en croyant qu’il suffit de rassurer les personnes, de leur donner des instructions “claires” pour les amener à se comporter de manière raisonnable. Seul le rétablissement d’une identité, la reconstitution de la structure de la foule par un commandement ferme, peut y parvenir».29 D’ailleurs la dépopulation du Vieux Continent devait toujours lutter contre l’attraction du Nouveau Monde qui s’agitait en vue d’attirer à lui les populations non désirées. Des pays comme l’Argentine, les États-Unis et le Canada appelaient à l’immigration : «Les grandes compagnies de transport, la “Gazette”, le “Star”, le député israélite Samuel-William Jacobs et une Canadian Colonization Association, fondée à Winnipeg et présidée par sir John Willison, poussaient le gouvernement fédéral à intensifier l’immigration. “Il nous faut importer des contribuables et des consommateurs”, disait Shaghnessy. Il fallait surtout importer des clients pour le Pacifique-Canadien et des Anglo-Saxons pour compenser la natalité canadienne-française. Et ce dernier point l’emportait encore. On n’en parlait jamais mais on y pensait toujours. Quand la “Gazette” ou le “Star” demandent des immigrants “de premier choix”, ils ne veulent pas dire impeccables au point de vue physique ou moral, ils veulent dire simplement: des Anglais. Les repris de justice raccolés par l’Armée du Salut dans les faubourgs de Londres et envoyés au Canada pour se “régénérer” constituent du “first choice”. Clifford Sifton s’exprime plus brutalement - plus franchement - quand il parle de remplir le pays “à coups de pelle”. Quant à Samuel Jacobs, député à l’allure de rabbin, très influent, non seulement parmi ses coreligionnaires mais auprès du gouvernement fédéral, il obtient de discrètes et continuelles faveurs à l’égard de l’immigration juive, aussi inquiétante pour le développement national d’un Canada français. Et les Canadiens français… redoutent instinctivement cette grave menace».30 Ceux qui avaient vu les leurs émigrer massivement vers le pays voisin se sentaient déjà menacés de dépossession par ces vagues renouvelées d’immigrants bien avant que ne commence le grand mouvement des personnes déplacées d’après-guerre de 1946.
Sans l’angoisse vitale de la dépopulation de l’Occident et en particulier de certaines nations européennes, le discours obsessionnel sur la dégénérescence n’aurait sans doute pas eu le succès qu’on lui connaît. Entre déclin et décadence, la dégénérescence trouva son sens propre, le moteur pulsionnel des deux autres. Elle justifiait la décadence et expliquait le déclin. La motivation profonde résidait dans la régression qu’elle entraînait et la paranoïa, nec plus ultra de la culture de la haine, qui se diffusa entre le milieu du XIXe siècle et le premier quart du XXe. Le thème, toutefois, a vieilli très vite après la Seconde Guerre mondiale. On a fini par le perdre de vue entre le déclin de Spengler et celui de Toynbee. Il semblerait que la dénazification l’ait emporté avec elle : «Le thème de la “décadence” nous est connu; celui de la chute des États dû à la déchéance de ses élites est ressassé depuis longtemps; quant à celui de la “dégénérescence”, il date du siècle dernier et répond plus à une inspiration morale qu’à des explications médicales», écrit J.-C. Sournia.31 Le thème est là, tapie sous celui de décadence, mais il a son signifié propre même s'il appartient à une même série de signifiants. Il n’est plus que cela d’ailleurs, un résidus d'un nominatif indéfini. Si nous distillons comme il le faut l’ensemble de la représentation sociale d’où elle émerge, il y aura un tube pour recueillir l’essence même du signifié de la dégénérescence, entre le déclin et la décadence.
Le concept de dégénérescence n’a pas surgi comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il s’est diffusé lentement, sournoisement dirait-on, cheminant vers le moment où le darwinisme social, l’hérédité et le racisme devaient l'enrichir. Dès le second XVIIIe siècle, on le voit apparaître sous «le grand thème, nouveau lui aussi, de la “dégénération” des corps, de la dégradation de l’espèce, de la décrue des populations. La question inquiète en effet. Et sur la vigueur physique, sur le renouvellement démographique, c’est dans la perspective économique et politique que l’on s’interroge. Force productrice de biens et de richesses, le corps multiplié ne multiplie-t-il pas ces biens et ces richesses? La multitude féconde et efficiente - parce que bien portante - n’assure-t-elle pas un meilleur équilibre entre sa croissance et ses ressources? L’idée que “l’homme est […] le plus précieux trésor d’un Souverain” [Moheau] se couple à la doctrine physiocratique de “la terre […] mère de tous les biens” [Mirabeau père]. On analyse les effets réciproques du nombre et du produit agricole : “Les États ne se peuplent point suivant la progression naturelle de la propagation, mais en raison de leur industrie, de leurs productions, et des différentes institutions […]. Les hommes se multiplient comme les productions du sol et à proportion des avantages et des ressources qu’ils trouvent dans leurs travaux”».32 Moheau cite encore le cas de la dégénération des chevaliers en noblesses de cour : «Si l’on compare la force des anciens chevaliers français à celle des héritiers de leur nom, si l’on pèse les armures qu’ils portaient dans les combats, et que leurs descendants pourraient à peine soulever; on est tenté de croire que l’espèce humaine a dégénéré en France, au moins dans la classe des gens de qualité et cette présomption ne sera pas sans quelque vraisemblance si l’on considère qu’une suite de générations d’hommes amollis par l’oisiveté doit donner des hommes moins forts que n’étaient leurs aïeux: Heureusement rien n’annonce cette dégradation dans la force des gens du peuple».33 Contrairement au futur discours de la dégénérescence, Moheau valorise la force des gens du peuple contre la dégradation de la caste nobiliaire à la veille de la Révolution. L’hypothèse de la dégénération repose sur des signes pathologiques manifestés par certains individus. L’aspect névrotique n’est pas absent que l’on se contente encore d’expliquer par des origines métaboliques plus fantaisistes que réels : «C’est ainsi que des troubles circulatoires ou, chez la femme, des irrégularités dans la menstruation, peuvent se traduire par des visions de sang ou d’incendie. Les maladies de cœur donnent lieu souvent à des rêves d’épouvante où la mort intervient. Les asthmatiques font des rêves d’ascension pénible qui les suffoque. Les tuberculeux étouffent, fuient, sont emportés dans une foule qui les oppresse. Il n’est point de maladie qui ne puisse trouver sa représentation en rêve».34 La place que prendront les manifestations psychiques s’accroîtra avec le temps. «Fin XIXe, le mot, d’origine médicale, a “envahi les vocabulaires médicaux, anthropologiques et littéraires de plusieurs pays européens”, dont la France : le voici banalisé, employé à tout propos. Cette notion vague, écrit Anne Carol, “finit par devenir un miroir que le médecin […] tend à la société pour lui renvoyer l’image de ses propres phobies, estampillées d’un poinçon scientifique”. On n’est plus ici dans le champ scientifique, mais dans le domaine idéologique».35 Le mot dégénérescence a remplacé celui de dégénération et s’est doté d’une essence capable de classifier des êtres en-dehors de la normalité, mais aussi du droit de laisser vivre ou faire mourir de la biocratie. Comme le rappelle Audoin-Rouzeau : «Cette lecture de la dégénérescence sous la forme d’une endémie atteignant toute une nation était en place avant 1870, mais c’est la défaite qui lui donne son ampleur».36
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, l’un des principaux utilisateurs de la dégénération est le comte de Gobineau, romancier, linguiste, historien : «la thèse de Gobineau implique que la civilisation aurait constamment déchu, puisque la race blanche s’est constamment souillée par des croisements depuis ses origines. Or ce n’est évidemment pas ce que montre l’histoire. Les variations de l’élan civilisateur ne sont pas dues non plus aux variations dans le dosage des sangs : en quinze cents ans la composition ethnique de l’Allemagne n’a pas changé, et cependant son être politique et sa culture ont subi bien des vicissitudes. De même pour la France, depuis le début du Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe siècle. Enfin une grave lacune s’accuse dans la doctrine raciste : à l’Aryen prétendu instituteur de tous les peuples, elle refuse le sens artistique, apport du sang noir. Or une société sans poésie, réduite à l’organisation la plus positive, mérite-t-elle encore le qualificatif de civilisé?».37 Gobineau est un mal sentant de la Révolution française et sa vision générale de la dégénération coïncide avec sa propre mise à l’écart de la société. Comme l’écrit Hannah Arendt, «petit à petit, il identifia la chute de sa caste avec la chute de la France, puis avec celle de la civilisation occidentale, et enfin avec celle de l’humanité tout entière. Ainsi fit-il cette découverte - qui lui valut par la suite tant d’admirateurs parmi les écrivains et les biographes - que la chute des civilisations est due à une dégénérescence de la race, ce pourrissement étant causé par un sang mêlé, car dans tout mélange, la race inférieure est toujours dominante. Ce type d’argumentation, qui devint presque un lieu commun après le tournant du siècle, ne coïncidait pas avec les doctrines progressistes des contemporains de Gobineau, qui connurent bientôt une autre idée fixe, celle de la “survie des meilleurs”».38 Le racisme de Gobineau, on l’a dit, est encore un racisme de classe ou d’ordre. À ses yeux, si les révolutionnaires ont pu mettre à bas la société d’Ancien Régime, ce n’est pas parce que leur cause était la meilleure, mais parce que les ordres anciens s’étaient engagés dans une voie dégénérative dont le renversement était prévisible. Aussi, «ce n’est pas une apocalypse qu’entrevoit Gobineau, une catastrophe soudaine et brutale. Non. Dans son hiver bernois, il rêve plutôt de froid et de silence, de marais et d’enlisement, d’abrutissement généralisé. Il voit des “troupeaux humains, accablés sous une morne somnolence, engourdis dans leur nullité, comme les buffles ruminants dans les flaques stagnantes des marais Pontins”. Le “dernier homme” sera peut-être “plus sage, plus savant, plus habile”; il n’en sera pas moins voué, par son culte de la consommation et sa soumission muette aux futurs Inspecteurs et Inquisiteurs (qu’entrevoyait Dostoïevski à la même époque) à la décrépitude et à l’anéantissement».39 La bourgeoisie française n’avait donc rien à craindre mais les écrits de Gobineau servaient de sévères mises en garde contre sa propre dégénération, «la faiblesse organique devient faiblesse de civilisation».40 Coup sur coup, la défaite devant la Prusse puis la Commune de Paris suscitèrent suffisamment d’émois pour croire que vite montée au pouvoir, la bourgeoisie pouvait en être précipitée de même. Sans ce contexte angoissant, on ne pourrait pas voir la vitesse avec laquelle la dégradation d’ordre s’est muée en dégénérescence atavique : «Un débat s’est noué au point d’en être dramatisé avant même la découverte pastorienne : la dégénérescence, l’abâtardissement progressif de l’espèce, sont brusquement perçus comme autant de menaces. Ravages physiques de la première industrialisation, sans doute, avec sa masse croissante d’ouvriers étiolés, mais aussi prospection de maux plus secrets, abaissement des naissances, consommation d’alcool, crainte de désordres, de délabrements intimes, et surtout appel quasi moral à l’engagement de tous. L’insistance sur une dégénérescence possible est une façon d’agiter un danger massif, de mobiliser les consciences, d’inventer des solidarités : accroître la force des grands messages collectifs dans une société où s’efface toujours plus l’argument religieux. D’où la reformulation du projet hygiénique après 1850, la certitude de nouveaux enjeux, l’attention aux faiblesses morales, par exemple, susceptibles d’inverser le progrès, celles que la défaite de 1870 a semblé confirmer».41
Mosse est d'accord avec Vigarello à propos du succès que prit «le terme “dégénérescence” [qui] résumait toutes les craintes qui hantèrent la société à partir de la fin du siècle. À l’origine, il s’agissait d’un terme médical employé par les médecins pendant la seconde moitié du XIXe siècle pour identifier ceux qui s’écartaient du type humain dit normal parce que leurs nerfs étaient éprouvés, qu’ils avaient hérité de traits anormaux ou s’adonnaient à des excès moraux ou sexuels. De telles particularités commençaient un processus qui devait inévitablement mener à la destruction. Il était possible d’identifier les dégénérés à leur apparence : difformités corporelles, yeux rouges, faiblesse et apathie. […] Non seulement les humains, mais aussi les nations pouvaient dégénérer, processus que l’on jugeait avoir déjà commencé à cause de la baisse du taux de natalité dans des nations comme la France par exemple. Ainsi ceux qui refusaient de se conformer aux exigences morales de la société et à ses normes étaient qualifiés de dégénérés, et, comme ils étaient eux-mêmes condamnés à la destruction, ils pouvaient détruire la société elle-même».42 Les maladies mentales étaient incontestablement les signes de dégénérescence les plus tangibles. Si chaque village du passé avait son fou, l’accumulation urbaine engrangeaient les déficients mentaux, ceux qui étaient victimes d’un atavisme héréditaire comme ceux dont l’esprit s’était embrumé suite à une maladie vénérienne, voire même à une pratique assidue de la delectatio moroza (la masturbation). Déjà on pouvait accuser les Français, comme Pétain le fera en 1940, de s’abandonner à l’esprit de jouissance : «Époque de facilité, de confort, de sécurité, de fonctionnariat, époque molle et castratrice : un “monde hermaphrodite”, s’écrit Barbey d’Aurevilly, peuplé de “demi-mâles”, soupire Barrès, un monde “dont la virilité s’affaiblit”, se lamente Zola. La nouvelle de D. H. Lawrence, New Eve and Old Adam, a beau être focalisée sur la relation conjugale, le malaise du mari, Peter Moest, ne s’y manifeste pas uniquement dans le domaine amoureux».43 Évidemment, la liaison entre sexualité et maladies mentales apparaissait d’elle-même aux yeux d’une élite qui observait le ramollissement de la vie urbaine. Les fils de bourgeois s’adonnaient à des plaisirs souvent coupables et transmettaient à leurs épouses les tares qui devaient se retrouver dans leur progéniture. On devinait, avec Zola, avec Henry James, avec Thomas Mann, le sort qui attendait ces pauvres héritiers : «Les trois figures cardinales de la psychiatrie moderne, l’hystérique, le débile et le pervers, s’ordonnent à partir de cette préoccupation. Du côté où la pathologie de la volonté domine, on a l’hystérique, ses fugues, ses mensonges irraisonnés, ses amnésies partielles. Du côté où la pathologie de la race l’emporte, on a le débile, ce produit d’une involution biologique. Enfin, au point de rencontre maximum des deux pathologies apparaît le pervers, celui chez qui la volonté, totalement inversée par rapport au sens moral, vient coïncider avec l’instinct, dans ce qu’il a de plus “animal”. Cet effort théorique s’effectue principalement sur le personnage social du vagabond, qui réunit à merveille les deux préoccupations, raciale et disciplinaire, de la psychiatrie. Le vagabond, ce “dégénéré impulsif”, cette incarnation de l’atavisme et de l’indiscipline réunie, est bien trop intéressant aux yeux de la psychiatrie pour qu’elle en fasse, comme la justice, une catégorie particulière. Pour une dizaine d’années (1890-1900), le vagabond deviendra l’universel de la pathologie mentale, le prisme à travers lequel on pourra distribuer toutes les catégories de fous et d’anormaux».44 On serait en droit de se demander toutefois pourquoi Chaplin n’a jamais tourné un Charlot chez le psychiatre? Tout le mal ne pouvait provenir que d’une ethnie ou une classe étrangère à la bourgeoisie, et si le vagabond était l’incarnation de l’atavisme et de l’indiscipline réunie – c’est-à-dire, la dégradation de l’individu et de la civilisation tout ensemble -, les fils de paysans étaient le produits de relations incestueuses tandis que les fils d’ouvriers héritaient de l’alcoolisme de leurs ancêtres. Dans cette vision simpliste de l’hérédité, simplisme qui se retrouve insistant chez Zola, dégénérescence et décadence se fondaient en un seul travers de civilisation qui ne cessa d’angoisser l’Occident d’avant-guerre : «Bien avant la guerre qui commandait “la rapide transformation de la vie en énergie”, pour reprendre les mots d’Ernst Jünger, le modèle masculin s’était déjà chargé de dynamisme et de vigueur, formant un puissant contraste avec l’image traditionnelle de la femme. Ses deux terreurs était l’efféminement et la décadence ou dégénérescence - à l’origine, un terme médical signalant une déviation de “la normale” menant progressivement à la destruction. Elle était provoquée soit par l’hérédité, soit par une fragilité nerveuse, soit par l’alcoolisme. La décadence représentait donc l’exact contraire de la masculinité, et le mot s’appliquait à ceux que l’on méprisait ou qui faisaient peur. L’ennemi était, bien entendu décadent, et s’il ne l’écrasait pas, le pays risquait d’être contaminé. Par cette vision de l’adversaire, la propagande de guerre trahissait ses propres craintes».45 Le malheur résidait dans le fait que toutes les nations pensaient ainsi, et chacun pour elle-même!
Si le terme de dégénération a pris près de trois quarts de siècle à s’imposer, celui de dégénérescence s’est imposé très vite pour les raisons mentionnées plus haut. Son emprunt s'est propagé d’une langue à l’autre et le monde médical soumis cette piste nouvelle à la critique de l’épistémologie de Claude Bernard, l’observation et la vérification. Au milieu du XIXe siècle, les théories psychiques allaient dans tous les sens et débordaient plus souvent qu’autrement dans la fantaisie, ainsi ce docteur «Friedrich Hacländer, [qui] dans Handel und Wandel (“Commerce et monnaie”, 1850) démontre que les voyages fréquents conduisent à la folie, tout comme les spéculations commerciales et les attaques contre le travail dit honnête. Ces exemples révèlent la crainte d’une modernité qui s’emballait et le désir de garder la maîtrise d’une société en pleine mutation».46 Non seulement de telles fantaisies condamnaient-elles le gagne-pain de la bourgeoisie, mais en plus elle ne reposait sur rien de solide, alors que la dégénération était perçue, avec Gobineau, comme une menace certaine et très grave pour l’avenir. C’est alors qu’apparut le docteur Benedict Augustin Morel (1809-1873) qui, le premier, voulu faire peser de tout son poids la science médicale la validité du concept de dégénérescence : «Dans son célèbre Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine (1857), Benedict Augustin Morel le dit nettement : “J’ai été frappé par la progression croissante en Europe de la folie et de tous les états anormaux qui sont liés, dans la société, à la présence du mal physique et moral.” “Dégénérescence” est un terme médical qu’il faut distinguer de “décadence”, mot utilisé par des poètes comme Baudelaire et des écrivains comme J.-K. Huysmans dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui lui donnaient une connotation positive, désignant une nouvelle sensibilité, un extrême raffinement, une sensibilité nerveuse plus caractéristique de l’androgyne que du “vrai homme”. Pourtant, “dégénérescence” et “décadence” furent confondues et finirent par devenir interchangeables. De fait, la décadence, telle que la comprenaient les écrivains et les artistes, n’étaient que dégénérescence pour les défenseurs de la norme».47 Outre le fait que Morel établissait une distinction entre dégénérescence et décadence, «sa théorie de la “dégénérescence” considérait la folie comme une dégradation - consécutive à des pressions sociales ou physiques - de la forme humaine originellement créée par Dieu. Les plus grands dommages étaient dus à l’alcool (et à l’opium en Orient), mais l’industrialisation, elle aussi, était dommageable. La folie n’était donc pas un signe de primitivisme mais d’effondrement, c’est pourquoi elle était incurable. Elle était en nette augmentation et, à moins d’une amélioration du sens moral, elle ne ferait qu’augmenter. Un nombre énorme d’individus étaient héréditairement prédisposés à la folie, et les asiles n’abritaient qu’une petite minorité des gens atteints. La tare héréditaire était généralement si enracinée qu’on ne pourrait l’éliminer que par un croisement de races, avec des peuples primitifs non contaminés; en attendant, il fallait décourager les mariages entre Français dégénérés. Cette théorie était d’autant mieux reçue qu’elle s’accordait parfaitement avec les préjugés traditionnels et les doctrines chrétiennes concernant l’influence de l’hérédité et le laisser-aller des mœurs. La science semblait confirmer les appréhensions les plus pessimistes».48
En effet, Morel n’était pas plus optimiste que Gobineau. Le directeur de l’asile du Manoir de Saint-Yon, à Rouen, ne pouvait s’empêcher de claironner que «l’alcoolisme (un problème fort débattu à l’époque), de mauvaises habitudes personnelles, le poids des conditions sociales et, surtout, l’hérédité [sont les causes de la dégénérescence]. L’arbre généalogique cesse de pousser, car la décadence n’a d’autre issue que la stérilité et l’extinction».49 Morel, contrairement aux autres psychiatres de l’époque, voulait dépasser la simple description des symptômes et créer une science de la dégénérescence : «Les théories des premiers aliénistes fonctionnaient sur la base d’une symptomatologie. Le diagnostic de la folie s’établissait à partir de la description de ses manifestations, qui produisaient les différentes espèces de monomanie. L’intelligibilité était donc dans les signes extérieurs. À partir de Falret, Baillargé (1854 : La folie à double forme) et surtout de Morel (1857 : Le Traité des dégénérescences), cette intelligibilité ne se trouve plus dans le signe explicite mais doit être perçue dans une sous-jacence à celui-ci qui n’est plus qu’étape apparente d’une évolution en cours, prévisible pour qui saura l’interpréter. Du coup, la maladie mentale n’est plus une exception spectaculaire que l’on doit isoler et éventuellement traiter, mais un phénomène toujours latent, nécessitant un dépistage précoce, une intervention prophylactique sur l’ensemble des causes qui, dans le corps social, favorisent les mécanismes de dégénérescence; à savoir, les conditions de vie misérables, les intoxications, comme l’alcoolisme, auxquelles s’exposent les populations pauvres. Bien avant l’actuelle sectorisation, le psychiatre aspire donc à sortir de l’asile pour devenir l’opérateur d’une œuvre de régénération sociale».50 Il semblait impossible de dépasser l'objet sans se sentir porteur d’une connaissance fatale qui condamnait, avec évidence, les souches atteintes : «Cette insistance sur les nerfs et cette recherche des sources de l’énergie nerveuse allaient de pair avec un sentiment de perte d’enthousiasme, de lassitude, d’énervement d’esprit : dégradation générale de l’énergie apparemment confirmée par la théorie de l’entropie, dérivée de la deuxième loi de la thermodynamique. Mais ce n’était pas seulement l’énergie qui disparaissait. La santé et la force fuyaient aussi, à en juger par la piteuse performance de la France dans la course démographique. Entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale, des voix innombrables s’élevèrent pour mettre les Français en garde contre le danger de leur disparition pure et simple. Et tandis qu’ils se clairsemaient, les survivants pourrissaient de l’intérieur».51 On ne pouvait imaginer concept plus à même de traduire l’angoisse de la dépopulation. Au-delà du constat observable chez les pensionnaires de La Salpêtrière, par exemple, «le thème de la “dégénérescence” (avec, en particulier, le Traité des dégénérescences de Morel, 1857) précipite des fantasmes de provenances multiples; il donne une gravité scientifique à l’angoisse, un peu partout sensible, de la “décrépitude” (selon un mot que Baudelaire appliquait à l’art de son temps). Zola “expérimente” sur l’hérédité. À vrai dire, il ne se contentera pas d’observer les effets dans des situations qu’il aura créées, de certaines déterminations - de la “tare” héréditaire, en particulier. De toute la puissance imaginative de la fiction, il travaille l’appartenance de ses personnages à de lourdes filiations. Dans Le Docteur Pascal (1883), il s’évertuera à la refluidifier, à la traverser à un flux vital où l’on puisse échapper à la fatalité de la dégradation ou remonter son cours».52 Et, on l’a vu, Zola ne fut pas le seul écrivain envoûté par le thème de la dégénérescence. Pensons à Henry James : «L’allusion à la “dégénérescence” qui affecte le groupe suppose l’existence d’un état morbide fondamental et la transmission intégrale du capital héréditaire partagé entre les membres de la famille. James se fabrique ici une sorte de principe des vases communicants que l’on retrouvera à l’œuvre dans les échanges vampiriques réglant la communication… Vraisemblablement, cette loi exposée avec tout l’humour qui distingue le romancier n’est qu’une transformation des théories de la dégénérescence du docteur Moreau (de Tours) ou du docteur A. Morel, ou de leurs disciples, largement diffusées à l’époque…».53
Cet abondant usage littéraire, qui avait commencé déjà avec Poe et Baudelaire, s’étira jusqu’à la Grande Guerre. Le thème de la dégénérescence devenait quasi obsessif et certains médecins s’en plaignaient : «Depuis un quart de siècle, déplorait un médecin en 1876, tout ce qu’on entend dire c’est : “Nous sommes dégénérés! nous sommes en décadence!” Comme pour confirmer ces dires, les statisticiens assuraient que la population diminuait, que la taille moyenne des recrues baissait, que le nombre des réformés augmentait; la morale disparaissait, le crime fleurissait, le corps et l’esprit avaient tendance à la difformité, au crétinisme, à l’idiotie et à la folie… Certaines de ces affirmations étaient manifestement fausses, d’autres discutables. Les statistiques différaient, comme toujours. Mais tout ce que les adversaires de la thèse de la décadence parvenaient à démontrer, faute d’une réfutation pure et simple, c’était que la “prétendue dégénérescence physique” des Français était relativement négligeable auprès de celle des autres Européens».54 Il devint évident que laissée à sa propre définition, la dégénérescence apparaissait comme une réponse facile. Des vulgarisateurs aux intentions douteuses systématisaient encore plus la définition donnée par Morel; par exemple, «la définition savante du phénomène peut se trouver au Dictionnaire anthropologique de Bertillon et al : “Mouvement descendant que subit un individu ou une race après avoir évolué vers le progrès. Morel définissait la dégénérescence un retour vers le type primitif”».55 La dégénérescence, c’était avant tout une régression, et c’est peut-être là qu’elle dit ce que les termes déclin et décadence ne disent pas de manière suffisamment claire. Non seulement, l’espèce ou la civilisation décline ou s’effondre moralement, mais elle régresse, elle cherche à retourner à ses origines; infantiles pour les individus, barbares ou sauvages pour les collectivités. Pouvait-on déduire tout cela de la simple observation des hystériques que l’on trouvait dans les hôpitaux psychiatriques et les asiles? Que penser lorsque le docteur P. Briquet qui «maintenait que l’hystérie était une affection nerveuse et non physique, engendrée par le “mode de sensibilité” particulier des femmes, mais que les hommes aussi pouvaient en souffrir[?] L’hérédité jouait un rôle majeur dans la transmission du mal : alors que dans une population normal on comptait un cas d’hystérie pour vingt six habitants, dans les familles d’hystériques on en comptait un sur quatre. Il écarta l’idée d’un lien quelconque entre la maladie et la continence sexuelle et suggéra plutôt que c’étaient les mères hystériques qui la transmettaient à leurs filles».56 La chose allait devenir encore plus évidente aux lendemains du grand choc de 14-18 : «toutes les manifestations des névroses de guerre semblaient coïncider avec les traits de l’hystérie détectés par Charcot à la Salpêtrière dès la fin du XIXe siècle, puis systématisés par l’imaginaire conservateur dans une vision négative de l’outsider, ce dernier étant le plus souvent identifié au juif ou à l’homosexuel, incarnation idéal-typiques de la dégénérescence dans le monde moderne. Efféminés, nerveux, trouillards, lâches, psychiquement instables, faibles du point de vue physique comme de caractère, portés à l’intellectualisation plutôt qu’à l’action, les outsiders anticipaient les pathologies du soldat victime du shell-shock. Dès lors la guerre n’était pas la cause mais le simple révélateur d’une dégénérescence préexistante, et sa vertu était d’assainir la société en la libérant de ses déchets».57 Cet abus du terme fut peut-être l’une des conséquences de la diminution de son emploi après la Grande Guerre.
Au fur et à mesure que les études sur l’évolutionnisme darwinien et les expériences sur l’hérédité de Mandel étaient diffusées, les esprits hantés par la dégénérescence avaient réussi non pas à calmer les appréhensions de la dépopulation, mais à déplacer l’angoisse vers l’atavisme, les tares secrètes qui mineraient autant les individus que les races humaines. Un autre médecin français fut la source de ce déplacement, le docteur Valentin Magnan (1835-1916), à qui «reviendra le mérite d’affiner cette théorie. Pour lui, dans un premier temps, le dégénéré ne présentait que de légers troubles (agitation, méfiance, anxiété), puis survenaient les hallucinations, la mégalomanie, l’ambition désordonnée; et, enfin, dans la troisième phase seulement, sa raison succombait. Le Dr Magnan distinguait des inférieurs (les débiles), les dégénérés supérieurs, au nombre desquels il plaçait les “exubérantes imaginations”, les “rares talents avec un manque total de certaines aptitudes” et les pervers sexuels (Magnan avait été un des premiers aliénistes à mettre l’accent sur le rôle de l’hérédité dans les troubles de l’instinct génital). Dès lors, un spectre nouveau hantera les nuits bourgeoises : celui de l’individu en apparence sain d’esprit, mais que ronge une tare secrète».58 Magnan opérait ce délicat retour à la mentalité de garnison propre à la civilisation occidentale. Chacun devenait une forteresse assiégée par les bacilles, bactéries, virus et autres potentiels dangers de l’organisme humain que l’hygiène était censée tenir à distance, mais en plus, il devait se méfier d’une cinquième colonne à l’intérieur même de son propre organisme et qui lui avait été refilée par ses ancêtres. L’angoisse ne pouvait qu’ouvrir sur encore plus de problèmes hystériques, de délires psychotiques et de comportements obsessionnels. Comme on ne trouvait aucun moyen, aucun remède, aucune chirurgie ni thérapie pour venir à bout de ces atavismes, la fatalité confinait au désespoir beaucoup qui en étaient diagnostiqués. Le dernier théoricien du tournant du siècle dont le titre de le magnum opus était Dégénérescence, était un médecin allemand d’origine juive, Max Nordau (1849-1923), également l’un des promoteurs avérés du sionisme. Nordau «expliqua dans son célèbre ouvrage Degeneration (1892) que les vibrations constantes supportées lors des voyages en train étaient partiellement responsables de la fragilité nerveuse dangereuse pour l’ordre établi. À la même époque, J.-M. Charcot, le célèbre psychiatre français, affirmait que le train était un lieu propice à la crise de nerfs. À l’évidence, les progrès technologiques dans les transports étaient devenus un souci médical. Nordau, qui avait vulgarisé le terme de dégénérescence, pensait que des mouvements physiques trop rapides et incontrôlés, une attitude fébrile et agitée, indiquaient un système nerveux en mauvais état - signe de décadence».59 On en revenait tout simplement à ce qu’Hacländer soupçonnait déjà en 1850!
Nordau était un esprit original. Comme l’exigeait le positivisme de son temps, il fallait classer les types relevant de la dégénérescence. Celle-ci se constatant dans tous les milieux géographiques et sociaux, on ne pouvait plus affirmer qu’elle constituait une tare exclusive. «Les dégénérés peuvent se regrouper en idiots, névropathes tarés, criminels “ataviques”, plèbes des villes rachitiques, alcoolisés, hérédosyphilitiques, socialistes (généralement dégénérés) et artistes ou “dégénérés supérieurs” (notion que Max Nordau développera brillamment). La dégénérescence est omniprésente et cumulative : les “tares” s’additionnent dans les familles. Les aristocrates manquent de “sang neuf” et les prolétaires se dégradent par les abus sexuels, l’alcool et les pathologies liées au défaut d’hygiène».60 En divisant en dégénérés inférieurs et supérieurs les différents types d’atavisme, Nordau hiérarchisait socialement les troubles mentaux. C’est à lui plus qu’à Hitler qu’on doit l’association de dégénéré à certains types d’art. La critique, imitant en cela les écarts de Taine, suivit «l’avis de Max Nordau, auteur de Dégénérescence, ouvrage fort polémique paru en 1893 et traduit en une vingtaine de langues en l’espace de quelques années. Selon Nordau, il était devenu “un signe d’aristocratie… parmi les snobs” fortunés et cultivés de se rendre à Bayrouth pour assistée à des opéras qui constituaient l’“écho bêlant d’un passé révolu… et le dernier champignon sur le tas de fumier du romantisme [plutôt que] l’œuvre d’art de l’avenir”. Nordau considérait qu’en tant que dramaturge Wagner était “un peintre historique de tout premier rang” dont le génie consistait à imaginer et à recréer “des fêtes, des fastes, des triomphes et des drames allégoriques… [dont] les attraits picturaux ne pouvaient échapper même au plus vulgaire philistin”. Mais Wagner était également à ses yeux un compositeur “primitif” qui rabaissant la musique au niveau des “symboles phonétiques conventionnels”, avait recours au “récitatif informe des sauvages”, subordonnait “une musique instrumentale fortement différenciée au drame musical” et évitait “de mettre sur scène plus d’un chanteur à la fois et [de faire appel à] la polyphonie vocale”».61 Plus que certains individus en particulier, «Nordau considérait que les modernes en art et en littérature étaient littéralement des malades et il soutenait que leur manque de clarté, leur incapacité à défendre des valeurs morales et leur absence d’autodiscipline étaient dus à leur dégénérescence physique et organique. Les nazis illustrèrent bien évidemment leur hostilité au modernisme artistique par l’exposition sur “l’art dégénéré”, tandis que Hitler et Mussolini se flattaient de la limpidité supposée de leur rhétorique. Le fascisme dépouilla le concept de dégénérescence de ses fondements originels : l’observation clinique associée à un univers régi par des lois scientifiques. Mais cela était typique de ce type d’appropriations - la superstructure populaire et traditionnelle était absorbée, mais se trouvait à présent assise sur des bases raciales ou nationalistes».62 Le formel artistique devenait un indicateur incontestable du degré de dégénérescence d'une culture. En 1895, déjà sept éditions du livre Degeneration de Nordau avaient été publiés :
«Nordau, disciple du criminologue italien Lombroso, exécutait en deux forts volumes - près de mille pages au total - exactement toutes les écoles artistiques et littéraires de son temps. Charcot ayant dit : “Les nerveux se recherchent”, Nordau assimilait sans hésiter les groupes d’intellectuels à des bandes de criminels déséquilibrés qu’il fallait réduire avec l’aide du bras séculier : “Les mystiques, mais surtout les égotistes et les orduriers pseudo-réalistes, sont des ennemis de la société de la pire espèces. Celle-ci a le strict devoir de se défendre contre eux.” Naturalistes, préraphaélites, symbolistes; Ibsen, Nietzsche, Ruskin, Tolstoï, Wagner, Wilde, Zola, personne ne trouvait grâce devant Nordau, qui préfigure singulièrement un style de “critique” illustré plus tard par les tenants d’un certain idéal politique. Voici par exemple ce que Nordau écrit des artistes de son temps : “La manière singulière de certains peintres, impressionnistes, pointillistes ou mosaïstes, trembleurs ou papilloteurs, coloristes rugissants, teinturiers en gris ou en blafard, nous deviendra immédiatement compréhensible, si nous avons présentes à l’esprit les recherches de l’École de Charcot sur les troubles visuels des dégénérés et des hystériques. Au sujet de Ruskin : “Il met au service d’idées complètement délirantes le sauvage acharnement du fanatique dérangé d’esprit et le profond sentiment de ‘l’émotif de Morel’.” Des imitateurs de Zola : “Ce groupe est en dehors de la littérature. Il forme une partie de ce rebut des grandes villes qui, par horreur du travail et appât de lucre, cultive professionnellement l’immoralité et a choisi ce métier en pleine responsabilité. Ce n’est pas la psychiatrie, mais la justice criminelle, qui est compétente pour l’apprécier”. En bref, “nous nous trouvons actuellement au plus fort d’une grave épidémie intellectuelle, d’une sorte de peste noire de dégénérescence et d’hystérie, et il est naturel que l’on se demande de toutes parts avec angoisse : Que va-t-il arriver?”
À cette question, Nordau donnait lui-même une réponse en esquissant une anticipation à donner le frisson : “Chaque grande ville possède son club des suicidés. À côté de celui-ci existent des clubs pour assassinat réciproque par étranglement, pendaison ou arme blanche. À la place des cabarets actuels on trouve des maisons installées à l’usage des consommateurs d’éther, de chloral, de naphte et de haschich. Le nombre des personnes souffrant d’aberrations du goût et de l’odorat est devenu si considérable, que c’est un métier lucratif d’ouvrir pour elles des boutiques où elles puissent absorber, dans des vases riches, des ordures de toutes sortes, et respirer des parfums de pourriture et d’excréments. Il se forme nombre de nouvelles professions : celle des injecteurs de morphine et de cocaïne, celle des commissionnaires qui, postés au coin des rues, offrent leurs bras aux personnes atteintes de la peur des espaces, pour leur faire traverser les chaussées et les places; celle des hommes de compagnie chargés de tranquilliser, par de vigoureuses affirmations, au milieu d’un accès d’angoisse, des malades en proie à la folie du doute…” Munis d’un tel bréviaire, les victoriens étaient solidement armés pour la lutte. Beardsley et Wilde (mort en 1900) éliminés, l’art et la littérature redevenaient accessibles à tous les miasmes du continent avaient été balayés».63
On était alors en pleine Affaire Dreyfus; le temps où le terme dégénérescence n’était plus seulement associé à des lignages familiaux, mais à des communautés entières et en particulier les Juifs. «À l’époque de l’affaire, Nordau était fixé depuis près de vingt ans à Paris, où il avait publié plusieurs études sur l’état de la civilisation européenne, et où il s’était fait une réputation de penseur excentrique mais clairvoyant. Et pourtant, nous dit sa fille, “à Paris, il resta l’étranger de marque”; n’ayant jamais le sentiment d’appartenir véritablement à la société française, il demeura à l’écart de la vie sociale et ne se mêla pas davantage à la communauté juive à laquelle il ne se sentait attaché ni par des liens religieux ni par des liens ethniques. […] La grande réputation qu’il s’était acquise par ses travaux sur la dégénérescence et le déclin européens, lui valurent l’audience des Juifs disposés à refuser de s’assimiler aux nations européennes».64 Si Nordau gardait profil bas durant les grandes heures de l’Affaire, c’était sans doute parce que le monde dans lequel il vivait était tout simplement jugé déjà dégénéré. Contrairement aux bourgeois affolés pour leurs propriétés, Nordau regardait les élites de la société et en particulier leur culture. Ce que Peter Gay appelle la culture de la haine était déjà bien installée, autant dans les manifestations publiques que dans les courants artistiques et littéraires comme nous venons de le voir, mais aussi dans une vie déjantée de Montmartre des plaisirs et du crime, d’esprits emportés par leurs nerfs et leurs manifestations hystériques. La modernité, telle que située après la première moitié du XIXe siècle n’était plus qu’un univers décadent, d’individus tarés, menacés et menaçants pour tout un chacun. Cette vision rejoignait les victoriens en Grande-Bretagne, les catholiques à Vienne, en Bavière, en Hongrie…, les Junkers attachés aux basques de Bismarck, en Amérique même où apparaissaient les premiers théoriciens de la race. D’autres praticiens voyaient la dégénérescence tout autrement. Si Nordau avait subi l’influence du criminaliste Lombroso, Otto Gross, médecin psychiatre viennois était le fils d’un criminologue avec lequel il entretenait une lourde hypothèque œdipienne. Hans Gustav Adolf Gross suivait la tendance dominante marquée par les ouvrages de Morel et Nordau. Son fils, Otto, prit le contre-pied de la position paternelle : «Comme on s’en doute, Hans Gross entend combattre la prostitution, l’homosexualité, les “perversions” sexuelles et la pornographie, même lorsqu’elle se présente sous couvert de la littérature : il faut interdire les romans qui répandent l’infection morale. Le danger vient à ses yeux de la dégénérescence qui multiplie les exceptions à la normalité. Les hommes efféminés, les femmes virilisées, mais aussi les vagabonds, les révolutionnaires, les anarchistes et même les voleurs sont à ses yeux des dégénérés. En 1905, en conclusion du traité qu’Otto Gross attaquera dans son livre de 1909, Hans Gross propose de déporter ces dégénérés aux colonies, par exemple en Afrique du Sud-Ouest ou dans les îles des mers du Sud».65 Toxicomane, diagnostiqué de démence précoce par Jung, anarchiste utopiste, tout cela n’empêcha pas Otto Gross de décrocher une chaire de psychopathologie à la faculté de médecine de Graz en 1907. Malgré tout, le père Hans, ne cessait de mettre la police sur la piste de son fils afin de le tirer des milieux anarchistes. En réponse, Otto publia en 1909 son essai, Les infériorités psychopathologiques : «“Les dégénérés sont le sel de la terre!” Sur un point il donne raison aux “darwinistes” : il admet l’hypothèse de la variabilité du genre humain. Mais il refuse les jugements hâtifs concernant la valeur culturelle des types qui apparaissent comme “dégénérés”. Ceux-ci manifestent une forme d’adaptation à des conditions archaïques de vie sociale, incompatibles avec la vie moderne. Leur apparente inadaptation ne doit pas faire oublier qu’ils incarnent peut-être l’avenir de la culture. Ils sont, dit Gross dans la dernière phrase de son livre la “matière première” des évolutions futures. Gross prend ici position dans le grand débat sur la décadence qui préoccupe les intellectuels depuis Nietzsche et depuis le mouvement littéraire des “décadents”. Le génie est-il un dégénéré supérieur? La dégénérescence constitue-t-elle le ferment des civilisations les plus raffinées, voire la caractéristique de la modernité? Cette discussion marque, en ce début de siècle, la plupart des ouvrages de Kulturkritik (on songe par exemple à l’essai de Max Nordau intitulé Entartung, “Dégénérescence”), des traités de psychiatrie depuis Morel et Lonbroso, des fictions littéraires (les romans de Thomas Mann abordent presque tous ce sujet). Dans ce livre de 1909, Otto Gross se range à l’avis de Nietzsche qui écrivait dans Humain, trop humain : “Ennoblissement par dégénérescence : […] C’est des individus les plus indépendants, moins sûrs et moralement plus faibles que dépend, dans de pareilles communautés, le progrès intellectuel […] Les natures dégénérescentes sont de la plus haute importance partout où un progrès doit s’accomplir”».66 Le destin de Gross illustra parfaitement la trajectoire standard de la dégénérescence. Il ne se remit jamais ni de sa toxicomanie, ni de son conflit œdipien. Il mourut en état de curatelle en 1920, après avoir fréquenté les milieux dadaïstes, expressionnistes allemands, le groupe de Kafka et de Brod à Prague.
Freud n’a sans doute jamais accepté les hypothèses anarchistes de Gross. Pour lui, la dégénérescence restait rattachée aux atavismes d’une espèce. En ce qui concernaient les névroses et psychoses, l’approche se détachait de l’orthodoxie de l’époque, mais ce qu’il avança comme théorie était tout aussi angoissant. La cinquième colonne ne portait plus le nom de tare dégénérative, mais d’inconscient, et l’inconscient pouvait être tout aussi sournois tant il se manifestait de manières diverses et complexes : «Freud conclut en insistant surtout sur un point : ce qui apparaissait chez l’homme comme un refus de “se soumettre à un substitut paternel” et chez la femme sous la forme d’une dépression, fruit de la “certitude intérieure que la cure analytique ne servira de rien”, procédait de la même cause. “Quelque chose, écrit Freud, qui est commun aux deux sexes a été forcé […] à se mouler dans l’une et l’autre forme d’expression.” Ce “quelque chose” était l’essai compulsif pour dépasser les traumas de la petite enfance par l’activité. Chez les hommes, il prenait la forme d’une répudiation de la castration et d’efforts pour être masculin. Que la peur de la castration fût la cause de ces efforts, on en avait la preuve dans le fait que les hommes ne répugnaient pas la passivité en général, mais la passivité à l’égard d’autres hommes. Le même homme qui regimbe devant toute forme de soumission à un autre homme peut manifester une attitude masochiste - “un état qui équivaut à la servitude” - envers les femmes. Quant aux femmes, tout leur développement, la séparation d’avec la mère, le tournant vers le père, la réorientation de leur sexualité vers des objets masculins, visait à assurer que leur “masculinité”, leur préférence pour le rôle actif, succombe à un “processus capital de refoulement”. Le “complexe de virilité”, “l’“envie du pénis” et la “frigidité” - toutes ces “maladies” de la féminité - étaient autant de preuves des ratés fréquents de ce processus capital».67
Quoi qu’il en soit, après la Grande Guerre, le terme de dégénérescence commença à s’effacer. La fascination pour la psychanalyse remplaçait celle pour les tares psychopathologiques : «L’idée de dégénérescence cessa d’être tellement à la mode au vingtième siècle, mais elle avait encore des adeptes. Dupré et Delmas en fournirent une version corrigée sous le nom de “folie constitutionnelle”. La dementia præcox de Kraeplin était importée d’Allemagne : hallucinations et visions, ici, conduisaient progressivement mais inexorablement à la folie complète; la paranoïa remplaçait la manie de la persécution et devenait une sous-catégorie de la démence précoce. Lors de la Première Guerre mondiale, les psychiatres se trouvèrent dans une position délicate quand on leur demanda de préciser le rôle de la guerre dans la genèse des troubles mentaux manifestés par un vaste nombre de soldats; ils accordèrent généreusement que la guerre était un stimulant de la folie, même s’il y avait des causes héréditaires et des prédispositions».68 Le nazisme le récupéra avec bonne fortune. Il se donna l’impression que son existence consistait à entraver la dégénérescence des Allemands et clouer au pilori tout ce qui ne convenait pas à ses normes. En Italie aussi, pour les fascistes, la dégénérescence fut l’ennemi à combattre : «L’historien Alessandro Luzzio disait que les Anglais étaient une race d’ivrognes, de drogués et d’homosexuels, encouragés dans ce dernier vice par les “innombrables fourrés opportunément disposés dans Hyde Park” et… par la laideur des Anglaises. Il y avait en Angleterre, sept millions de célibataires, dont la frustration sexuelle ne pourrait être combattue que par un décret royal permettant la polygamie!».69 En Allemagne, Hitler se montra plus ignoble : «Le Führer parle aux instincts, dans ce registre criard qui faisait “honte” à d’aucuns. Les mots cinglent comme des coups de fouet, ridiculisant ses adversaires de l’intérieur comme bientôt le “paralytique de la Maison Blanche” ou “l’ivrogne de Premier ministre anglais”…».70 L’angoisse vitale de la dépopulation s'était transformée en véritable culture de la haine dont la dégénérescence ouvrait sur une profonde crise morale.
Car même la religion n’était pas en mesure de pondérer les diagnostics, voire les jugements qui sortaient de la nouvelle psychiatrie, de l’idée de dégénérescence et de contamination du sang humain : «ce relâchement, cette misère, cette universelle nausée qui déchirent les corps trop mous et étalent les excréments»71 C’était, avant Céline, la nausée du pamphlétaire Louis Veuillot, papolâtre extrémiste qui faisait toujours la guerre à une révolution qu’il n’avait pas connue : «C’était son principe de toujours : il faut en finir avec la Révolution; il faut que la France s’évade une bonne fois de cette anarchie parlementaire ou émeutière qui depuis 1789 est le régime dont elle meurt. Cette vérité, il l’avait criée plus haut que jamais parmi les horreurs de la guerre et de la Commune : “Cette génération - écrivait-il le 26 janvier 1871 - a l’excuse d’une sorte de perversité, c’est-à-dire d’imbécillité native : et in peccatis concepit me mater mea. Ce n’est pas la république de 1870 qui nous a tués, ce n’est pas non plus l’empire, ni même le régime précédent, quoiqu’ils n’y aient pas nui. Toutes ces formes et tous ces systèmes ne sont que des figures diverses du même ulcère, provenant du même sang vicié. Nous mourons de la Révolution, et tous plus ou moins nous avons voulu retenir ce mal dans nos veines. Si l’effroyable traitement que nous endurons l’y laisse, on peut se dispenser de clouer le cercueil; nous n’en soulèverons pas les planches; il ne nous reste qu’à pourrir. Ce qui reste à faire, le dernier remède possible, ce miracle à demander et que nous pouvons encore espérer, puisque nous pouvons encore l’implorer, c’est de rompre avec la Révolution”».72 Veuillot n’était pas un habitué du langage châtié, comme dans les salons de l’Ancien Régime. Sa démence rappelle celle de l’abbé Maury qui comparait ses deux burettes à des pistolets. Dans la lointaine province de Québec, on lisait pieusement les brûlots de Veuillot et les zouaves pleuraient sur l’auto-emprisonnement du pape au Vatican. Leur «ancien aumônier Moreau, qui s’y rendit en 1874, écrivait ne pas pouvoir “se débarrasser du poignant serrement de cœur qui (l’avait saisi) en y entrant”. À chaque pas, il était frappé par “un sujet de réflexions tristes, de larmes amères”. Le pape, écrivait-on dans Le Constitutionnel, était contraint de rester enfermé dans le Vatican pour échapper à la vue de pareils scandales : le théâtre, la littérature, les caricatures, les journaux, tout dans Rome respirait la dégénérescence. La nouvelle Italie, de prédire un correspondant du Journal des Trois-Rivières, allait bientôt se défaire pour avoir voulu abattre la papauté. L’Univers de Louis Veuillot était aussi abondamment cité: tantôt il rapportait des faits divers illustrant la déchéance morale, tantôt des réflexions sur l’avenir de l’Église, tantôt des apologies du pape. D’ailleurs ces perceptions colportées dans les journaux s’alimentaient des propos même de Pie IX, qui dénonçait ceux qui érigeaient “des monuments aux apostats” et honoraient “la mémoire des incrédules et des impies”. Lors du retour des volontaires d’Arthabaskaville, un étudiant en droit, au nom de ses concitoyens, leur souhaita la bienvenue en louant leur courage d’avoir affronté “des périls de toute espèce, au milieu d’une race d’hommes corrompus, dégradés, abrutis, qui sont en quelques sortes les reptiles de l’humanité”…».73 Les défenseurs de l’Église eux-mêmes se laissaient emporter par les spasmes de haine et vomissaient la modernité au point d'éclabousser la robe blanche immaculée du Saint-Père.
Si les dégénérés n’étaient pas le sel de la terre, c’est qu’ils préféraient pratiquer les cultes sataniques et appartenir à des mondes occultes. Ce n’était plus l’avatar de la machine symbolisé par le monstre de Frankenstein de Mary Schelley, mais le comte Dracula, noble de la lointaine Transylvanie et vampire, atavisme du sang corrompu par le Mal. Dracula souffre du même mal que des Esseintes ou Dorian Gray : «Dracula, pourrions-nous écrire, est un dégénéré moral, un disciple du plaisir charnel sans responsabilité. Il offre un regard sur un autre monde, le monde oriental - un potentat désœuvré choisissant son harem».74 Dracula, c’était un autre démonstration empirique et romanesque de la dégénérescence. Contrairement aux réalistes comme les frères Goncourt, Zola ou Mirbeau, l’auteur irlandais, plus qu’un tantinet raciste, entendait illustrer les dernières avancées dans le domaine de l’évolutionnisme : «En 1889, l’année avant que Stoker ne commençât à travailler sur Dracula, un ouvrage scientifique proposa un autre maillon unissant Darwin et le (futur) comte. La thèse affirmait que l’évolution n’était pas forcément progressive. Une métamorphose régressive pouvait se produire et mener au développement de formes parasitaires. La théorie s’appliquait aux animaux supérieurs : “Tout nouvel ensemble de conditions qui permet à un animal d’obtenir sans effort sa nourriture et sa sécurité semble mener, en règle générale, à la dégénérescence - de même qu’un homme actif, sain, décline parfois quand il entre soudain en possession d’une fortune, ou de même que Rome déclina à partir du moment où elle posséda les richesses de l’ancien monde. […] Il est possible que nous (= les humains) rejetions l’admirable cadeau de la raison (que chacun possède à la naissance) et que nous déclinions jusqu’à mener une heureuse vie de plaisirs matériels qu’accompagnent ignorance et superstition” [E. R. Lankester : Degeneration : A Chapter in Darwinism]».75 Une fois de plus, nous constatons les vases communicants que représentent les termes décadence et dégénérescence. Sans doute faudrait-il considérer le roman de Bram Stocker (et la pièce de théâtre, et toutes les adaptations cinématographiques qui en furent tirées) relevant de cet art dégénéré dont Max Nordau voulait circonscrire les limites. Car avant d’être hitlérien, l’art dégénéré est le produit du médecin Nordau.
Ne cherchons donc pas de définition objective de l’art dégénéré. Pour Nordau, apparaissait dégénéré toutes formes d’expression qui ne correspondaient pas aux règles de la reproduction réaliste issue de la Renaissance. Il en sera de même pour les nazis. À aucun moment il n’était possible d’oser imaginer que la reproduction du réel puisse appartenir également à la dégénérescence. Il suffisait pourtant de comparer les toiles de Botticelli et de Bouguereau pour s’en rendre compte. Si la ligne était d’une précision nette et incomparable, l’ensemble du tableau était froid, pétrifié, vidé de toute vie. À ce compte, on pourrait dire que la première exposition d’art dégénéré fut le célèbre Salon des refusés de 1863, tenu par les Impressionnistes en marge du Salon officiel. Tenue dans douze salles annexes du Palais de l’industrie, environ 1 200 œuvres de Pissarro, Manet, Fantin-Latour, Whistler, Jongkind et autres étaient exposées. Beaucoup de ces œuvres respectaient encore les canons de l’esthétique réaliste et le célèbre Déjeuner sur l’herbe de Manet n’était pas encore l’Impression soleil levant de Monet. Pourtant, les partisans de l’académisme trouvaient dans les tableaux symbolistes ou réalistes à la Courbet quelque chose qui annonçait des ruptures plus profondes. En Allemagne, Nietzsche le pressentait dans La Volonté de puissance : «Le nombre des déments, des criminels et des “naturalistes” augmente : c’est le signe d’une culture grandissante qui s’avance à pas de géant, c’est-à-dire que le rebut, les déchets, les excréments prennent de l’importance, le courant descendant tient le pas».76 Nietzsche mourut un an avant le peintre nabot Henri de Toulouse-Lautrec qui, sans doute plus que tout autre, tant par son style et son originalité que par le traitement de ses personnages, représentait ce qu’on pouvait qualifier d’art dégénéré. Roger-Marx, son critique dont on ne sait s’il aime ou pas Lautrec, rappelle qu’il est «issu de cousins germains, débile produit de la consanguinité, [il excella] à tirer du féerique et de l’exquis des spectacles plus abjects».77 À sa façon, Toulouse-Lautrec est une sorte de Proust des bas-fonds : «Le Beau, Lautrec allait le chercher dans la rue et jusque dans le ruisseau, dans ce qu’on surprend à chaque pas, loin des plâtres de la décadence romaine amollis par les surmoulages, loin des trucs transmis par des maîtres pour qui le joli, le fini, étaient en art les grands critériums».78 Pour Lautrec, la décadence se trouvait bien dans ces thèmes de la Rome avilie, ramollie des thèmes académiques primés dans les concours primant les choix pour les grandes expositions. Comme les peintres franco-bourguignons du XVe siècle, Lautrec cherchait à transcender la laideur pour en saisir toute la vitalité, voire la beauté. «S’il ne s’est pas complu, comme Marcel Proust, à scruter chez les gens du monde les vices et les passions cachés, c’est que, semblable en cela à beaucoup de grands artistes - peintres ou poètes - il courait chercher sa délectation là où l’être humain s’exhibe, affranchi de toute contrainte. Beaucoup plus réceptif au caractère qu’à ce qu’on nomme la beauté, à l’exceptionnel qu’au normal, aux déformations des corps et des visages qu’à leur grâce, bien que ses sentiments fussent à l’opposé de la vulgarité et de la bassesse, il établira ses quartiers là où le plaisir tient lieu d’amour, où rien ne se donne, où tout s’achète, où tout est impitoyablement rabaissé, tourné en dérision : la maison hospitalière ou le “caf’conc’”».79 Mais, semblable à Proust, il peignait avant tout son monde. Non pas celui des snobs et d’un ordre agonisant cédant à la vulgarité bourgeoise, mais «aux ébats de la Goulue (ainsi nommée pour son appétit), assistée de son cavalier servant, le Désossé, frère d’un notaire, qui ne demandait aucun cachet, ne dansant que pour le plaisir».80 Après tout, le voyeurisme visuel de Lautrec valait bien le voyeurisme auditif de Proust. Que ce soit dans les maisons vertes qui l’abritent, lieu de prostitution où opèrent les lesbiennes ou la copulation de Jupien et de Charlus, «c’est ainsi que s’opère dans l’œuvre un mélange qui n’avait jamais été aussi capiteux […], de raffinement suprême et de vulgarité, de réalisme et d’irréel, qui recrée autant qu’il détruit, exalte autant qu’il humilie. Miracle que pareille hauteur unie, comme chez tout homme, aux bassesses! […] Élisa la Viennoise ou la Goulue avaient bien un port d’Impératrice».81 On comprend que pour les fins esprits, il y avait là deux manières bien distinctes d’exprimer la décadence, mais elles touchaient aussi bien l’anormalité des artistes (le handicap physique et moral de Lautrec, l’homosexualité de Proust) que le monde dans lequel ils évoluaient.
Mais Proust n’était pas la plume la plus représentative de cette dégénérescence dans le monde littéraire. Zola, lui, était un Lautrec littéraire avec les obscénités mêlées de tendresses répandues dans sa série romanesque des Rougon-Macquart. Le monde de Mirbeau était tout aussi sordide. Le thème littéraire de la décadence était pour lors la dégénérescence : «Notre littérature est irréparablement atteinte dans son organisme. Comme les corps politique, urbain et humain, le corps du langage est travaillé par l’hybridation, la désintégration et la pollution. Nous sommes dans l’impossibilité de former une image pure et de pénétrer la langue de manière vigoureuse. Cela explique notre complaisance pour les descriptions organiques et les métaphores stercoraires, notre insistance sur le vocabulaire anal et sexuel. Notre littérature, “affaiblie par l’âge des idées, épuisée par les excès de la syntaxe, sensible seulement aux curiosités qui enfièvrent les malades” (J.-K. Huysmanns), est résolument orientée dans le sens d’une clinique. Finalement, à la décadence du langage correspond la décadence de l’organisme humain. C’est pourquoi notre siècle finissant, obsédé par le corps et ses fonctions, en vient à transposer dans l’écriture certaines de ses hantises physiologiques. Écrire devient un acte de scatologue, un exercice d’expectoration, une fonction excrétoire. Les divagations de notre plume psychosomatique ne sont pas simplement des prétextes à décrire l’accablement dans lequel nous nous trouvons. Elles sont surtout l’occasion de dire la ruine du discours, l’impossibilité d’écrire dans l’intégrité et la cohésion. Nous sommes les auteurs du grand attentat contre la poésie, les porteurs de la syphilis littéraire, les virtuoses de la désintégration du langage».82 Le sado-masochisme était la perversion la plus attrayante. Si les Rougon-Macquart sont frappés par les tares comme l’alcoolisme ou la syphilis, si l’homosexualité de Wilde ou de Gide se dissimulent dans les détails plus que dans le thème principal de leurs œuvres, que dire de Thomas Mann? Avec l'une de ses premières nouvelles, «Le petit Monsieur Friedmann [qui] ouvre un recueil paru [en 1897]. C’est le récit réaliste où l’intérêt réside surtout dans la peinture des caractères et du conflit qui oppose les protagonistes. Une femme au tempérament félin suscite chez un jeune bourgeois difforme un amour sans espoir, après quoi elle le pousse au suicide par l’humiliation qu’elle lui inflige en réponse à sa déclaration. Derrière le drame, où ne sont impliqués que ces seuls personnages, se profile la vie de toute une société. […] Le héros du Chemin du Cimetière (1901), un être disgracié et déficient, s’en prend à la “Vie” incarnée dans un cycliste plein d’allant…».83 Mais le réalisme n’était pas la seule forme artistique ou littéraire à exprimer les thèmes de la dégénérescence, et nous trouverions davantage à nous mettre sous la dent avec le symbolisme qui cheminait parallèlement aux œuvres de Zola et de Mann.
Le cas Huysmans a été mentionné plus haut. On a vu dans un chapitre précédent que le symbolisme s’inspirait grandement non tant des thèmes que de l’atmosphère des contes de l’Américain Edgar Poe. Lautréamont, Mallarmé et Valéry sont tous des émules de Poe. «Le Poe de Barbey [d’Aurevilly] est celui que revendiquèrent les symbolistes et bientôt les décadents, celui de la vieille Europe. Au début des années 1880, Joris-Karl Huysmans, revenu du naturalisme, se tourna de ce côté et, avec À Rebours, fit franchement une plongée, qu’il voulait expérimentale, dans la décadence. Ce terme que Baudelaire récusait, il le revendique, et la référence à Poe devient vite évidente. Le protagoniste, des Esseintes, esthète exsangue, dernier rejeton d’une “ancienne maison” épuisée dans les “unions consanguines”, c’est Roderick Usher dans une villa isolée des environs de Paris. Quand, triant sa bibliothèque, il s’arrête sur “ce profond et étrange Edgar Poe” au cycle “incisif”, à l’analyse “pénétrante et féline”, cela nous vaut deux pages fines et vigoureuses. Il retient de sa lecture une psychologie des états morbides, l’affaissement progressif de la volonté - et s’abandonne finalement à l’expérience de narrateurs, à leur impuissance, à leur naufrage. La ligne de faille écrivain/narrateur se creuse alors : Huysmans ne permet pas à son personnage de croire que Poe ait dominé ses fantasmes. Les contes ont beau être une “clinique cérébrale” où exerce un “chirurgien spirituel” (c’est-à-dire un chirurgien de l’esprit), maintenant que la “névrose” de Des Esseintes s’était exaspérée, écrit Huysmans, “il y avait des jours où ces lectures le brisaient, des jours où il restait, les mains tremblantes, l’oreille au guet, se sentant, ainsi que le désolant Usher, envahi par une transe irraisonnée, par une frayeur sourde”».84 De même, un certain courant important de la poésie québécoise se revendiqua d’une atmosphère semblable, comme chez Alfred DesRochers : «Ce qui est dénigré dans le célèbre “Je suis un fils déchu”, c’est le poète lui-même et son époque. Le “maladif instinct de l’aventure”, le désir de conquérir et d’asservir la nature, nul doute que Des Rochers les tient de ses ancêtres. Mais vivant dans une ville, au début d’une crise économique, que peut le poète : “Par nos ans sans vigueur, je suis comme le hêtre/Dont la sève a tari sans qu’il soit dépouillé,/Et c’est de désirs morts que je suis enfeuillé,/Quand je rêve d’aller comme allait mon ancêtre.” DesRochers ne se considère pas un artiste, mais “un artisan, à qui mieux eut valu de rester paysan”; il songe, “en voyant ces êtres surhumains,/Qu’à d’utiles labeurs ne servent pas [ses] mains” d’intellectuel, pleines de “callosités mortes”. Dans le poème dédicace d’À l’ombre de l’Orford, il s’excuse de ses vers maladroits, au rythme si lourd, où subsiste “si peu de la force ancestrale”; son seul désir en mourant serait de “laisser quelques biens” et surtout “l’honneur de garder vaillante [la] lignée”. Trop faible pour “ouvrir un sol nouveau” comme paysan, trop chétif pour mener une vie aventureuse et dure comme coureur de bois ou bûcheron, le fils déchu est devenu poète, un parnassien, un miniaturiste qui concentre son attention sur le travail de la forme et des détails…».85 Dans une autre veine, exploitée surtout par le cinéma, l’ensemble des premiers grands chefs-d’œuvre du muet présentait des thèmes qui convergeaient avec ceux des arts plastiques et de la littérature. Les films de von Stroheim, par exemple, «(Folies de Femmes, 1921, les Rapaces, 1923, la Symphonie nuptiale, 1927, Queen Kelly, 1928, etc.), films d’un homme qui pense “cinéma”, […] parce que sa minutieuse cruauté mettant en évidence les déchets humains, les infirmes arrogants, les couples qui s’entre-déchirent jusqu’à la mort, les hommes et les femmes qui se traînent dans le cloaque pour ramasser une pièce d’or, les abcès, les ongles sales, l’odeur d’égout et de sang et tous les détails particulièrement honteux de notre vie, atteint les limites du possible».86 Tout cela, très différent du traitement des films surréalistes : «L’âge d’or de Buñuel n’est qu’une longue protestation contre la société pourrissante des curés, des hauts fonctionnaires, des familles, des policiers. Heurtée, terrifiée par le scandale que constitue de lui-même l’amour, cette société tente par tous les moyens de séparer les amants, de les enchaîner loin l’un de l’autre, de les bâillonner, de les torturer. L’attaque est claire, et le public français ne s’y est pas trompé, qui a dépêché la “Ligue des Patriotes” et la “Ligue anti-juive” pour boycotter le film et qui protesta contre “l’immoralité de ce spectacle bolcheviste”».87
En France, on penserait surtout à Céline et à son univers glauque. Ce médecin ayant pratiqué sur le front et dans les milieux pauvres saisit toute la portée des caractères dégénératifs des malheureux laissés à eux-mêmes, dans une immense pauvreté, tentés par toutes les opportunités vicieuses qui s’offrent à eux, ne serait-ce que pour se venger du destin injuste qui les accable : «La sociologie de Céline est aussi une “socio-somatique”. Se souvenant sans doute de son métier d’origine, le romancier est attentif à toutes les manifestations corporelles. Il sait combien la condition ou le statut se disent dans la constitution physique ou dans l’activité physiologique. Il sait qu’il est une nécessité du corps qui ne trompe pas et trahit conditions de vie et appartenances (“Faut apprendre à reconnaître aux cabinets, l’odeur de chacun des voisins du palier, c’est commode. C’est difficile de se faire des illusions dans un garni…”, Voyage [au bout de la nuit]. Pour lui, toute misère humaine vient aboutir au corps et raconter les destinées : corps malade du jeune Bébert ou corps violemment sexué de la femme en hémorragie (tous deux dans Voyage), corps scatologique du jeune Ferdinand qui a “la crotte au cul” (Mort à Crédit), corps obscène de la putain Violette qui s’exhibe en dansant. Mais c’est au corps aussi que prend source le bonheur. L’un des motifs euphoriques du texte célinien - car il en est - est sans doute celui de la jeune femme au corps sensuel, aux formes pleines, à la chair élastique et sur laquelle le regard s’attarde dans une jouissance qui rachète bien des choses. En bien comme en mal, le corps célinien en dit plus que l’âme ou que l’esprit».88 Pol Vandromme, grand admirateur de Céline, comprend bien que derrière le réalisme des portraits tracés par le romancier, c’est toute la dégradation du monde qui est dénoncée : «L’œuvre de Céline enterre le cadavre d’une civilisation. Ce qu’elle nous annonce avec brutalité, dans un déferlement de mots qui chavirent, c’est que ce cadavre-là n’était pas un cadavre propre».89 En Amérique aussi il y a ce réalisme, de La Jungle de Upton Sinclair aux Raisins de la colère de Steinbeck, mais la dégénérescence s’impose surtout dans un héritier en droite ligne de l’atmosphère de Poe poursuivie jusqu’à la folie consommée : l’œuvre de H. P. Lovecraft. Lovecraft ne partageait en commun avec Céline que le racisme exacerbé. Plutôt que le réalisme, Lovecraft s’oriente vers le fantastique, entre l’horreur qui se dégage de la dégénérescence et l’emprise qu’elle finit par prendre sur la raison, comme «dans La Peur qui rôde, [où] le sol se recouvre d’une végétation fétide et corrompue, d’une mousse vénéneuse figurant une espèce d’horrible suppuration de la terre, tandis que les arbres, infestés par les sucs indicibles qu’ils puisent dans cette pourriture, prennent des formes grotesques ou démentes. La décrépitude, la corruption s’installent partout où le surnaturel a fait irruption. Le fantastique lovecraftien est manifestement décadent : l’insolite ne tombe pas de l’espace pour effrayer ou pour confondre, mais pour corrompre. C’est une espèce de gangrène qui ronge, mine et finalement pourrit tout entier le monde familier».90 L’auteur, dont la vie elle-même prêtait à l’angoisse paranoïaque, était un psychopathe sexuel inabouti, un être dont les fantasmes rejoignaient ceux de l’Enfer de Bosch : «Les bêtes démoniaques de La Peur qui rôde ont une origine très voisine. Ici encore nous sommes déroutés par l’inconcevable : ce flot grouillant et nauséeux de créatures difformes et diaboliquement malfaisantes qui s’accouplent et s’entredévorent dans les caves et les couloirs souterrains de la vieille demeure des Martense a sans doute de quoi surprendre. Mais l’horreur naît surtout du regard encore humain de ces gorilles blanchâtres à crocs jaunes qui figurent l’effrayant résultat d’unions consanguines répétées et le stade ultime de dégénérescence d’une famille jadis florissante. Le pullulement maléfique de ces monstres illustre de façon particulièrement adéquate l’une des obsessions majeures de Lovecraft : la sexualité porte en elle un germe fatal de corruption et de profanation de la race. Les nombreux dégénérés qui peuplent la région reculée des Catskills où se déroule le drame sont là, eux aussi, pour en témoigner».91 C’est ce qui apparaissait de plus extraordinaire, que cette face hideuse que décrivait Lovecraft n'était que la partie fantaisiste, symbolique de cette autre face des tares que l’on trouvait dans les grandes familles aristocratiques ou bourgeoises en Europe : chez Zola, chez James, chez Mann. Il y a un fond secret de Lovecraft dans la déchéance des Buddenbrock!
La face hideuse décrite par Lovecraft de la dégénérescence nous conduit, chronologiquement, à la guerre livrée par l’académisme nazi à l’art dégénéré à partir des années 1930. L’Italie fasciste n’avait pas eu à entreprendre une telle campagne culturelle puisque la modernité formulée par le Futurisme s’enlignait sur les mots d’ordre fascistes. Au-delà d'une question de dégénérescence, la campagne contre l’art dégénéré s’inscrivait dans le vaste programme d’hygiène raciale que pilotait le parti nazi et qui serait celui du IIIe Reich. C’est dans ce contexte éminemment culturel que le national-socialisme ramena en avant-plan le thème de la dégénérescence : «Le terme “dégénéré” était déjà communément utilisé dans les discours et les essais des théoriciens du parti national-socialiste, et parfaitement assimilé dans le langage que les membres des diverses organisations culturelles du parti utilisaient pour désigner l’art moderne. Après 1933, la Ligue de combat pour la culture allemande organisa, localement, à la fois des expositions présentant des œuvres d’art dites “dégénérées”, appelées “chambres d’horreur”, et des expositions dites d’Art allemand, thématiques et itinérantes. Mais le principe de la confrontation “Art dégénéré”-“Art allemand” fut utilisé véritablement pour la première fois, en 1937, à Munich, par le pouvoir, pour institutionnaliser et officialiser la condamnation de l’art moderne».92 Cette opération mesquine, ayant pour but de démontrer que les œuvres d’art moderne illustraient la dégénérescence de la civilisation occidentale, provenait d'un avilissement aussi bien par les Juifs que par la démocratie libérale, reprenant étrangement la démonstration du juif Nordau, un demi-siècle plus tôt. Au départ, il s’agissait de faire rire : «Le passage de l’intitulé des expositions, “chambres d’horreur” - manifestations locales et ponctuelles - à celui de “dégénéré” - manifestation officielle du pouvoir - renvoie au passage de la simple constatation d’une “anormalité” par l’énoncé du mot “horreur”, à celle d’un état de déliquescence et, par suite, de mort, évoqué par le mot “dégénéré”».93 Rien n’était entrepris par le régime, au niveau culturel, qui ait eu une légèreté narquoise. Il fallait qu’en tant qu’œuvre de propagande, l’exposition de 1937 sur l’art dégénéré ait son message clair : «Élevant le principe de supériorité raciale au rang de facteur fondamental dans l’évolution, la vie ou la mort des peuples, ces théories n’ont pu connaître une influence que, notamment, grâce à la conception organiciste du corps social. L’assimilation du fonctionnement d’un système social à celui d’un organisme humain mena les théoriciens organicistes les plus radicaux à considérer que toute atteinte à l’unité organique implique la désagrégation du corps social».94 L’art dégénéré n’était pas seulement un constat du degré de dégénérescence du monde occidental, il était aussi dénoncé en tant que facteur de corruption de l’esprit allemand. Plus que de simples critiques ou analyses confiées à des professeurs d’esthétiques que le commun des mortels ne comprendrait pas, l’exposition était une stratégie de guerre déployée contre ce qui représentait le plus la modernité : «D’une part, à un niveau individuel, elles constituent la matière première du discours officiel qui définit une grande partie des œuvres “dégénérées” comme le fruit de la maladie ou de la vieillesse. “Vous voyez les avortons de la folie (…) et la dégénérescence (…)”. Les œuvres de Lovis Corinth que les directeurs de musées “désapprouvaient, tant qu’il était sain (…), devenaient intéressantes pour eux dès que cet artiste ne produisait plus que des barbouillages maladifs et incompréhensibles, après son deuxième infarctus. De même, j’ai intégré dans ce spectacle des œuvres qu’un bon nombre d’artistes ont créées pendant leur vieillesse à un moment de dégradation intellectuelle ou atteints de maladie mentales”. “(…) il existe réellement des hommes qui ne voient les êtres de notre peuple qu’en crétins dépravés (…) ou comme ils disent : vivent les pelouses bleues, le ciel en vert, les nuages en jaune-soufre etc… (…) je voudrais interdire, au nom du peuple, ces malheureux pitoyables qui souffrent visiblement des troubles de la vue (…) il faudrait essaminer si leurs troubles visuels ont été provoqués de façon mécanique ou par hérédité (…) dans ce deuxième cas (…) le Ministère de l’Intérieur du Reich s’occupera d’empêcher la transmission de ces troubles cruels” [Hitler]».95
Les courants artistiques allemands réagissaient contre la guerre et la misère humaine qui affligeait l’Allemagne depuis 1919. Tour à tour, la Nouvelle Objectivité et l’expressionnisme semblaient mieux illustrer que la littérature la déchéance nationale. Ce n’était pas qu’une affaire d’appréciation de styles ou de théories esthétiques, il s’agissait carrément, d’une déficience liée à la santé du peuple : «au niveau collectif, elles servent à définir l’état de santé de la culture “fondement éthique de chaque peuple” et celui de l’art que H. S. Chamberlain assimile à “un système sanguin qu’entretient la vie intellectuelle supérieure”. Ainsi, le “corps pourri” de la République de Weimar, en état de “décomposition intérieure” secrète un art, une culture qui “empoisonne” le corps collectif allemand. Un corps étranger, putride, greffé sur le Volkskörper germanique : telle est l’image censée représenter la République de Weimar, le parlementarisme et la démocratie, qui, selon Hitler, sont les fruits de “l’infection marxiste” et de la “volonté destructrice des Juifs”. La communauté juive, dispersée à travers le monde, apparaît comme la négation même du corps cohérent, homogène. Aussi, l’emploi des termes “décomposition”, “pourri”, évoque, insidieusement, l’image d’un élément liquide, malsain, glauque, qui s’infiltre dans le système sanguin du corps allemand. Si selon Schultze-Naumburg “le combat pour la vision du monde (Weltanschauung) est livré, pour la plus grande partie, dans le domaine de l’art”, l’art moderne, par conséquent, témoignerait de l’empoisonnement intérieur, de la déliquescence de l’organisme germanique».96 À une époque où les maladies contagieuses et les mises en garde hygiénistes pleuvaient, le langage utilisé par la propagande nazie accroissait l’angoisse des classes moyennes allemandes tout en visant artistes, romanciers, dramaturges, poètes et musiciens à se méfier des originalités que le régime pouvait comme métaphore associer à des maladies. Il ne s’agissait plus seulement de formules délirantes pondues par les experts du régime, mais bien d’une déclaration de guerre à la liberté d’expression : «En juillet 1937, eut lieu, à Munich, une double exposition. L’inauguration de la “Grande Exposition de l’Art Allemand”, le 18 juillet, est, avec le cortège “2000 ans de culture allemande”, un des moments-clef des trois journées de festivités consacrées à la glorification d’une culture et d’un art “d’essence germanique”. L’exposition de l’“Art dégénéré”, dont l’inauguration, le 19 juillet, se déroule en dehors de ces journées, devait mettre en scène l’antithèse de cet art dit “germanique”, un art “dégénéré”, en l’occurrence, l’expressionnisme, le dadaïsme, l’abstraction, tous les grands courants artistiques modernes internationaux».97
Comme au temps du Salon des Refusés, l’exposition sur l’art dégénéré se tint en même temps qu’une exposition sur les œuvres que le régime considérait comme siennes :
«À Munich, que l’on considérait maintenant comme le foyer du renouveau artistique, Hitler inaugura, le 18 juillet, une vaste Maison de l’art allemand - exemplaire parfait du style monumental nazi; en même temps fut solennellement ouverte une exposition de mauvaises œuvres académiques modernes et de peintures de propagande. Au dernier moment Hitler en personne en avait fait jeter dehors quatre-vingts œuvres. “Désormais, dit-il à ses invités, nous procéderons au nettoyage permanent des derniers éléments subversifs de notre culture”. Presque au même moment, un médiocre artiste raciste que protégeait Darré, du nom de Wolfgang Willrich fit paraître un livre plaisamment intitulé Nettoyage du Temple de l’Art. Le lendemain, une grande exposition de l’“Art dégénéré” s’ouvrit à l’Institut d’archéologie de Munich.
Cette exposition de l’“Art dégénéré” eut plus d’un million de visiteurs en six semaines… Elle avait été rapidement organisée par Ziegler [président de la section des beaux-arts de la Kulturkammer] en vertu d’un décret hitlérien du 30 juin, qui permettait de “choisir des peintures et des sculptures d’art décadent, datées depuis 1910, appartenant au Reich, aux “Länder” ou aux municipalités de l’Allemagne. Parmi les 730 œuvres que prit Ziegler, il y en avait à peu près 25 de Kirchner, autant de Nolde et de Schmitt-Rottluff, dix à douze de Müller, et autant de Beckmann, de Rohlfs et de Kokoschka; des œuvres de Marc (sa Tour des Chevaux bleus), de Barlach, de Chagall et virtuellement de chacun des autres artistes du XXe siècle… à partir de Paula Modersohn-Becker. Les tableaux étaient exposés de la façon qui pouvait leur être la plus défavorable, avec des slogans sur des bannières rouges, des commentaires moqueurs griffonnés sur les murs, et toujours le rappel des prix payés sur les fonds publics, de préférence ceux de la période d’inflation, où les chiffres atteignaient normalement des millions et des millions.
Après quoi il fut procédé, avec moins de hâte, à une nouvelle épuration des musées dans tout le pays, cependant que l’exposition de l’“Art dégénéré” faisait la tournée d’autres villes allemandes. Dirigées par Ziegler, les opérations aboutirent à la saisie d’environ 5 000 peintures et sculptures (de toutes nationalités) et de 12 000 œuvres graphiques. Une loi du mois de mai 1938, contre l’“Art dégénéré”, ne fut pas annulé - on ne sait pas trop pourquoi - après 1945, de sorte que les saisies et les transferts de propriété qui suivirent demeurent valides. Quelques-uns des meilleurs tableaux - dont trois Van Gogh de la National-Galerie, les Cavaliers près de la mer de Gauguin et un des Cézanne du Folkwang Museum - entrèrent dans la collection privée de Gœring où furent vendus à son bénéfice personnel. Cent vingt-cinq tableaux furent vendus aux enchères, contre espèces, à la galerie Fischer, de Lucerne, le 30 juin 1939, où les musées suisses, hollandais et belges se portèrent acheteurs. D’autres tableaux disparurent plus ou moins mystérieusement dans des collections privées. Les quelque 1 000 peintures et sculptures et près de 4 000 œuvres graphiques qui n’avaient pas été vendues ou volées en 1939 furent brûlées au quartier général des sapeurs pompiers de Berlin».98
Comme le rappelle B. Hinz : «L’opération était exprimée par le terme générique “d’art dégénéré” et visait à éliminer les éléments dont la présence pour des raisons diverses faisait obstacle à la proclamation d’une nouvelle communauté culturelle nationale et à sa culture collective. Elle atteint son point d’orgue - également son point final - en 1937, après 4 ans de prélude. On a mis fin à cette vague par une censure du goût et des sens, assortie de sanctions massives, censure qui s’est laissé dominer par des images… quelconques, voire contradictoires. On qualifia alors de “dégénéré” tout ce qui était supposé être bolchevique, capitaliste, juif, pacifiste, internationaliste mais également indigne d’existence - physique ou psychique - bref tout ce qui avait une nature étrangère à l’art, considérée comme esthétiquement incompatible avec les “canons” de l’art».99 On en restait, toutefois, à des jugements politiques et moraux d’œuvres qui, évidemment, n’avaient rien en soi de politique.
Et, sans doute, le public allemand qui visiterait la galerie de Munich s’en apercevrait. Aussi, fallut-il donc insister sur la mise en scène des œuvres exposées : «Les tableaux sont répartis sur neuf salles, deux au rez-de-chaussée, sept au premier étage. Mal accrochés, non encadrés pour beaucoup, ils sont censés montrer que la vision des peintres modernes est assimilable à celle des crétins, des fous, des nègres, qu’ils salissent la femme allemande en glorifiant la prostitution et que le monde n’est pour eux qu’un bordel».100 Il est probable, en effet, qu’il y eut plus de gens intrigués par cette exposition que par l’art pompier qui plaisait au Führer. Le IIIe Reich réglait ses comptes avec le régime précédent dont il avait hérité la plupart de ses œuvres qui furent parfois rachetés par des hauts mandataires du régime : «Parmi les toiles exposées figurent 25 œuvres de Kirchner, autant de Nolde et de Schmidt-Rottluff, 10 de Muller et autant de Beckmann et Kokoschka, ainsi que des toiles de Chagall, de Franz Meer, Kandinsky, Klee, Grosz, Kix, Perchstein, Hofer. Inaugurée par Hitler et Gœbbels, l’exposition est accompagnée d’un catalogue illustré, expliquant dans un chapitre introductif les objectifs d’une telle manifestation et présentant l’ensemble des œuvres regroupées sous différents thèmes, tels que “Manifestations de l’art raciste juridique”, “Invasion du Bolchévisme dans l’art”, “La femme allemande tournée en dérision”, “Outrage aux héros”, “Les paysans allemands vus par les Juifs”, “La folle érigée en méthode” ou “La nature vue par des esprits malades”. Les toiles exposées sont entourées de slogans visant à les ridiculiser, et accompagnées, à titre de comparaison, de dessins de malades mentaux internés. En mentionnant le prix des toiles (d’autant plus impressionnant que la plupart ont été achetées par les musées à l’époque de la grande inflation), les autorités nazies espèrent discréditer un peu plus aux yeux de l’opinion publique l’art de la période de Weimar, en laissant entendre que les artistes se sont enrichis à une époque où régnait la misère. Ouverte au public cette exposition n’accueille, durant six semaines, pas plus de 1 000 visiteurs avant d’être présentée dans toutes les grandes villes d’Allemagne».101 On peut déplorer des pertes inestimables de chefs-d’œuvre inconnus, mais dans l’ensemble, l’aspect obscène d’exhiber ce que l’on considère comme des œuvres produites par des esprits dégénérés démontre de facto que le régime lui-même était le porteur de cette dégénérescence. Le gigantisme des statues sculptées par Arno Breker selon les canons de la statuaire grecque ancienne et devant lesquelles s’extasiait Hitler n’étaient, comme le dit André Breton, qu’«“à son image Dieu a fait l’homme, l’homme a fait la statue et le mannequin”. Statues et mannequins ne sont vraiment pas d’heureux ouvrages; ce sont des vêtements vides, des formes inutilisables et inhabitées. Plutôt qu’exaltée l’âme se trouve étreinte - exilée bien plus qu’acclimatée».102
La guerre menée contre l’art par ceux qui annonçaient sa mort et le décriaient comme dégénéré fut perdue. Devant les chefs-d’œuvre anciens détruits par les bombardements, les incendies, les déplacements et les vols; devant le désir paranoïaque de Hitler de détruire toutes les œuvres de l’art universel pour ne voir triompher que ses misérables cartes postales mal dessinées, montrent que malgré l’aspect anticivilisationnel du capitalisme, l’esprit humain poursuivait toujours son idéal de se mesurer à la matière, d’y mobiliser tous les sens et, au lieu de projeter la dégénération, affirmer que l’expérience artistique se poursuivait. Le psychanalyste Bruno Bettelheim, méditant sur sa détention en camp de concentration, écrit à la fin de son livre, Survivre : «“Le monde ne réussira à se sauver et à survivre que par les plus grandes et les plus profondes régénérations qu’il ait jamais connues.” Quant à la mission de l’artiste dans notre monde, elle est de “préparer dans le cœur des hommes la voie de ces transformations patientes, mystérieuses, anxieuses d’où procéderont les conditions et les harmonies d’un avenir plus serein”. Et nous avons ici l’essence même de la vision de Rilke, qu’il exprime dans la première des Élégies de Duino :
Car le beau n’est que le commencement du terrible
ce que tout juste nous pouvons supporter
et nous l’admirons tant parce qu’il dédaigne
de nous détruire.
La beauté, il le savait, nous entraîne aux limites mêmes de notre existence, nous oblige à reconnaître la dure loi de ces limites, mais, en même temps, nous ouvre aux visions d’un monde où nous transcenderons nos frontières et vaincrons nos terreurs».103
1 A. Corbin. Le miasme et la jonquille, Paris, Aubier-Montaigne, Col. Histoire, 19, p. 265. * Le sixième étage étant celui des domestiques dans une demeure bourgeoise.
2 R. Rumilly Histoire de la Province de Québec, t. 1 : G.-É. Cartier, Montréal, Valiquette, s.d., p. 69.
3 P. Ndaye. «Les esclaves du Sud des États-Unis», in M. Ferro. Le livre noir du colonialisme, Paris, Hachette, Col. Pluriel, 2003, p. 159.
4 J.-P. Bois. Les vieux, Paris, Fayard, 1989, pp. 313-314.
5 J.-P. Bois. ibid. pp. 301 et 303.
6 J.-P. Bois. ibid. p. 308.
7 T. Zeldin. Histoire des passions françaises, t. 1 : Ambition et amour, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H51, 1978, p. 354.
8 M. Angenot. 1889, un état du discours social, Montréal, Le Préambule, 1989, p. 354.
9 Y. Knibielher et C. Fouquet. Histoire des mères, Paris, Montalba, Col. Pluriel, # 8368, 1977, p. 270.
10 A. Martin-Fugier. La bourgeoise, Paris, Grasset, Col. Figures, 1983, p. 47.
11 Cité in B. Russell. Histoire des idées au XIXe siècle, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 1938, p. 355.
12 P. Muray. Le XIXe siècle à travers les âges, Denoël, Col. L’Infini, 1991, pp. 79-80.
13 G. Bechtel. Délires racistes et savants fous, Paris, Plon, réed. Press Pocket, Col. Agora, # 261, 2002, p. 222.
14 A. Garrigou. Histoire sociale du suffrage universel en France, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H303 , 2002, pp. 112-113.
15 P. Gay. La culture de la haine, Paris, Plon, Col. Civilisations & Mentalités, 1997, pp. 69-70.
16 M. Winock. Le siècle des intellectuels, Paris, Seuil, Col. Points, # P613, 1999, p. 126.
17 Cité in R. Girardet. L’idée coloniale en France, 1871-1962, Paris, La Table ronde, Col. Pluriel, # 8338, 1972, p. 75.
18 R. H. Shryock. Histoire de la médecine moderne, Paris, Armand Colin, 1956, p. 195.
19 P. Pascal. Dostoïevski L’homme et l’œuvre, Paris, L’Âge d’homme, rééd. Agora, #3, 1970, p. 373.
20 P. Gay. op. cit. p. 128.
21 C. Lasch. Le Seul et Vrai Paradis, Paris, Flammarion, Col. Champs essais, # 712, 2006, pp. 117-118.
22 E. Jünger. Essai sur l'homme et le temps, Paris, Christian Bourgois, 1970, p. 51
23 M. Winock. Histoire politique de la revue «Esprit» 1930-1950, Paris, Seuil, Col. L’univers historique, 1975, p. 15.
24 J. Crokaert. Histoire de l’Empire britannique, Paris, Flammarion, 1947, pp. 522-523.
25 M. Winock. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # 131, 1990, p. 353.
26 Cité in G. Lefranc. Le mouvement socialiste sous la troisième république, t. 2 : 1920-1940, Paris, Payot, Col. P.B.P., # 308, 1977, p. 377.
27 G. L. Mosse. L’image de l’homme, Paris, Abbeville, Col. Tempo, 1997, p. 163.
28 F. Tamagne. Histoire de l’homosexualité en Europe, Paris, Seuil, Col. L’univers historique, 2000, p. 588.
29 S. Moscovici. L’Âge des foules, Paris, Fayard, 1981, p. 364.
30 R. Rumilly. Histoire de la Province de Québec, t. XXVII : Rayonnement de Québec, Montréal, Montréal Éditions, s.d., pp. 133-134.
31 J.-C. Sournia. Histoire et médecine, Paris, Fayard, 1982, p. 177.
32 P. Perrot. Le corps féminin, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H141, 1991, p. 76.
33 P. Perrot. ibid. p. 234, n. 94.
34 R. de Becker. Les Songes, Paris, Grasset, Col. Bilan du mystère, # 6, 1958, p. 38.
35 S. Audoin-Rouzeau. L’enfant de l’ennemi 1914-1918, Paris, Aubier, Col. historique, 1995, pp. 152-153.
36 S. Audoin-Rouzeau. ibid. p. 216, n. 233.
37 L. Duplessy. L’esprit des civilisations, Paris, La Colombe, 1955, p. 36.
38 H. Arendt. L’impérialisme, Paris, Seuil, Col. Points # 356, 1998, p. 93.
39 J. Boissel. Gobineau, Paris, Hachette, 1981, p. 127.
40 G. Vigarello. Histoire des pratiques de santé, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H258, 1999, p. 162.
41 G. Vigarello. ibid. p. 217.
42 G. L. Mosse. La révolution fasciste, Paris, Seuil, Col. XXe siècle, 2003, pp. 242-243.
43 A.-L. Maugue. «L’Ève nouvelle et le vieil Adam», in G. Duby et M. Perrot (éd.) Histoire des femmes en Occident, t. 4 : Le XIXe siècle, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 4, 2002, p. 628.
44 J. Donzelot. La police des familles, Paris, Minuit, Col. Sens critique, 1977, p. 120.
45 G. L. Mosse. De la Grande Guerre au totalitarisme, Paris, Hachette, 1999, p. 75.
46 G. L. Mosse. op. cit. 1997, p. 65.
47 G. L. Mosse. ibid. pp. 87-88.
48 T. Zeldin. Histoire des passions françaises, t. 5 : Anxiété et hypocrisie, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H55, 1981, pp. 82-83.
49 G. L. Mosse. op. cit. 1997, p. 88.
50 J. Donzelot. op. cit. pp. 118-119.
51 E. Weber. Fin de siècle, Paris, Fayard, 1986, p. 21
52 C. Mouchard. Un grand désert d’hommes 1851-1883 : Les équivoques de la modernité, Paris, Hatier, Col. Brèves, 1991, pp. 256-257.
53 J. Perrot. Henry James, une écriture énigmatique, Paris, Aubier-Montaigne, 1982, p. 194.
54 E. Weber. op. cit. p. 20.
55 M. Angenot. op. cit. pp. 353-354.
56 T. Zeldin. op. cit. t. 5, p. 26.
57 E. Traverso 1914-1945 La guerre civile européenne, Paris, Hachette, Col. Pluriel, 2009, pp. 224-225.
58 P. Hahn. Nos ancêtres les pervers, Paris, Olivier Orban, 1979, p. 61.
59 G. L. Mosse. op. cit. 1997, p. 89.
60 M. Angenot. op. cit. p. 355.
61 A. Mayer. La persistance de l’Ancien Régime, Paris, Flammarion, Col. Champs, # 212, 1983, p. 207.
62 G. L. Mosse. La révolution fasciste, op. cit. 2003, p. 50.
63 R.-H. Guerrand. L’art nouveau en Europe, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 2009, p. 61 à 63.
64 M. Marrus. Les Juifs de France à l’époque de l’affaire Dreyfus, Bruxelles, Complexe, Col. Historiques, # 28, 1985, pp. 303-304.
65 J. Le Rider. Modernité viennoise et crises de l’identité, Paris, P.U.F., Col. Quadrige, # 302, 2000, p. 170.
66 Cité in J. Le Rider. ibid. p. 168.
67 E. Zaretsky. Le siècle de Freud, Paris, Albin Michel, rééd. Livre de poche, # 31504, 2004, pp. 368-369.
68 T. Zeldin. op. cit. t. 5, p. 85.
69 A. Rhodes. Histoire mondiale de la propagande de 1933 à 1945, Elsévier, Séquoia, 1980, p. 85.
70 D. Pélassy. Le signe nazi, Paris, Fayard, 1983, p. 99.
71 F. Vitoux. Bébert le chat de Louis F. Céline, Paris, Grasset, Col. Livre de poche, # 5193, 1976, p. 127.
72 C. Lecigne. Louis Veuillot, Paris, P. Lethielleux, 1943, pp. 284-285.
73 R. Hardy. Les Zouaves, Montréal, Boréal Express, 1980, pp. 219-220.
74 C. Leatherdale. Dracula, Paris, Dervy, Col. Bibliothèque de l'hermétisme, 1996, pp. 184-185.
75 C. Leatherdale. ibid. pp. 221-222.
76 Cité in R.-J. Dupuy. Politique de Nietzsche, Paris, Armand Colin, Col. U, 1969, p. 104.
77 C. Roger-Marx. Toulouse-Lautrec, Paris, Éditions Universitaires, Col. Témoins du XXe siècle, # 7, 1957, pp. 7 et 8.
78 C. Roger-Marx. ibid. p. 26.
79 C. Roger-Marx. ibid. pp. 27-28.
80 C. Roger-Marx. ibid. p. 44.
81 C. Roger-Marx. ibid. pp. 95 et 99.
82 S. Jouve. Les décadents, Paris, Plon, 1989, pp. 117-118.
83 L. Leibrich. Thomas Mann, Paris, Éditions Universitaires, Col. Classiques du XXe siècle, # 12, 1958, p. 30.
84 H. Justin. Avec Poe jusqu’au bout de la prose, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 2009, pp. 379-380.
85 R. Giguère. Exil, révolte et dissidence, Paris, P.U.L., Col. Vie des lettres québécoises, # 23, 1984, pp. 109-110.
86 A. Kyrou. Le surréalisme au cinéma, Paris, Ramzay, Col. Poche Cinéma, # 14, 1985, p. 152.
87 X. Gauthier. Surréalisme et sexualité, Paris, Gallimard, Col. Idées, # 251, 1979, p. 33.
88 J. Dubois. Les romanciers du réel, Paris, Seuil, Col. Points, # 434, 2000, p. 308.
89 P. Vandromme. Louis-Ferdinand Céline, Paris, Éditions Universitaires, Col. Classiques du XXe siècle, # 51, 1963, p. 47.
90 M. Lévy. Lovecraft, Paris, Christian Bourgois, 1985, p. 51.
91 M. Lévy. ibid. p. 78.
92 U. Aubertin & A. Lantenois, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.). Art et Fascisme, Bruxelles, Complexe, Col. Questions du XXe siècle, 1989, p. 140.
93 U. Aubertin & A. Lantenois, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.). ibid. p. 140.
94 U. Aubertin & A. Lantenois, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.). ibid. p. 141.
95 U. Aubertin & A. Lantenois, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.). ibid. p. 143.
96 U. Aubertin & A. Lantenois, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.). ibid. pp. 143-144.
97 U. Aubertin & A.Lantenois, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.). ibid. p. 139.
98 J. Willet. L’expressionnisme dans les Arts 1900-1968, Paris, Hachette, Col. L’univers des connaissances, # 59, 1970, pp. 205 à 207.
99 B. Hinz, in P. Milza et F. Roche-Pézard (éd.) op. cit. p. 48.
100 L. Richard. L’Art et la guerre, Paris, Flammarion, 1995, p. 50.
101 A. Guyot & P. Restellini. L’Art nazi, Bruxelles, Complexes, Col. La Mémoire du Siècle, # 29, 1983, pp. 59-60.
102 G. Picon. Le surréalisme, Paris, Skira, 1983, p. 54.
103 B. Bettelheim. Survivre, Paris, Robert Laffont, Col. Pluriel, # 8366, 1979, p. 513.
MORALISATION
I.1 DE LA DÉCADENCE
«La décadence est inévitable, prédit Renan; les peuples y sont portés par une sorte de loi qui les pousse à rechercher uniquement “la plus grande somme possible de bien-être, sans souci de la destinée idéale de l’humanité”. L’avenir s’annonce d’autant plus sombre que le darwinisme laisse entrevoir une sélection naturelle de type raciste - à moins que, comme certains le redoutent, les mélanges n’entraînent la décadence et la dégénérescence».1 La décadence est une fatalité, suivant le mouvement de déclin, et la civilisation occidentale n'échappe pas à cette loi des civilisations. Cette idée s'est inscrite dans la pensée à partir de la fin du XIXe siècle. Cette fatalité, on la retrouvait encore comme point de chute du Traité de sociologie de Wilfredo Pareto : «Lorsqu’il y a environ un siècle on était dans la période ascendante de la liberté, on blâmait les institutions cristallisées et restrictives de l’Empire byzantin. Aujourd’hui que nous sommes dans la période descendante de la liberté, ascendante de l’organisation, on admire et on loue ces institutions… Byzance nous fait voir où peut atteindre la courbe que nos sociétés sont en train de parcourir. Quiconque admire cet avenir est nécessairement amené à admirer ce passé, et vice versa».2 La sociologie, en tant que science nouvelle ouvrait sa carrière en claironnant que le monde allait vers sa fin. La finalité en question est contenue dans le mot même utilisé : «…la décadence, à l’inverse du progrès, ne peut être pensée comme indéfinie et conduit donc nécessairement au fantasme apocalyptique».3 Est-ce en ce sens qu'il faut envisager l'affirmation de Françoise Proust pour qui «(la décadence n’est pas le contraire du progrès, c’est la survivance, et tel est le lot de la modernité). Le déjà-mort s’entremêle à l’à-peine-né, le nouveau s’enlace à l’ancien, délimitant un espace fantomal de survivance»?4 Contradiction contenue dans le mot même, soutenu par le pessimisme foncier d'une époque angoissée : «La notion de “décadence” est une anticipation, elle est encore une forme d’anachronisme. […] La décadence est une condamnation et une punition. […] Ainsi la prétendue “décadence” est la justification de ce qui l’a suivie. Ce concept se trouve donc teinté de finalisme : tel événement a eu lieu “pour que” tel autre lui succède. On dote le fait historique d’un projet : cette notion naïve ne finira jamais d’être exploitée à des fins glorificatrices. […] La “nécessité” de la décadence est née de l’hagiographie de ses successeurs».5 «...la décadence n’est pas le contraire du progrès», tout simplement parce que le progrès est quantité, se calcule, se mesure, comme Grant comptant ses soldats survivants contre ceux tués du côté adverse; la décadence est qualité, sensibilité, esthétisme, comme les kamikases précipitant leurs bombardiers contre les porte-avions américains. Cela, nous l'entrevoyons clairement en ce début de XXIe siècle, et la distinction est majeure.
En effet, les civilisations passées ne définissaient pas leur décadence. Il y avait bien des esprits chagrins, comme Juvénal ou Tacite dans l'Empire romain, qui pouvaient mesurer les transformations touchant tantôt la dissolution des mœurs tantôt l'appauvrissement linguistique qui donnaient l'impression d'une perte de qualité ou de vigueur, mais la fatalité restait promesse de renaissance selon la conception cyclique de l'Histoire des Romains. Or, les Occidentaux à partir du second XIXe siècle affirmaient qu'ils assistaient au début d'un processus de décadence, et que ce processus irait sans renaissance; que la fatalité était de l'ordre de cette condamnation et de ce châtiment relevés plus haut. La décadence romaine restait toutefois le modèle à partir duquel ces pessimistes mesuraient la décadence actuelle. «Déjà en 1847, le tableau de Thomas Couture Les Romains de la décadence, exposé à Paris, avait donné le ton. D’austères héros grecs, debout à l’arrière-plan, forment un contraste saisissant avec la scène d’orgie qui a lieu à leurs pieds, tout en poses lascives et gestes d’abandon charnel; au fond, à peine visibles, deux hommes se tiennent par la main. En 1917, cette toile était toujours louée comme une œuvre combattant l’égoïsme et l’immoralisme. Elle annonçait le rôle clé que prendrait jusqu’à la fin du siècle, la notion de “décadence” pour stigmatiser les ennemis de la société et de son idéal viril».6 Car la décadence ne se mesurait pas pareillement à tous les niveaux. Elle se mesurait au niveau essentiellement des mœurs, des valeurs individuelles mais aussi sociales. Elle se mesurait à la forme et au contenu des œuvres littéraires et artistiques. Il y avait également le sentiment d'une perte des valeurs viriles sur lesquelles se fondaient la puissance des États. Le fameux tableau en question posait déjà, un an avant le printemps des peuples, la critique que Nietzsche développa plus tard sur la nature létale de la pensée bourgeoise : «Au Salon de 1847, Thomas Couture avait triomphé avec Les Romains de la décadence, une de ces grandes machines moralisatrices dont les Parisiens raffolaient. “Au pied des grands Romains de l’époque glorieuse, leurs descendants indignes sont là couchés, la tête basse, les bras pendants, les muscles dénoués, inertes et somnolents, vaincus par le vice, eux dont les ancêtres ont vaincu le monde; le vin et les courtisanes ont été plus forts que les barbares”, s’extasie Théophile Gautier dans un article ampoulé de plusieurs pages. Couture qui était un homme vertueux se proposait en réalité, de dénoncer dans sa toile la corruption du gouvernement de Louis-Philippe, mais l’antiquité de pacotille sous laquelle il le dissimule empêche son message de passer».7 Cette scène, qui semble anticiper L'Ange exterminateur de Buñuel, était l'exemple d'un traitement académique qui dévalait vers le kitsch. Un traitement que Mario Praz situerait entre Delacroix et Moreau, qui «représentent très bien l’atmosphère morale des deux périodes où ils fleurirent : le romantisme avec sa fougue d’action frénétique, le décadentisme avec sa contemplation stérile. Leur sujet est à peu près le même, exotisme de luxure et de sang. Mais Delacroix y vit du dedans, Moreau l’idolâtre du dehors, de sorte que si le premier est un peintre, le second est un décorateur».8 Et de la décadence artistique, il était facile de passer au thème littéraire lui-même : «Depuis environ les années 80 jusqu’au début de ce siècle, le monde littéraire se polarisa autour de l’idée de décadence : “Se dissimuler l’état de décadence où nous sommes arrivés serait le comble de l’insenséisme. Religion, mœurs, justice, tout décade… La société se désagrège sous l’action corrosive d’une civilisation déliquescente. L’homme moderne est un blasé. Affinement d’appétits, de sensations, de goûts, de luxe, de jouissances, névrose, hystérie, hypnotisme, morphinomanie, charlatanisme scientifique, schopenhauérisme à outrance, tels sont les prodromes de l’évolution sociale”. Ces lignes sont du journal Le Décadent du 10 avril 1886. Peu après, Huysmans dira : “Les queues de siècle se ressemblent. Toutes vacillent et sont troubles”».9 Mais que désignait exactement le mot décadence? Certes, on pouvait bien parler de décadence morale ou sociale; de décadence artistique ou langagière, mais cela ne faisait que traduire une sensation morbide. Concrètement, le mot s'étala dans toutes les directions. Pour Sournia, «le vocable de “décadence” est désormais entaché de tant de connotations morales et moralisantes que celui de “régression” est certainement préférable, sans doute parce que moins précis, et donc pouvant couvrir des domaines plus variés. En effet, l’analyse des États en prétendue décadence prouve que la régression ne porte pas sur tous les domaines en même temps».10 La décadence se résumerait assez bien dans ce sentiment vague d'une conscience morale affligée d'un mouvement qui ne porte plus vers l'amélioration ou le perfectionnement, mais plutôt engagée dans une régression autant spirituelle que morale.
Mais une fois la décadence affirmée, plutôt que de vouloir s'y soustraire comme le prescrivait les forces conservatrices, les élites culturelles fin-de-siècle préférèrent capitaliser sur elle et créer un véritable décadentisme. Plutôt que de fuir le poison ou redresser la tare, on s'y engageait jusqu'à créer des fruits empoisonnés et cultiver la dégénérescence. Comme le remarque Sloterdijk, «si les cultures de la décadence sont possibles, c’est parce que le luxe de l’éveil s’exprime de préférence sous la forme du luxe de la morbidité. Lorsqu’on médite sur la morbidité, on explore la faiblesse comme un état susceptible de faire l’objet d’un entraînement. Aux degrés élevés de mise à disposition collective pour des exercices visant à sortir de la forme, on peut observer des résultats impressionnants au sein d’une population, pourvu qu’elle soit suffisamment gâtée : par renforcement circulaire, un vague dégoût de tout et de chacun apparaît chez les aînés, parallèle à l’épuisement rapide des jeunes».11 Sur le coup, on pressentait la décadence comme une réalité, une vérité subjective en fait, plus exactement un mythe, à l'exemple du progrès. La décadence sera toujours plus une idée qu'une série de faits qui la cautionnerait. Et de quels faits parle-t-on?
«En premier lieu ils font référence à un passé qui est constamment heureux. De quelque peuple que l’on parle, il était alors comblé, riche, fécond, pacifique; les moissons étaient abondantes, le souverain commandait et était obéi, il était bon, ferme, juste, ses armées étaient constamment victorieuses. Le mythe de l’Âge d’or est universel et il est toujours plus ancien que la génération qui a précédé l’auteur : l’idée de décadence est une nostalgie.
En second lieu le mythe est comparatif, il prend toute sa valeur lorsqu’on oppose le passé au présent, et l’analyse de l’actuel cumule des traits qui sont constants depuis des millénaires. Un élément religieux : “Les Dieux sont contre nous, les récoltes sont moins abondantes, le climat s’est détérioré, parce que nos ancêtres ou nous-mêmes avons péché.” Des éléments moraux : les mœurs se dégradent, le luxe et l’oisiveté remplacent les vertus antiques, la luxure explique la dénatalité. Le conflit des générations : les jeunes ne respectent plus les anciens, ils ne travaillent plus comme autrefois, ils n’ont plus le goût du bel ouvrage. La xénophobie : Le pays périclite parce que trop d’étrangers s’y installent, qui n’ont pas les mêmes qualités et abâtardissent la race. Ces propos ont été tenus de tout temps dans toutes les langues du monde, ils le sont encore, au point qu’on se demande comment l’homme est toujours là».12
Tels sont les lieux communs de l'idée de décadence au point que ne peut manquer de relever son aspect caricatural. Cette idée avait été donnée déjà par les écrivains de l'Antiquité tardive et transmise, dans un premier temps, par les révolutionnaires français : «Cette idéalisation de la vigueur ne manque pas de fonction sociale : le citoyen antique contre la victime présente du despotisme, les mœurs “simples” contre la “corruption”, la régénération contre la décadence. La critique de la mollesse, c’est aussi la critique d’une cité : “Nous n’avons plus de citoyens.” Et les mœurs rudes sont censées compenser l’étiolement des “petits maîtres”. Ces Romains et ces sauvages profilent un “ailleurs” de liberté et de force. Ils s’opposent au luxe aristocratique devenu ici “affaiblissement” et ils s’opposent à un pouvoir arbitraire implicitement dénoncé. Ils jouent tout simplement un rôle de contre-exemple. […] C’est cette critique que vont emprunter bien des discours après 1789. L’Antiquité promue modèle et liberté : “Si nous imitons ces peuples libres […].” L’Antiquité promue aussi modèle de vigueur, l’éducation devant, dans ce cas, prendre en charge l’aguerrissement : “Je veux des luttes, des jeux, des exercices, des courses, du mouvement, bien plus que des livres et des leçons.” (Jean Bon Saint-André)».13 La décadence, en retour, surgissait comme passage obligé de toute civilisation, l'heure de la fin résonant comme un écho à l'aube du commencement : «L’immoralité primitive fait pendant à celle des déclins, la confusion et la dureté sociales s’observent aux aurores de même qu’aux crépuscules. Les civilisations naissent et périssent dans la douleur. Mais cette réversibilité n’est qu’apparente, car les mêmes effets sont produits par des causes inverses : ainsi le goût pour le motif géométrique indique au début la pauvreté de facture, à la fin la pauvreté d’inspiration. La licence du barbare n’est pas la corruption du décadent. Les civilisations ne sauraient remonter le cours de la durée. S’il arrive que le retour aux origines soit conscient et voulu, et que la carence des basses époques inspire la nostalgie d’un passé lointain que l’on se prend à imiter ou à restaurer, comme dans l’Égypte saïte ou sous le règne de Julien, de telles tentatives sont invariablement vouées à l’échec».14 Comment, en effet, ne pas juger de la défaite de la tentative de Julien l'Apostat de ramener le paganisme comme une preuve du déterminisme qui fait de la décadence une phase historique incontournable? «C’est aux basses époques que les lettres se voient le plus choyées. Faut-il y voir un bon symptôme? Si la culture est plus répandue, c’est à la manière d’une cloaque qui noie plutôt qu’il ne fertilise. Bien que chacun se mêle de tenir une plume, le goût se cantonne dans la vanité des petits problèmes du bien-dire. Une immense médiocrité embourbe le terrain de l’esprit, lequel ne fait plus que remâcher des fruits cueillis depuis longtemps. Les fins de civilisation se caractérisent aussi par l’extrême faiblesse en même temps que l’extrême urbanité. Les mœurs affadies, les sentiments et les manières bridés par la bienséance, une mondanité exquise et vaine, le règne de la femme composent une fleur déjà passée. “Trop civilisées”, dit-on de telles époques. Pour ma part, je demande que l’on m’explique ces mots. À partir du moment où la culture dépasse son point juste, il n’y a plus excès, mais déficience. Votre “civilisé” est un décadent».15 Ce fatalisme rejetait, dès le départ, toute autre façon de voir la décadence qui ressemblerait à celle d'une antiquité tardive, tout comme une ère de renaissance culturelle au XXe siècle? Lorsqu'on s'engageait sur le chemin de la régression, on ne pouvait plus faire demi-tour.
Une fois constatée, une fois affirmée, comment expliquer la décadence et analyser cet appel irrésistible à la régression? L'historien Michel Winock relève neuf critères à partir desquels on a défini la décadence à partir du XIXe siècle :
1. la haine du présent.
2. la nostalgie d’un âge d’or.
3. l’éloge de l’immobilité.
4. l’anti-individualisme.
5. l’apologie des sociétés élitaires.
6. la nostalgie du sacré.
7. la peur de la dégradation génétique et l’effondrement démographique.
8. la censure des mœurs.
9. l’anti-intellectualisme.16
Plus généralement, «les théoriciens de la décadence entretiennent le mythe d’une société idéale, reposant sur un consensus moral et garantissant l’unité et la puissance de la nation. Qu’ils soient français, britanniques ou allemands, vainqueurs ou vaincus, tous souhaitent retrouver les conditions de vie de l’avant-guerre : stabilité économique, conformisme social, domination internationale. Plutôt que de chercher les causes profondes de la crise de l’entre-deux-guerres, ils préfèrent désigner des boucs émissaires, chargés de toutes les tares […]. L’industrialisation et l’urbanisation croissante de la société sont l’une des causes de la propagation du mal alors que l’individualisme triomphant conduit à la baisse d’influence de l’Église et à la montée de l’immoralité. Le but de la plupart des dénonciateurs de la décadence est de toucher le grand public pour qu’il réagisse vigoureusement aux dangers qui menacent la patrie. Ainsi le Dr. Albert Chapotin commence son livre Les Défaitistes de l’amour (1927), dont le chapitre sur l’homosexualité s’intitule “Descente aux enfers : les monstres”, par cette exhortation : “Nous espérons qu’ainsi nous pourrons augmenter le nombre des bons citoyens disposés à fonder une famille le plus tôt possible, au lieu de s’attarder en des découvertes funestes. Nous contribuerons ainsi à retarder cette dépopulation qui risque de mener notre pays à la décadence”».17 Mais les facteurs objectifs de cette chute démographique passaient loin en second. L'idée de décadence s'imposait parce que les esprits la vivaient intérieurement. C'était une expérience subjective qui, même si elle renvoyait à des critères extérieurs, minait le moral des individus. Derrière le masque de la décadence persistait le visage de la dégénérescence : «...“tout dégénère”, - les institutions, les mœurs, les lettres et les arts; le vice, le pourrissement moral gangrènent le pays. Les divisions et les scandales accélèrent la ruine. “La décadence dans les forces charnelles et dans les mœurs, dans la pensée philosophique et dans l’art! Elle a marqué toutes choses de son doigt sale. Des décadents, ces sang-pourris qui empestent la terre de leur souffle puant l’alcool et la vérole. Des décadents, ces pseudo-philosophes modernes, ces compilateurs des pensées anciennes. Des décadents, ces artistes impuissants qui méprisent la Nature, qui ne savent que haïr et envier!”».18 On en arrivait, tout naturellement, au constat «de la décadence, ou de la mort collective d’une civilisation énervée, à bout de souffle, ...sans doute l’un des plus nouveaux et des plus significatifs, révélateur d’une sensibilité qui déborde très largement le cénacle restreint des décadents officiels. Cette époque a aimé Venise et Bruges la morte, comme elle s’est complu à évoquer, parfois avec l’emphase lascive d’un peintre pompier tel que Rochegrossse, Les Derniers Jours de Babylone. Millais évoque dans une esquisse saisissante, La Veille du déluge : vu de dos, un personnage ouvre une fenêtre sur un paysage noyé, dans lequel il semble prêt à se précipiter, cependant qu’un cercle de témoins se partage entre la peur, l’angoisse et la résignation. Et que dire de cette étonnante composition du Belge Léon Frédéric, sous le titre Tout est mort, qui place dans un cadre alpestre le flot d’un torrent débordant des cadavres nus d’un peuple de morts, adultes, enfants aussi, parmi lesquels nagent de grands cygnes impassibles?»19 Bientôt, au terme décadence on substitua l'idée fin-de-siècle, peut-être avec l'espoir qu'une fois franchi le millésime, on pourrait voir une reprise de la civilisation dans ses valeurs traditionnelles? «“Fin-de-siècle” ne désigne pas la seule décrépitude de la civilisation, mais connote les mœurs faisandées, les sensibilités trop raffinées, les doctrines contre nature (le féminisme notamment), les littérature inintelligibles, phénomènes dont il est entendu qu’ils préludent à l’effondrement. Humbert de Gallier intitule son roman qui conte la vie sans but et sans principe d’un blasé, Fin de siècle. Albert Delpit titre, lui, Un Monde qui s’en va, ce qui revient au même. Le lexème “Fin”, extrait de “fin de siècle”, suffit à marquer la vision crépusculaire. Le héros de Gallier est évidemment un “fin de race”, comme le sont Rodolphe de Habsbourg, Louis II de Bavière. “Fin d’un régime”, “Fin d’une République”, tirent les mécontents».20 Dans tous ces cas, cependant, on ne voyait que le destin de l'Europe seule et non de la civilisation occidentale qui se poursuivait quand même de l'autre côté de l'Atlantique et en Australasie.
Peut-être parce que l'idée de décadence s'associait automatiquement à des vieux pays. Aussi, «la décadence de l’Europe n’était pas sentie comme la fin d’un état d’innocence et de pureté pastorales mais comme la dégénérescence de la cité classique avec une politique, une société et une culture d’élite. Les marchands de décadence méprisaient - craignaient plutôt - la plèbe inculte et sinistre qui s’était arrogé le droit de cité. En même temps ils dédaignaient les élites apeurées qui s’étaient approprié la tradition humaniste à des fins intéressées. Les intellectuels déconcertés par le monde contemporain semblaient vouer les uns et les autres aux gémonies. En réalité ils se rangeaient du côté de l’ordre social établi, garant de la culture d’élite. Ce penchant conservateur se confirma après le début de ce siècle, lorsque, au lieu de se réfugier dans un esthétisme et un dandysme de bon ton, beaucoup de prophètes de la décadence, et non les moindres, se rallièrent aux Églises établies ou aux nouveaux cultes du superpatriotisme».21 Cette révélation était brutale. Elle prenait, pour certains, l'ampleur d'un traumatisme. Les lecteurs de Nietzsche reprenaient son jugement sans toujours bien le situer : «Certes, notre culture contemporaine est une chose lamentable, un brouet à l’odeur de pourriture, où flottent des miettes peu appétissantes de christianisme, de science, d’art, dont les chiens même ne voudraient pas. Mais ce qu’on cherche à opposer à cette culture n’est guère moins pitoyable, que ce soit le fanatisme chrétien, le fanatisme scientifique ou le fanatisme de l'art, chez des gens qui tiennent à peine sur leurs jambes; c’est comme si on voulait guérir un défaut par un vice. En vérité, si la culture présente paraît pitoyable, c’est parce qu’une tâche monte à son horizon, je veux dire la révision de toutes les valeurs. Toutefois, avant de pouvoir disposer toutes choses sur la balance, il faut se procurer la balance elle-même - je veux dire cette équité suprême de la suprême intelligence qui a pour ennemi mortel le fanatisme, et dont la culture générale de notre temps n’est que le singe et le cabotin».22 Un tel jugement était devenue une rengaine, particulièrement lorsqu'elle sortait de la jeunesse intellectuelle du début du XXe siècle : «“Evertthing is declining”, Prezzolini lamented. “Every ideal is disappearing. The parties no longer exist, but only splinter groups and clienteles… Everything is coming apart at the seams”. The great forces of opposition, like the Socialists and the Catholics, were surrendering to a general “mushiness” and moral disintegration. […] “The disgust is enormous. The best no longer have confidence. The young, if they are not opportunists and spineless, no longer enter the parties.” Prezzolini confessed that he himself had no clear idea of what to do, except to abstain from taking part in those present movements (like Nationalism) that were heading toward a general disaster».23 L'un des paradoxes du siècle fut de conduire cette jeunesse en détestation de la culture européenne, une fois mûrie, devenir ses défenseurs les plus tenaces!
C'est au cours de la décennie quatre-vingt du XIXe siècle que le thème de la décadence devint le cœur d'un fort courant littéraire français. «La décadence, telle qu’elle apparaît à la fin du XIXe siècle, pas plus qu’une école n’est un mouvement. Ou alors, c’est une école introuvable dont les fondateurs sont aussi les premiers détracteurs. Huysmans, Péladan, Verlaine, Mallarmé - et bien d’autres encore -, tous récusent à tour de rôle l’épithète sous laquelle il nous semble parfois possible de les réunir aujourd’hui. Entre naturalisme et symbolisme, elle se refuse à devenir décadentisme. Elle s’affirme comme état d’esprit, comme sensibilité diffuse, devenant ainsi une sorte de point de ralliement clandestin où se reconnaissent et se retrouvent, de manière souterraine, tous ceux qui partagent, ne serait-ce que par leur refus, une certaine conception du monde. Le phénomène décadent est donc cet espace où se nouent, par delà les époques et les écoles, un certain nombre de figures et de préoccupations. La décadence est une tendance qui s’affirme comme un choix, un engagement absolu, une nécessité d’être qui se proclame avec passion et lucidité. Elle revendique le droit à la chute, au déclin, à la mauvaise conscience du mal de vivre. Finie l’association facile de l’idée de décadence avec les notions de maniérisme, de dégénérescence ou de stérilité; finie la confusion trop restrictive entre la décadence et la déchéance. Elle est avant tout une entreprise de démolition, insolente et passionnée, des valeurs établies. Il est regrettable de la disqualifier justement parce qu’elle est inqualifiable. Il est insuffisant de la réduire à n’être que le versant noir du romantisme ou la préparation laborieuse du symbolisme. En effet, le mal du siècle décadent n’est pas celui du romantisme : la fatigue de vivre a remplacé le mal de vivre. C’est un mal intensifié par l’esprit critique et le jugement sur les choses, un malaise profondément vécu de l’intérieur, une mélancolie irraisonnée. Le drame de l’âme moderne, c’est cette conscience lucide de la confusion qui l’habite. Si le romantisme a tenté de démêler le désordre des sentiments et les intermittences du cœur, la décadence, elle, voudra conquérir la sensation et s’approprier l’âme. Rien de plus différent… La décadence explose. Elle est avant tout réaction virulente, et non continuation tâtonnante. Si l’agonie la fascine, elle n’en est pas pour autant moribonde! Si elle recherche et apprivoise le déclin, il est pourtant trop facile d’en faire un synonyme de défaillance ou de catastrophe! “Mieux vaut le déclin que la culbute!”, écrivait Vladimir Jankélévitch».24 À première vue, on pouvait tenir le décadentisme pour un avatar du romantisme, partageant des thèmes comme la mort, la beauté des femmes ou l'engagement héroïque. Mais le décadentisme s'opposait au romantisme. D'abord dans le fait que le décadentisme tourne toujours autour d'un anti-héros : Salomé en peinture ou Des Esseintes en littérature : «Le héros décadent, réel ou fictif, est l’exact opposé du modèle traditionnel du héros épique plein de bons sentiments, ayant pour lui sa bonne conscience et l’intime conviction de sa sécurité. Il est l’anti-héros par excellence, l’individu harcelé par un sentiment aigu de culpabilité, par sa mauvaise conscience et par la somme de ses désillusions. Ce chevalier nouvelle manière est l’homme des incertitudes. Opposé au héros pieux, le voyageur décadent s’engage, désabusé, dans une ronde interminable : quête anxieuse et sédentaire dont l’espace se limite au cercle de ses propres incertitudes. La décadence ne propose aucun Graal à sa créature qui, dans son errance tâtonnante, se trouve dans l’incapacité de faire sauter les barrières de son scepticisme, étant trop solidement installée dans le refuge de son abstention : “Il se bornait donc à errer dans les vestibules et dans les alentours”, écrit Huysmans».25 Dans ce genre, on vit aussi apparaître «du personnage viscontien le sentiment d’être le dernier d’une race qui s’épuise…».26 Thème qui était déjà chez Edgar Poe et qui le fût encore chez Henry James. Le courant décadentiste apparaît mûr au début des années 1880 : «Attitude mentale avant tout, elle se plaçait au-dessus des querelles de doctrines ou d’écoles. […] C’est vers 1883 que la décadence, en réaction à l’étroitesse naturaliste, la sottise bourgeoise et la dictature scientiste, commence à se faire entendre sous les signes du retour au spirituel, à l’idéalisme mystique et au sensualisme intellectuel. L’année 1884, fondamentale à bien des égards, lançait la mode du pessimisme et de l’occultisme. Trois livres essentiels paraissaient en librairie : À rebours de Joris-Karl Huysmans, “sorte de roman-fantaisie-bizarre” à un personnage et sans dialogues, qui devint très vite la bible du décadentisme et le bréviaire du goût “fin de siècle”; Le Vice suprême de Joséphin Péladan, premier recueil d’une série romanesque (“La Décadence latine”), qui se voulait l’analyse des mœurs dépravées d’une certaine élite de la fin du siècle; Le Crépuscule des dieux, titre fort évocateur d’Élimir Bourges, réflexion aiguë sur la déchéance. L’année suivante, Paul Bourget publiait les Essais de psychologie contemporaine où il expliquait de manière tout à fait convaincante, à l’aide de métaphores organiques, comment l’exagération de la vie individuelle empêchait toute adaptation à la vie commune. Suivront Les Déliquescences. Poèmes décadents d’Adoré Floupette de Vicaire et Beauclair, une parodie de la vie littéraire de l’époque et de la poésie décadente, qui eut un énorme succès et qui contribua largement à faire connaître cette nouvelle esthétique».27 Plus qu'un état subjectif pessimiste ou mélancolique, la décadence devenait un courant littéraire.
Et comme tout courant littéraire, il lui fallut une revue pour se faire connaître. «Naquit alors Le Décadent, journal qui parut jusqu’en 1889, sous la direction de Maurice du Plessy et d’Anatole Baju. Des écrivains comme Verlaine, Barbey d’Aurevilly, Stéphane Mallarmé, Rachilde et Jean Lorrain y collaborèrent. En juin 1886, il annonce : “L’avenir est au décadisme. Nés du surblaseisme* d’une civilisation schopenhaueresque, les décadents ne sont pas une école littéraire. Leur mission n’est pas de fonder. Ils n’ont qu’à détruire; à tomber les vieilleries et préparer les éléments fœtusiens de la grande littérature nationale du XXe”».28 Le décadentisme se donna un ancêtre de choix, Charles Baudelaire. On lui attribuait la découverte du thème littéraire de la décadence : «On nomme décadence l’attitude de celui qui est fasciné dans la vie par tous les symptômes de déclin. Baudelaire a découvert cet état d’âme pour la poésie, et le symbolisme du XIXe siècle finissant a recueilli son héritage. Le “décadent” peut être attiré par la décadence comme par une force magique; il peut l’accepter et y trouver un stérile plaisir, analogue à l’attirance du vide. Mais il peut aussi en souffrir. Une des subdivisions des Fleurs du Mal est intitulée Spleen et Idéal. Le sentiment de décadence est une souffrance morale des temps modernes, imposée par l’instant historique. Pour qu’on puisse succomber aux puissances hostiles de la vie, il faut que la vitalité soit déjà atteinte. Ce qui, pour l’artiste, signifie tarissement de la force créatrice. Un des principaux thèmes de la poésie de Mallarmé est la stérilité de la muse. La stérilité est un des motifs centraux dans The Waste Land. Eliot a emprunté au répertoire folklorique de tous les temps l’appareil décoratif de son poème».29 Baudelaire était un modèle, mais rien n'obligeait les décadentistes à le suivre à la mesure. Avant d'être une forme littéraire, il fallait se rappeler surtout que «la décadence n’est... surtout pas le reflet objectif d’une réalité historique, elle est le regard subjectif porté sur elle».30 Et personne n'en était dupe. Surtout pas les décadentistes. Le décadentisme était une vision subjective qui prétendait toutefois découler d'observations psychologiques objectives. Il n'y avait là rien de faux, mais c'étaient des observations partielles qu'il était malhonnête de généraliser. Par contre, elles étaient utilisées comme baromètre moral pour confirmer que quelque chose allait mal dans la civilisation. C'est dans ce sens que Huysmans écrivit ses romans :
«Tout le roman sentait le deuil. L'assurance que tout était vain et obscène gisait au cœur du livre. Entre la mort et la société - "l'envoi au bagne" -, il n'y avait donc pas d'alternative. Alors apparaissait spectrale et lunaire, fantomatique et dérisoire, la figure de Pierrot, qui avait toujours hanté Huysmans. Pierrot comme l'archétype de la douleur. Pierrot dans sa trop grande tunique et ses pantalons larges en satin blanc, dansant comme un pantin la misérable danses des hommes, voués à des gesticulations sans raison ni rime. Gilles souffrant, déambulant dans la grande ville, sous la lumière falote des réverbères, pathétique et fatal tout à la fois. Huysmans, qui avait tant admiré le Gilles de Watteau, figurant mélancolique des fêtes galantes, tache blanche comme une hostie, dans le crépuscule traversé des moirures mauves des dominos. Huysmans le rendait encore plus désespéré, Pierrot schopenhaurien, résolument nocturne, traversant les rêves de des Esseintes, butant sur la croûte silencieuse du ciel, culbutant "avec leurs pieds et leurs têtes", dans une sorte de pantomime ridicule, bête à pleurer.
Oui, des Esseintes, Huysmans étaient les "forçats de la vie qui s'embarquaient seuls dans la nuit". Fantoches pâles et abandonnés au roulis du monde. Les rêves les plus fous d'isolement, cette coulée dans une matrice dont jamais il ne sortirait, échouaient. Des Esseintes rejoindrait Folantin. Dans sa thébaïde luxueuse et insensée, le médecin arriverait. Il prescrirait des soins qui exigeraient le retour à Paris. Il faudrait, dirait-il, "attaquer la névrose qui n'était nullement guérie", "quitter cette solitude".
Alors, des Esseintes, dans le manège tournoyant des déménageurs, verrait son rêve s'abolir, puisque tout était impossible, puisque l'aristocratie comme l'Église obéissaient aux exigences de l'argent et des "hauts maquignons". Il rejoindrait le "grand bagne de l'Amérique", la goujaterie de la finance, s'agenouillerait devant les tabernacles des banques.
Plus de rade, plus de berge accueillante où se protéger, rien que la pestilentielle odeur des villes maudites, pas un seul point de contact avec ces êtres aux faces de rats qui les peuplaient étalant dans les dédales des quartiers bas, toujours avides».31 Il serait difficile de dire combien de gens partageaient à ce point l'impression de décadence de Huysmans, mais Ernst Jünger vit en Huysmans la sonde dont l'âme saisissait les soubresauts de la décadence. L'effondrement d'abord - qui correspondrait chronologiquement à la dépression psychologique et morale fin-de-siècle; l'anticipation d'une catastrophe annoncée (celle du Titanic, par exemple, dans le roman de Morgan Robertson, Le Naufrage du «Titan», publié en 1898 sous le titre Futility (en français Futilité) :
«Dans sa première phase, la décadence accélère la catastrophe, les esprits les plus raffinés perdant le goût de la responsabilité et se détournant des disciplines directives. Ils se tournent vers des choses ésotériques et exotiques et suivent les instincts d'un jeu supérieur. À Rebours de Huysmans est à cet égard une mine. C'est sans aucun doute pour de telles raisons que Platon accepte difficilement de voir l'artiste dans son État. Spengler suit son exemple.
Dans sa seconde phase cependant, après les points culminants, la décadence prend un caractère retardateur. L'un de ces points culminants fut pour Huysmans le boulangisme, qui en 1887 créa un risque de catastrophe. Dans cette seconde phase, la décadence proteste contre le fait que tout soit politisé jusqu'à la fibre et changé en mouvement. À cela, son travail a contribué. Pour parler simplement : la fatigue est suspecte avant midi, le soit elle est souhaitable. Huysmans a aperçu par avance bien des choses qui sont devenues réelles durant les soixante-dix années suivantes. L'esprit du temps se présentait à lui, en politique comme nationalisme démocratique, dans l'art sous la forme du naturalisme. La robuste santé sans arrière-plan commune à ces deux formes devint pierre d'achoppement pour lui, comme pour son contemporain Nietzsche. Son œuvre est, jusque dans les moindres nuances, comme la palette de toutes les teintes qui composent la décadence. Zola disait, après la lecture d'À Rebours, que ce livre mène à un cul-de-sac. Cela est vrai, mais on peut le voir dans une autre perspective que celle du progrès. Finalement, tous les ports forment des culs-de-sac».32
Une chose est certaine toutefois, la décadence était un thème très usité parmi les forces conservatrices politiques. D'ailleurs, la décadence avait valeur de ressentiment plutôt que de conception fondée. Idée commune - «Décadence, mercantilisme, faux savoir, amollissement des mœurs : tout cela revient au même» -,33 c'est-à-dire à une démoralisation qui affecte les hautes classes de la société. Décadence sociale avant d'être une décadence morale? Probablement que l'une entraîne inévitablement l'autre. «Nous avons déjà établi - comme premier volet du décadentisme - la conscience de la discontinuité et de la dissémination du moi, écrit Miklós Molnár. Le thème de la multiplication des “âmes”, des “sensations” et des “états d’âmes” se retrouve chez [plusieurs auteurs]».34 Parmi eux, sans doute, Nietzsche : «Le visage de la mort est la grande secousse qui éveille! l’expérience que Nietzsche a faite en 1870 dans les ambulances françaises, l’événement de la guerre, qui a été pour sa pensée d’une importance décisive ou qui, tout au moins, a accéléré son évolution à la manière d’un catalyseur, s’est présentée cinquante années plus tard, avec des dimensions infiniment accrues. Cinquante années plus tard, la mort était devenue la sombre souveraine de toutes choses et l’horreur de la mort criait jusqu’au ciel. C’est alors seulement que l’effondrement de toutes les valeurs devint manifeste. L’angoisse de la perte de toutes les valeurs vitales s’appesantit sur l’humanité, il ne fut plus possible d’écarter cette question angoissée : est-il possible de reconstruire un édifice des valeurs?»35 Dans une condition identique - ambulancier durant la guerre civile américaine -, Walt Whitman et, beaucoup plus tard, - ambulancier sur le front italien durant la Grande Guerre -, Ernest Hemingway, vécurent, si on peut dire, une semblable transfiguration. Une sensibilité à l'œuvre de mort qui leur firent prendre conscience que celle-ci n'avait pas été éradiquée par les inventions techniques du progrès. Que la mort était toujours à l'œuvre pendant que les Occidentaux vaquaient à leurs affaires ou se divertissaient. Pour Hermann Broch, elle crevait littéralement les yeux là où personne ne semblait la voir! «La nature d’une période peut se lire en général sur sa façade architecturale, et celle-ci est pour la seconde moitié du XIXe siècle […], l’une des plus pitoyables de l’histoire universelle. Ce fut la période de l’éclectisme, celle du faux baroque, de la fausse Renaissance, du faux gothique. En quelque lieu que l’homme occidental ait déterminé alors le style de vie, celui-ci devint à la fois vie étriquée bourgeoise et pompe bourgeoise, devint une existence rangée qui représentait tout autant une sécurité qu’une atmosphère étouffante. Si jamais la pauvreté a été recouverte d’un badigeon de richesse, ce fut bien ici».36
Derrière la mélancolie décadentiste s'effectuait une certaine prise de conscience. Voltaire l'avait anticipée un siècle plus tôt : «En avril 1770, Voltaire donnait une définition encore pertinente deux siècles plus tard. Elle survenait, écrivait-il à La Harpe, “par la facilité de faire et par la paresse de bien faire, par la satiété du beau et par le goût du bizarre. N’espérez pas rétablir le bon goût; nous sommes en tous sens dans le temps de la plus horrible décadence”. La facilité, la paresse, la satiété, la disparition du bon goût et une tendance au bizarre : cette révolte de nantis, exprimée largement avec le goût et l’élégance d’une minuscule minorité cultivée et oisive, prouve “la plus horrible décadence”».37 Certes, il était peut-être exagéré de limiter le bon goût à celui des nantis et la disparition du rococo ne suscita nulle convulsion semblable à celles qui accompagnèrent l'apparition de différentes formes artistiques nouvelles et hérétiques. Voltaire reprenait l'argument qui faisait que, «pour les ennemis des Lumières, la décadence est inévitable dans un monde qui adopte pour principes de comportement le rationalisme, l’universalisme et l’idée de primat de l’individu».38 C'était la position du moraliste Paul Bourget qui s'en prenaient aux auteurs réalistes et naturalistes du troisième tiers du XIXe siècle : «Les mots “dégénérescence” et “décadence” abondaient sous sa plume. Au départ, selon Bourget, ces intellectuels étaient des romantiques : “L’influence la plus profonde subie par Gustave Flaubert fut celle du romantisme finissant”. Habité par la nostalgie de la grandeur de la Révolution et de l’Empire, il fut un frère cadet d’Amaury (le héros de Volupté de Sainte-Beuve), d’Albert (le héros de Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier) et de Julien Sorel. Non seulement l’idéal romantique “conduit l’homme à se trouver en disproportion avec son milieu, mais il le met en disproportion avec lui-même. […] Voilà l’explication de la banqueroute que le romantisme a faite à tous ses fidèles”. “Aucun homme ne fut plus complètement [que Flaubert] en désaccord avec son milieu et avec sa propre chimère”».39 Ce fut au sein de cette affliction morale qu'apparut le dernier des philosophes des Lumières, qui reprit le fait que «la conscience était une notion de l’individualité restrictive, centrée sur la morale, et la priorité qui lui était assignée reposait généralement sur l’idée qu’il n’existait qu’une seule bonne façon de vivre. À l’opposé, la disjonction entre la psyché individuelle et la culture, qui devint socialement saillante à la fin du XIXe siècle, nourrit une gamme d’expériences personnelles sans précédent dans des sphères telles que l’amour, l’amitié et la vie quotidienne. Elle était aussi porteuse d’un sentiment nouveau de la profondeur humaine qui, en fin de compte, influença l’art, la philosophie et la politique. La contribution cruciale de Freud réside dans la théorisation de cette disjonction. Définissant le sujet de la psychanalyse comme ce qu’il y a de plus intime dans la vie psychique, tout ce qu’une “personne sociale autonome” doit cacher, il laissait entendre qu’il n’est de lien nécessaire ni direct entre privé et public. Son intuition centrale, qui différait fondamentalement des notions romantique et victorienne du moi, était que la vie intérieure des hommes et des femmes modernes s’organisait à travers des symboles et des récits idiosyncrasiques et, en apparence, dépourvus de sens socialement partagé. Aussi souligna-t-il que, même s’il était possible d’interpréter et de comprendre l’univers intérieur des individus, il était impossible de l’intégrer dans un tout préalablement existant. Loin de chercher à ramener un individu perturbé dans un ordre préexistant, comme le faisait le chaman, le guérisseur ou le prêtre, il formula le projet analytique comme une herméneutique personnelle et provisoire de la découverte de soi - qu’un psychanalyste pouvait facilité mais pas contrôler. Ainsi donna-t-il une expression à des possibilités d’individualité, d’authenticité et ouvrit-il la voie à une nouvelle intelligence de la vie sociale».40 Mais de cette nouvelle intelligence, on en voulut pas. Elle était trop rationnelle, avait des prétentions à l'universalité et plaçait finalement l'individu au cœur de la problématique, et non la nation ou la race. On voulait maintenir et entretenir la vision platonicienne d'un monde en quête de perfection, soudainement heurté par des forces sournoises et hostiles ou pire, des tares fatales.
Les lendemains de la Grande Guerre se montrèrent très peu ouverts a reconsidérer le développement de la civilisation vers une amélioration morale ou psycho-sociologique. L'esprit de décadence ressortit de la guerre même. Guerre civile au sein de l'Occident, compétitions mesquines d'États-nations bourgeois, cupides et égoïstes, la guerre, qui aurait été une occasion de revitaliser, ou plutôt de reviriliser l'amollissement de la pensée bourgeoise, s'effondra devant la supériorité technique et le nombre. Le culte des grands hommes puisés dans le monde royal et militaire cédait le pas devant ces nouveaux héros qu'étaient les vedettes de cinéma et des sports. «En 1927, la Revue des Deux Mondes publiait un article dont l’auteur se plaignait de ce que le nouveau public réclamât des “biographies pures”, c’est-à-dire des biographies qui ne visaient qu’à satisfaire une curiosité oiseuse pour les faits et gestes des grands de ce monde, qui effleuraient la surface des choses et rapportaient des anecdotes amusantes. C’était là le signe de la décadence générale du pays. “Les époques fatiguées ont en commun avec les époques jeunes le goût des fables. L’essai, la maxime, le raisonnement sont réservés aux périodes vigoureuses”. Le cinéma était tourné en dérision comme manifestation de ce goût corrupteur pour de rapides successions d’images. Dans la Grèce ancienne (qui pour ce genre d’hommes restait le modèle), tous ceux qui allaient au théâtre connaissaient l’intrigue de la pièce, et seul importait le savoir-faire avec laquelle elle était menée, la façon dont étaient représentés caractères, passions et idées. De nos jours en revanche (continuait notre auteur), on prisait la révélation d’informations inconnues, la divulgation de scandales, si bien que la plupart des biographies se réduisaient en fait à des récits passionnels. Beaucoup de lecteurs l’acceptaient car ils n’avaient eux-mêmes d’autre expérience que celle de la passion et n’avaient jamais rien fait qui dépassât leur propre existence. Aux yeux de ce critique classique, le théâtre et le roman étaient des formes acceptables de l’art parce qu’“ils ont leurs lois”. Mais la biographie “est un genre plus incertain”. En conclusion, il estimait que la valeur d’une biographie était déterminée finalement par les qualités de l’auteur… “Le peintre compte plus que le modèle”».41 N'empêche. On se passionna pour des nouveaux types d'hommes et de femmes qui n'appartenaient plus au monde princier. La démocratie atteignait le Gotha. Dans ce contexte, les forces réactionnaires s'engagèrent vers des régimes dictatoriaux, possesseurs de pensée unique, ne reculant ni devant la justice arbitraire ni devant la violence primat du droit. «Pour ces hommes, le terme “décadent” était celui qui décrivait le mieux la période de l’après-guerre. Ici, une fois encore, une critique déjà traditionnelle se confondait avec la tradition littéraire fin de siècle. À cette époque-là aussi, l’establishment extérieurement prospère semblait n’avoir été qu’un masque cachant une pourriture intérieure. Pour beaucoup d’intellectuels fascistes, la décadence supposée du présent fut ce qui déclencha leur adhésion à l’utopie fasciste. Une société dans laquelle l’unité spirituelle remplaçait à la fois la lutte des classes et l’isolement de l’homme et où l’ordre était réconcilié avec les ressorts irrationnels de la créativité offrait un monde où les valeurs ultimes triompheraient certainement. Giovanni Gentile croyait que le fascisme était une interprétation personnelle de l’esprit nouveau qui s’efforçait de tendre vers l’État éthique».42 Le premier quart du XXe siècle allait parfaire ce que la fin du XIXe avait amorcé sans pouvoir le mener à bien.
1 G. Minois. Histoire du mal de vivre. De la mélancolie à la dépression, Paris, La Martinière, 2003, p. 332.
2 Cité in G. Perrin. Sociologie de Pareto, Paris, P.U.F., Col. SUP le sociologue, # 3, 1966, p. 200, n. 2.
3 B. Binoche. Les trois sources de la philosophie de l'histoire, Paris, P.U.F., Col. Pratiques théoriques, 1994, p. 230.
4 F. Proust. L'histoire à contretemps, Paris, Éditions du Cerf, rééd. Livre de poche, Col. Biblio-essais, # 4278, 1994, p. 264.
5 J.-C. Sournia. op. cit. pp. 102-103.
6 G. L. Mosse. L'image de l'homme, Paris, Abbeville, Col. Tempo, 1997, p. 87.
7 J.-L. Ferrier. Courbet : Un enterrement à Ornans, Paris, Denoël-Gonthier, Col. Médiations # 163, 1980, pp. 39-40.
8 M. Praz. La chair, la mort et le diable dans la littérature du XIXe siècle, Paris, Gallimard, Col. Tel, # 300, 1999, p. 247.
9 M. Praz. ibid. p. 335.
10 J.-C. Sournia. op. cit. p. 104.
11 P. Sloterdijk. Écumes, Paris, Maren Sell Éditeurs, Col. Sphères III, 2005, pp. 748-749.
12 J.-C. Sournia. op. cit. p. 101.
13 G. Vigarello. Le propre et le sale, Paris, Seuil, Col. L'univers historique, 1985, pp. 131-132.
14 L. Duplessy. L'esprit des civilisations, Paris, La Colombe, 1955, p. 209.
15 L. Duplessy. ibid. p. 278.
16 M. Winock. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H131, 1990, pp. 104 à 109.
17 F. Tamagne. Histoire de l'homosexualité en Europe, Paris, Seuil, Col. L’univers historique, 2000, pp. 587-588.
18 M. Angenot. op. cit. pp. 369-370.
19 M. Vovelle. La mort en Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque illustrée des histoires, 1983, p. 654.
20 M. Angenot. op. cit. p. 373.
21 A. J. Mayer. La persistance de l'Ancien Régime, Paris, Flammarion, Col. Champs,# 212, 1983, p. 271.
22 Nietzsche. Zarathoustra, in D. Halévy. Nietzsche, Paris, Grasset, Col. Pluriel, # , 1977, pp. 409-410.
23 R. Wohl. The Generation of 1914, Boston, Harvard University Press, 1979, p. 166.
24 S. Jouve. Les Décadents, Paris, Plon, 1989, pp.15-17.
25 S. Jouve. ibid. pp. 21-22.
26 M. Delbourg-Delphis. Masculin singulier, Paris, Hachette, 1985, p. 143.
27 S. Jouve. ibid. op. cit. pp. 13-14.
28 S. Jouve. ibid. p. 15. * De sur blasé.
29 E. R. Curtius. Essais sur la littérature européenne, Paris, Grasset, 1967, p. 274.
30 S. Jouve. op. cit. p. 188.
31 A. Vircondelet. J.-K. Huysmans, Paris, Plon, 1990, pp. 136-137.
32 E. Jünger. Le mur du Temps, Paris, Gallimard, Col. Idées, # 434, 1963, p. 288.
33 J. Le Rider. Modernité viennoise et crise de l'identité, Paris, P.U.F., Col. Quadrige, # 302, 2000, p. 143.
34 F. Latraverse et W. Moser (éd.) Vienne au tournant du siècle, Montréal, Hurtubise HMH, 1988, p. 232.
35 H. Broch. Création littéraire et connaissance, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 1966, p. 334.
36 H. Broch. ibid. p. 47.
37 E. Weber. Fin de siècle, Paris, Fayard, 1986, p. 23.
38 Z. Sternhell. Les anti-Lumières, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, # 176, 2010, p. 41.
39 J. Le Rider. op. cit. 2008, pp. 442-443.
40 E. Zaretsky. Le Siècle de Freud, Paris, Albin Michel, rééd. Livre de poche, Col. Biblio essais, # 31504, 2004, pp. 34-35.
41 T. Zeldin. Histoire des passions françaises, t. 5 : Anxiété et hypocrisie, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H55, 1981, pp. 16-17.
42 G. L. Mosse. La révolution fasciste, Paris, Seuil, Col. XXe siècle, 2003, p. 138.
NOTE: Le texte d'Anus Mundi se trouve intégralement disponible sous format PDF à l'adresse:
https://drive.google.com/drive/folders/0B195tjojRBFyMzV5bnQ5aWZnYWs?hl=fr&resourcekey=0-cjiSMfhrTpt1qd8v4I78wg